Parler sans savoir : on le fait tous. Et pourtant, cette tendance banale a un nom aussi curieux que révélateur : l’ultracrépidarianisme. Ce mot à rallonge désigne l’art de donner son avis sur des sujets qu’on ne maîtrise pas. À l’ère des réseaux, où chacun peut s’exprimer sur tout, ce phénomène a pris une ampleur inédite. Derrière les certitudes bruyantes et les raccourcis paresseux, se cache une crise plus profonde : celle de la légitimité du savoir. Médecine, climat, éducation, économie… Ce texte explore les territoires familiers de l’opinion tranchée, pour mieux réhabiliter une posture devenue rare : le doute lucide.
Une de mes obsessions, c’est de parler en connaissance de cause. Ou plutôt : en connaissance de savoir. Rien ne me semble plus désagréable – voire franchement insupportable – que de m’avancer sur un sujet sans en maîtriser les contours. Et c’est pourtant exactement ce que désigne ce mot baroque, qu’on devra sans doute répéter une bonne vingtaine de fois avant de le prononcer sans trébucher : l’ultracrépidarianisme.
Derrière son étymologie amusante se cache un phénomène beaucoup moins drôle. J’aimerais ici m’attarder sur ce fléau moderne, qui prospère dans les espaces de parole débridés, là où l’opinion (ou l’ignorance) prend bien trop souvent la place du savoir. Je proposerai d’abord une définition claire du terme, avant d’explorer plusieurs domaines propices aux réactions ultracrépidariennes : médecine, climat, éducation, etc. Et je finirai sur un rapprochement un peu facile – mais assumé – avec une figure familière de notre paysage social : la beaufitude.
Un mot compliqué pour une réalité familière : parler sans savoir
L’ultracrépidarianisme : un mot long, tordu, un peu barbare… mais qui désigne une réalité tristement courante : donner son avis sur des sujets qu’on ne maîtrise pas. Mais pour comprendre ce terme, il faut remonter à une anecdote latine rapportée par Pline l’Ancien. Un jour, un cordonnier examine un tableau et critique la sandale représentée. Le peintre, honnête, corrige l’erreur. Mais le cordonnier, enhardi, se met ensuite à critiquer tout le reste de l’œuvre. Le peintre s’énerve alors et lui lance la fameuse réplique :
Sutor, ne ultra crepidam
(Cordonnier, pas au-delà de la sandale.)
Autrement dit, cette remarque est devenue une métaphore et prévient en disant : « reste dans ton domaine de compétence ! » Si on doit décortiquer le mot qui nous occupe ici :
- “Ultra”, en latin, signifie au-delà ;
- “Crepidam” désigne la sandale ;
- Et le suffixe “-arian” désigne une personne liée à une pratique (comme dans végétarien).
L’ultracrépidarien, c’est donc celui qui parle au-delà de sa sandale — et donc de son savoir. Cela désigne donc cette tendance agaçante faite souvent avec aplomb et parfois avec condescendance.
Un mot rare pour un comportement devenu banal
Dans l’Antiquité, l’ultracrépidarien s’aventurait au-delà de la sandale. Aujourd’hui, il s’aventure au-delà de la biologie, de la géopolitique, de l’histoire, de la climatologie, de la pédagogie — et de tout ce qui peut nourrir un débat — pourvu qu’il ait un micro, un compte Twitter ou une caméra frontale. Ce phénomène trouve un terreau particulièrement fertile dans notre monde hyperconnecté, où :
- Les réseaux sociaux offrent à chacun une tribune équivalente à celle d’un expert,
- Le nombre de vues remplace la rigueur des sources,
- La vitesse de réaction vaut mieux que la profondeur d’analyse,
- Et la certitude affichée l’emporte souvent sur l’humilité du doute.
Bref, c’est un poison sans limite.
La médecine, premier terrain de l’ultracrépidarien
L’une des premières fois où j’ai ressenti avec force ce que pouvait être l’ultracrépidarianisme, c’était dans le domaine médical. La plateforme Doctissimo a longtemps représenté une forme de porte d’entrée « douce » vers ce phénomène : un espace hybride, entre partage d’expérience sincère et autodiagnostic sauvage. On y cherchait un avis, un réconfort, un témoignage… et on y trouvait souvent des certitudes hasardeuses érigées en vérités. Mais la crise du Covid a fait passer cette tendance à une autre échelle. Dans une situation inédite, anxiogène, sans précédent clair, l’ultracrépidarianisme médical est devenu viral — au sens propre comme au figuré. Ce fut un catalyseur de savoir de comptoir, accéléré par la défiance généralisée envers les institutions. On a vu émerger :
- Un rejet en bloc de l’expertise médicale : accusée d’être vendue à Big Pharma (note : je ne nie pas certains conflits d’intérêts, comme lorsque mon propre vétérinaire me pousse vers des médicaments de marque…),
- Une suspicion généralisée autour de la vaccination (je ne suis pas un fervent pro-vax idéologique, mais je me suis fait vacciner — notamment pour pouvoir retourner à l’époque en Belgique),
- Une dévalorisation de toute autorité fondée sur le savoir, au profit de :
- la viralité d’un propos,
- la familiarité d’un “je suis comme vous”,
- et la conviction émotionnelle plus que l’argumentation raisonnée.
Ce que cela révèle, ce n’est pas seulement un rejet de la médecine.
C’est une crise plus large de la légitimité du savoir, au profit d’une parole désinhibée, affective, séduisante… mais souvent dangereusement infondée. Alors, pourquoi médecine est aussi représentative de ce phénomène ? Car elle touche à l’intime, donc chacun s’y sent légitime, elle est complexe et technique, donc sujette à malentendus, elle a été massivement médiatisée, notamment pendant le Covid et, enfin, elle cristallise des conflits d’intérêts réels ou fantasmés, favorisant la défiance. L’ultracrépidarianisme s’épanouit également dans d’autres domaines, là où la complexité rencontre la visibilité… soit là où tout le monde se sent concerné, donc autorisé à donner son avis, là où les enjeux sont sérieux (donc tentants à commenter) et là où le savoir est technique ou spécialisé (donc difficile à vulgariser). Après la médecine, voici d’autres domaines où l’ultracrépidarianisme se déploie férocement.
Quand la météo fait la loi : opinions climatiques en roue libre
À l’instar de la médecine, l’environnement est un autre domaine où l’ultracrépidarianisme prospère. On reconnaîtra aisément qu’une bonne majorité de faits cités ci-dessous nous rappelle ce bon vieux climatoscepticisme :
- “Il a toujours fait chaud en été”. On assiste ici une réduction du climat à la météo (cf. encart ci-dessous qui, s’il enfonce des portes ouvertes, me paraît utile). Et c’est plutôt classique, nombreux sont ceux à confondre un ressenti personnel ou local avec une dynamique planétaire mesurée sur plusieurs décennies.
🌦️ Focus : Climat ≠ Météo
La météo, c’est ce qu’il fait ici et maintenant : 25 °C à Nantes, pluie à Bruxelles, neige en avril.
Le climat, c’est une tendance observée sur plusieurs décennies, à l’échelle d’une région ou de la planète.
Autrement dit : la météo, c’est votre tenue du jour. Le climat, c’est votre garde-robe moyenne sur 30 ans.
Dans le discours ultracrépidarien, cette distinction s’effondre :
“Il a neigé en avril, donc votre réchauffement climatique, hein…”
Un épisode de froid ne contredit pourtant pas une tendance de fond. Le dérèglement climatique peut même renforcer la variabilité météorologique : canicules précoces, pluies intenses, gel tardif… Ce sont les symptômes visibles d’un déséquilibre global.
La confusion persiste parce que la météo est concrète, vécue, immédiate, tandis que le climat est abstrait, statistique et invisible. C’est un terrain rêvé pour les raccourcis d’opinion et les interprétations personnelles.
- “Moi je trie mes déchets, donc j’ai fait ma part”. Cette phrase que l’on entend souvent peut devenir de l’ultracrépidarianisme si l’on érige ce geste en réponse suffisante au désastre écologique — ou si l’on s’en sert pour délégitimer la parole d’experts ou militants. On a ici l’illusion du petit geste comme substitut à une réflexion systémique.
- Ou encore : “Ce sont les avions qui polluent le plus, pas moi”. Voilà une phrase qu’on entend souvent, et qui illustre parfaitement le pouvoir des idées simplificatrices dans la pensée écologique ordinaire.
En désignant un coupable unique — ici l’aviation — on se décharge symboliquement de toute implication personnelle. Ce qui pèse le plus, ce n’est pas tel ou tel secteur isolé, mais le modèle de consommation global : transport, alimentation, urbanisation, industrie, numérique… En pointant un seul facteur spectaculaire, on efface la logique systémique et on évite de s’interroger sur nos modes de vie.
🧠 Focus : Boucs émissaires technologiques
Face à la complexité des enjeux environnementaux, il est tentant de désigner un coupable unique : les avions, la 5G, les SUV, les multinationales, etc. Ces cibles sont visibles, symboliques, et faciles à critiquer.
Ce réflexe de simplification accusatoire relève souvent d’une posture ultracrépidarienne : on parle de phénomènes systémiques avec des arguments partiels, émotionnels ou erronés, souvent répétés sans recul ni vérification.
Le danger ? Réduire l’analyse à des représentations commodes au lieu de penser les causes profondes : nos modèles de consommation, les rapports économiques globaux, l’organisation collective des modes de vie. Ce déplacement de responsabilité empêche toute réflexion systémique réelle.
Éducation : quand l’opinion remplace la pédagogie
En voilà encore un domaine propice à l’ultracrépidarianisme. Et pour être tout à fait transparent : c’est un sujet que je maîtrise encore moins que d’autres, n’ayant ni formation en pédagogie ni enfant à accompagner dans le système. Bien sûr, j’ai une opinion — comme tout le monde. Par exemple, je trouve scandaleux que l’éducation nationale (au même titre que l’hôpital public) soit soumise aux mêmes logiques de rationalisation budgétaire qu’une entreprise. Mais je reste prudent : je sais que je parle de l’extérieur, avec une vision globale mais non incarnée. Cela dit, ce regard décentré me permet aussi une chose : voir l’école comme une institution de formatage plus que comme un espace d’émancipation. C’est une grille de lecture, pas une vérité. Et je ne la défends pas comme on défend une chapelle. Que peut-on dire sur le sujet de la pédagogie ?
L’argument du bon sens…
… Et l’opinion de penser : « pas besoin de diplôme pour éduquer un enfant, il suffit de bon sens.” Il s’agit d’un raccourci très courant qui oppose savoir savant et expérience personnelle, comme si la pédagogie se réduisait à l’intuition. Cette simplification efface la complexité des apprentissages, des dynamiques de groupe, du développement cognitif ou social de l’enfant.
La nostalgie régressive…
… Et le fameux “avant, on apprenait mieux, on respectait les profs, et on savait lire.” C’est une forme typique de glorification du passé : « c’était mieux avant » où l’on ignore les inégalités scolaires de l’époque, les violences symboliques ou physiques, le fait que l’école excluait largement certains profils.
La méfiance envers les enseignants…
… Et des remarques comme : « les profs ne foutent rien, ils sont tout le temps en vacances.” Même sans être enseignant, je suis conscient que les cours ne sont qu’une partie émergée de l’iceberg. Il s’agit là d’une posture anti-corporatiste qui ramène une fonction sociale complexe à sa charge horaire visible. Cette opinion dénie le travail invisible : préparation, correction, accompagnement, gestion du groupe, suivi émotionnel…
La confusion entre expérience d’élève et savoir sur l’école…
… Et de penser que comme “moi aussi j’ai été à l’école, je sais comment ça marche.” Un comportement assez fréquent qui fait que l’on juge l’expérience vécue comme compétence pédagogique. Mais avoir été élève ne suffit pas pour comprendre les enjeux de transmission, la gestion des inégalités, ou la pédagogie différenciée (soit, et je l’apprends moi-même, est cette approche pédagogique qui part du principe que chaque personne apprend à son rythme, n’a pas les mêmes besoins, ni les mêmes facilités/blocages, sans parler du contexte social).
La politique et la géopolitique : savoir de comptoir, conséquences généralisées
Encore un terrain fertile. Où je donnerais deux exemples d’ultracrépidarianisme flagrants. Le premier : le raccourci extrêmement courant, souvent dit avec lassitude, dégoût ou cynisme du « ça ne sert à rien de voter« . On pourrait penser que voter ne change rien parce que les programmes se ressemblent, que les décisions majeures échappent aux citoyens ou que l’économie dicte tout. C’est une impression que je comprends — elle n’est pas entièrement infondée.
Mais en faire un principe, c’est oublier que le politique structure absolument tout : ce que l’on mange, ce que l’on apprend, les soins que l’on reçoit, l’endroit où l’on vit, les droits que l’on a (ou pas), les libertés qui nous protègent. Refuser de voter, c’est souvent confondre impuissance ressentie et inutilité réelle, et c’est, quelque part, laisser les autres décider pour soi.
🎭 Focus : Le cheval de Troie idéologique
Certains discours politiques ou géopolitiques très répandus — “ça ne sert à rien de voter”, “tout est manipulé par les Américains”, “les experts nous mentent” — peuvent sembler critiques ou lucides. Mais ils fonctionnent souvent comme des chevaux de Troie idéologiques.
Autrement dit, ils donnent l’impression de rejeter le pouvoir en place, alors qu’ils en renforcent parfois les logiques sous-jacentes : dépolitisation, relativisme, méfiance généralisée, repli émotionnel, diffusion de récits simplistes ou biaisés.
Ce type de discours relève de l’ultracrépidarianisme lorsqu’il repose sur une compréhension fragmentaire, émotionnelle ou mimétique, sans vérification ni recul. On croit “voir clair”, mais on s’appuie souvent sur des contenus viraux, des ressentis ou des interprétations erronées.
Le danger ? Remplacer l’analyse par la réaction. Et faire passer, sous couvert de bon sens ou de lucidité, des idées qui bloquent toute pensée politique véritable.
Cette idée trouve des échos dans les travaux de Pierre Bourdieu (sur la reproduction symbolique), Noam Chomsky (et la fabrication du consentement), Antonio Gramsci (avec l’hégémonie culturelle), ou encore Jacques Rancière (sur la distribution de la parole politique légitime).
Le deuxième exemple est plus spectaculaire encore : les opinions tranchées sur les conflits géopolitiques. On l’a vu très clairement avec l’Ukraine, où chacun s’est senti autorisé à décréter en trois phrases qui avait tort, qui avait raison, ce que “l’Occident voulait vraiment” ou ce que “Poutine défendait”. Peu de recul, beaucoup de certitudes — et surtout, très peu de lectures sérieuses derrière les affirmations. Là encore, c’est de l’ultracrépidarianisme pur : un sujet infiniment complexe, traité avec une grille binaire et un aplomb désarmant, fondé sur des impressions, des rumeurs, des contenus viraux. Et derrière cela, souvent, une méfiance généralisée envers toute forme de médiation savante : géopoliticiens, diplomates, historiens, journalistes spécialisés deviennent suspects, alors que “le peuple, lui, voit clair”.
L’économie : une science du déséquilibre assumé
Je n’ai commencé à me forger une opinion sur l’économie que le jour où j’en ai découvert sa définition la plus simple : « satisfaire des besoins illimités avec des ressources limitées. » Ce postulat m’a frappé par son caractère à la fois absurde et central. Comment peut-on bâtir une logique sociale durable sur un principe aussi déséquilibré ? Et pourtant, tout en moi sentait que c’était là le cœur du problème — et aussi, paradoxalement, le moteur de toute organisation humaine. Depuis, je regarde l’économie avec un mélange de scepticisme et de fascination. Ce n’est pas une science mineure ou purement technique : c’est une grille de lecture sur le monde, un révélateur d’arbitrages, de hiérarchies, de violences parfois invisibles. Et comme toute grille de lecture, elle peut être utilisée pour éclairer ou pour masquer. L’économie est aussi une secteur riche en ultracrépidarianisme… Voici une sélection de remarques que l’on a tous entendu mille fois :
« L’économie, c’est comme le budget d’un ménage«
C’est sans doute l’un des analogies les plus répandues dans les discours politiques ou médiatiques. Elle repose sur une idée intuitive : on ne peut pas dépenser plus que ce que l’on gagne. Mais transposer cela à un État est économiquement absurde. Un foyer ne peut ni créer de la monnaie, ni émettre de la dette souveraine, ni planifier des investissements à 30 ans. Un État n’est pas une famille : il n’a pas à « rembourser sa dette » comme un particulier, et il peut investir en déficit s’il anticipe des bénéfices futurs (infrastructure, éducation, recherche…). On assiste donc ici à une réduction trompeuse d’un système complexe à une image domestique. Cette réflexion vient souvent des politiques eux-mêmes qui l’utilisent comme justification de politiques d’austérité sous prétexte de « bonne gestion« … et qui dérive dans le discours grand public.
« On n’a qu’à imprimer plus d’argent«
C’est l’idée miracle… à première vue. Pourquoi ne pas créer plus de monnaie pour effacer la dette ou augmenter les salaires ? Après tout, une banque centrale peut le faire d’un simple clic. Mais la monnaie n’a de valeur que par la confiance collective qu’on lui accorde (et ça, c’est complètement fou quand on y pense : un simple chiffre devient échangeable contre du pain, un loyer ou un soin médical).
Si on augmente brutalement la quantité de monnaie sans créer de richesse réelle (biens, services, savoirs…), il y a plus d’argent qui court après la même quantité de choses et les prix montent. C’est ce que l’on appelle l’inflation. Pire encore, si cette perte de valeur s’accélère et que la population perd confiance dans la monnaie, on entre dans une spirale incontrôlable : c’est l’hyperinflation. L’argent fond. Les prix doublent, triplent, chaque semaine. On en vient à peser les billets au lieu de les compter.
« La dette, c’est virtuel, donc ce n’est pas grave«
La dette publique est certes abstraite : c’est une suite de chiffres, de titres, de flux. Mais ses effets sont bien réels : elle conditionne les politiques budgétaires, les marges d’investissement, les relations entre États et marchés financiers. La dette n’est pas “mauvaise” en soi — mais comment elle est utilisée, et par qui elle est remboursée, sont des enjeux éminemment politiques. Ce cliché confond abstraction économique et inexistence politique. Il masque souvent les inégalités de traitement : les dettes des États ne sont pas jugées comme celles des particuliers.
« Il faut relancer la croissance à tout prix«
Voilà un mantra qui revient à chaque crise. La croissance du PIB est encore vue comme le principal indicateur de bonne santé économique. Mais cette obsession repose sur une équation dépassée : plus de production = plus de bien-être. Dans un monde aux ressources finies, cela pose problème. On le voit avec la crise écologique : produire plus, consommer plus, extraire plus… ne garantit pas une vie meilleure. Et parfois, ralentir, répartir ou préserver serait plus utile que croître. Ce cliché associe progrès, abondance et croissance sans se poser la question de la soutenabilité. Il ignore la possibilité d’un autre modèle que celui de l’accumulation.
« Le marché s’autorégule«
Idée héritée du libéralisme classique (via Adam Smith et “la main invisible”), très utilisée dans le discours néolibéral moderne. Mais dans la réalité, les marchés sont toujours encadrés, biaisés, influencés. Laisser faire le marché, c’est en fait laisser faire ceux qui y ont le plus de pouvoir. Crises financières, bulles immobilières, krachs boursiers… montrent bien que l’“autorégulation” est un mythe. Et pourtant, il sert encore à justifier l’inaction politique ou à accuser l’État de tous les maux. Le marché n’est pas neutre : il reflète des rapports de force. Croire à sa régulation spontanée, c’est refuser toute régulation démocratique réelle.
De la beaufitude à l’ultracrépidarianisme
Et quand je vois tout ça — cet ensemble d’opinions stéréotypées mais omniprésentes — j’ai honte de le dire, mais une image me revient : celle d’un personnage de bon sens rustique, sûr de lui, peu nuancé. Une caricature, certes, mais difficile à ignorer. Disons-le franchement : je pense au beauf. Cabu l’a dessiné, la société française l’a adopté, et Bourdieu l’a théorisé à sa manière dans la figure du porte-parole imaginaire du sens commun : celui qui parle comme “tout le monde”, avec l’assurance tranquille de ceux qui n’ont pas besoin de preuves.
🗣️ Focus : Le porte-parole imaginaire du sens commun
Théorisé par le sociologue Pierre Bourdieu, ce concept désigne une figure — souvent médiatique ou politique — qui prétend parler au nom du “peuple”, en s’appuyant sur un supposé bon sens partagé par tous.
Ce porte-parole imaginaire revendique une forme d’authenticité populaire : il “dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas”, en exprimant des opinions simples, souvent stéréotypées, présentées comme des vérités naturelles et indiscutables.
Mais derrière cette posture se cache souvent une prise de pouvoir symbolique : celle de fixer les limites du pensable, de réduire la complexité à des jugements tranchés, et de délégitimer toute parole experte comme “hors sol”.
Le problème n’est pas qu’il existe une parole populaire : c’est qu’on fait passer une construction sociale pour une évidence naturelle — au risque d’empêcher tout débat, toute nuance, toute pensée critique.
C’est toujours un peu facile de parler de “beaufitude”, je le concède (car, comme on le dit « on est tous le beauf d’un autre ! »). Mais reconnaissez que le terme regroupe un bon nombre de traits caractéristiques. Le beauf :
- A un avis sur tout (et surtout sur ce qu’il ne connaît pas) ;
- Parle fort, vite, avec des certitudes toutes faites ;
- Rejette les experts, déteste la nuance, moque la complexité ;
- Et surtout, il érige son bon sens en vérité ultime, supérieure à tout savoir théorique.
Je sais que cette caricature flirte dangereusement avec le mépris de classe. Ce n’est pas l’intention. Je ne parle pas ici d’un niveau d’étude, ni d’un statut social, encore moins d’une origine. La beaufitude, pour moi, n’est pas une condition, c’est une posture mentale : celle qui refuse de douter, qui se crispe sur des certitudes, qui méprise tout ce qui demande effort ou nuance. Et cette posture peut surgir chez tout le monde : dans un PMU comme dans un open space, sur un plateau télé comme dans une salle de profs. Elle n’est pas affaire de diplômes, mais de disposition à penser contre soi.
Je ne sais pas tout — et c’est pour ça que j’écris
Comme d’autres travers intellectuels, l’ultracrépidarianisme a ceci de redoutable qu’on en est souvent à la fois la victime et le vecteur, sans même s’en rendre compte. C’est précisément pour cela que j’ai tenu à le mettre en lumière. La posture critique semble facile à adopter — il suffirait de “ne pas parler sans savoir”. Mais en réalité, elle exige un effort plus subtil : reconnaître qu’on l’a tous pratiqué un jour, que certaines de nos certitudes sont des masques pour notre ignorance, et que le doute n’est pas un recul, mais une exigence.
Sur ce blog, j’essaie d’éviter l’ultracrépidarianisme autant que possible. Comme je le disais en préambule, c’est même l’une de mes préoccupations intellectuelles majeures. J’ai recours à l’IA pour m’aider à tisser des liens, ouvrir des pistes jusque-là inaccessibles et interroger mes angles morts. J’ignore beaucoup de choses — et j’essaie de le reconnaître chaque fois que cela m’est possible. Parce que penser, vraiment, commence toujours par là.
Et je terminerai par cette ultime réflexion : on peut avoir été ultracrépidarien à un moment de sa vie, sans que cela soit une fatalité. C’est même tout l’intérêt d’un apprentissage continu et lucide : passer de l’ignorance à la connaissance, non pour tout maîtriser — ce serait illusoire — mais pour apprivoiser peu à peu les contours d’un sujet. Reconnaître ses limites, c’est déjà s’en affranchir un peu et cela permet, à mon sens, de se prémunir de cette dérive qu’est l’ultracrépidarianisme.

Charte de transparence IA
🧠 Idée : 100 % humaine (grâce à ma femme, merci à elle, j’ai trouvé le sujet super intéressant à explorer)
📁 Structure : brainstorming, propositions de la définition et des domaines à exploiter.
✍️ Rédaction : J’ai travaillé mon introduction, l’IA m’a accompagné sur les exemples des différents domaines proposés, j’ai repris la main sur la partie concernant la beaufitude et ma conclusion.
🎨 Illustrations : générées à 100 % par IA
Intervention globale de l’IA estimée : 70 %
Cette série de formats courts part d’un mot ou d’un concept croisé au fil de mes lectures, de mes errances ou de mes curiosités. Rien de prétentieux ici : juste l’envie de creuser un peu, de tirer sur un fil.
Parfois un terme rare, parfois une notion connue redécouverte autrement. L’idée n’est pas d’en faire le tour, mais d’ouvrir une porte. Ou une fenêtre.
Autrement dit : des éclats de sens attrapés au vol.




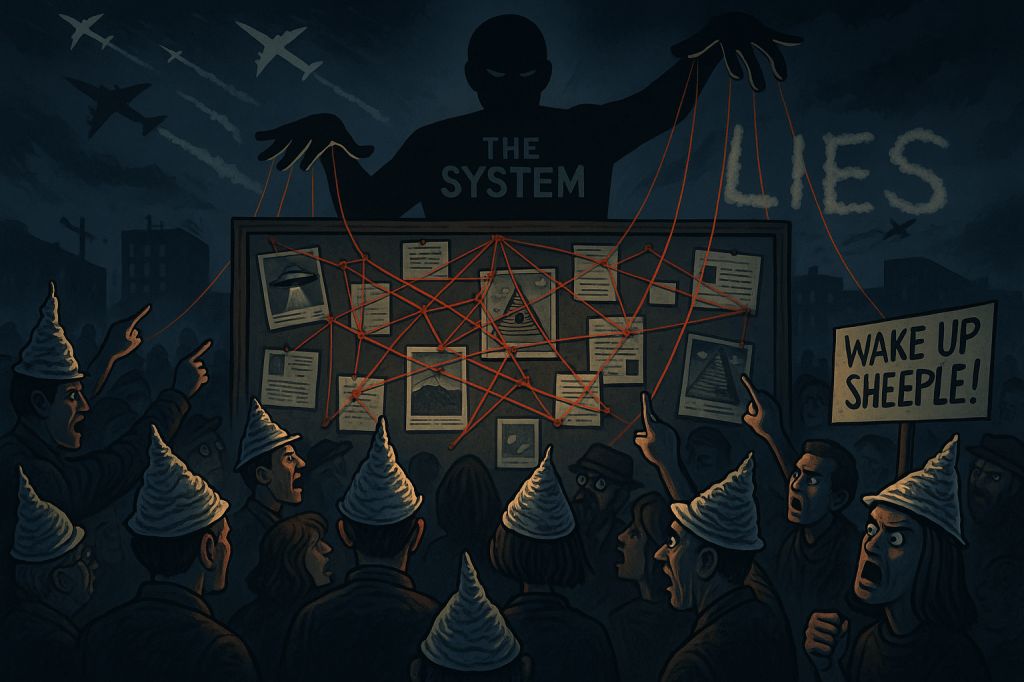



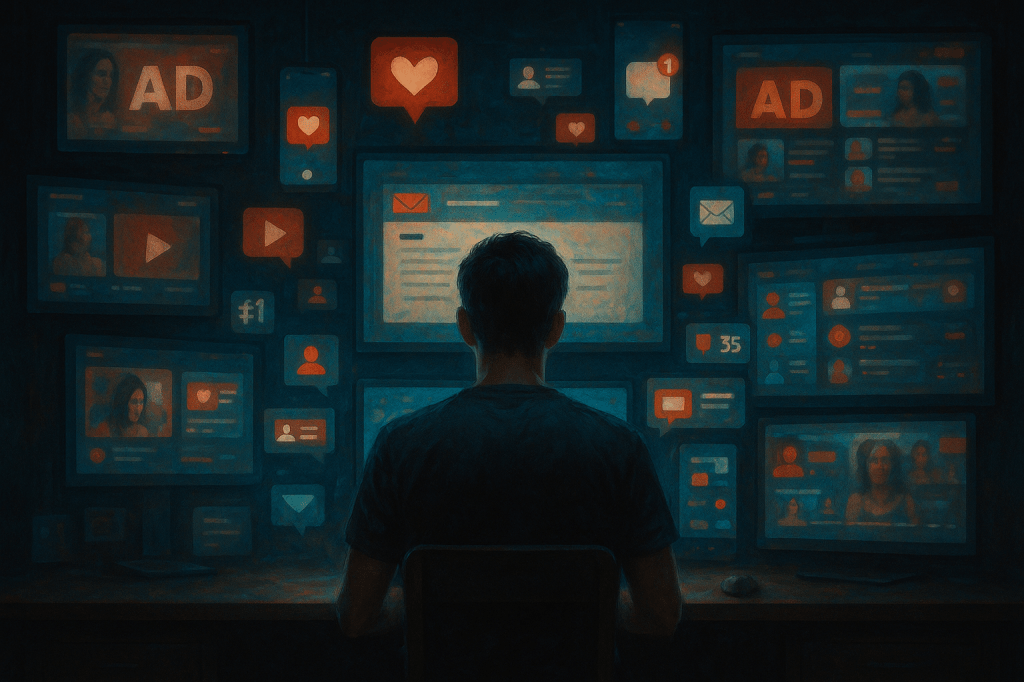
Répondre à La fabrique des contre-mondes : du soupçon légitime au délire collectif – LE REDACTEUR MODERNE Annuler la réponse.