Dans un monde saturé de livres, de films, de jeux et de musiques, l’abondance culturelle ressemble autant à une promesse qu’à un vertige. Entre captivité algorithmique et stratégies d’appropriation, cet article explore les paradoxes d’une époque où “habiter la culture” exige de réinventer notre rapport au temps, à l’attention et aux œuvres.
- I. Trop plein, trop vide : anatomie d’un paradoxe culturel
- II. Nourritures spirituelles ou fast-food intellectuel ?
- III. De l’œuvre au “contenu” : la bascule consumériste
- IV. Pris au piège des flux
- V. S’ancrer dans l’océan culturel
- VI. Entre profusion et captivité : quel avenir pour la culture ?
- VII. Sources et ressources
Chaque année, c’est la même rengaine : la rentrée littéraire en France — et, par ricochet, dans l’espace francophone. En 2025, 484 nouveautés ont été publiées, dont 344 romans. Cela peut sembler beaucoup, mais c’est « raisonnable » au regard du pic de la première décennie 2000, où l’on frôlait les 700 titres à la rentrée 2010. Ce chiffre déjà vertigineux m’a interpellé. Les autres secteurs ne sont pas en reste. Au cinéma (principalement films de fiction et documentaires) on compte désormais plus de 10 000 films produits par an dans le monde. En musique, Spotify estime de 100 000 à 120 000 le nombre de nouveaux morceaux uploadés chaque jour, soit plus de 40 millions de titres par an. Côté jeux vidéo, Steam (la plus grosse plateforme PC) a vu apparaître presque 19 000 nouveaux jeux en 2024, une tendance qui se maintiendrait pour 2025.
Les chiffres pourraient s’aligner à l’infini, mais l’essentiel est ailleurs : n’y aurait-il pas un fameux décalage entre l’offre culturelle et le temps que nous pouvons y allouer ? La conséquence de cette démesure crée de la frustration, un zapping compulsif, un FOMO (fear of missing out) culturelle ou une délégation de plus en plus importante aux algorithmes prescripteurs. Bien sûr, la découverte fortuite existe encore — l’ami curieux qui nous fait découvrir une pépite oubliée — mais le sérendipité a assurément de plus en plus de mal à exister avec un flux quasi infini. Il ne s’agit presque plus de découvrir par le hasard fortuit mais de chercher une aiguille dans un océan de bottes de foin. Notre monde d’aujourd’hui, animé par des secteurs dynamiques et généreux, laisse peu de temps mort. La question la plus importante devient alors : trop de culture tue-t-elle la culture ?
I. Trop plein, trop vide : anatomie d’un paradoxe culturel
Ce qui relève vraiment de la sérendipité, par contre, c’est ma découverte du troisième essai de Bruno Patino. Après La Civilisation du poisson rouge et Tempête dans le bocal — qui analysaient déjà l’économie de l’attention, l’article ici se présentant en quelque sorte comme la suite spirituelle du sujet que j’y consacrais — voici Submersion. Son propos vient quelque peu croiser mon sujet : quand j’explore l’abondance sous l’angle avant tout culturel, lui l’aborde comme une abondance de contenus au sens large. Livres, vidéos, podcasts, réseaux sociaux : l’offre est désormais illimitée, indistincte, partout. Dans son livre, il revient sur cette volonté non voilée, et j’en parlais également sur le sujet sur l’attention, de parasiter nos jours… et nos nuits. « Voici venu le temps de l’aube perpétuelle » écrit-il. Après trois livres sur le même sujet, évoluant, au niveau du numérique, à une vitesse folle, Patino explique être le cobaye ultime d’un monde qui nous abreuve sans cesse ; car lui, comme moi, sommes pleinement connectés, adeptes de l’offre culturelle telle qu’elle est proposée aujourd’hui.
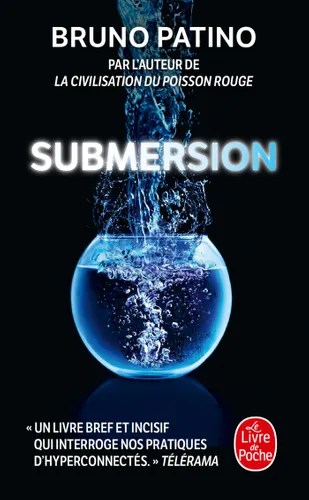
Dans un article du Monde consacré à ce livre, le rédacteur en chef constate que « la découverte culturelle a perdu son aura : elle s’étire vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; nos corps changent, nous avons la nuque baissée, l’assoupissement se répète devant une série, nous écoutons d’une oreille, hésitons quinze minutes avant de choisir un programme, trente minutes pour une famille en quête d’un film à regarder ». Il dit dans ses mots ce que je ressens face au paradoxe de l’offre pourtant généreuse, voire infinie, de propositions culturelles. Cette perte d’aura renvoie au vocabulaire de Walter Benjamin, philosophe, critique et littéraire allemand, dans « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (1936). Pour lui, à son époque, la reproductibilité avait déjà grignoté l’aura ; la profusion numérique, c’est l’étape suivante naturelle : l’aura n’est plus seulement affaiblie, elle est diluée dans un océan de contenus interchangeables.
La bascule de la rareté à l’abondance
Plus haut, je regrettais la disparition de la découverte hasardeuse. Au détour des années 1980, 90 — voire les premiers temps des années 2000 —, la rareté organisait la découverte culturelle : on guettait (parfois très longtemps) la sortie d’un album, d’un film, d’un jeu. On estimait alors que l’attente faisait partie du plaisir. Aujourd’hui, tout est disponible immédiatement et partout. Cette bascule a supprimé l’attente mais aussi une partie de la valeur symbolique : ce qu’on peut avoir à tout moment semble moins précieux.
La fatigue du choix
L’exemple souvent cité par Le Monde — passer quinze minutes à chercher un programme ou une demi-heure à choisir un film en famille — illustre un phénomène désormais banal : la surcharge cognitive (c’est tout la métaphore que l’on retrouve dans le titre du livre de Patino : « Submersion« ). La profusion n’élargit plus notre horizon, elle épuise notre capacité de décision. C’est exactement ce que décrit le psychologue américain Barry Schwartz dans « Le Paradoxe du choix : pourquoi moins, c’est plus » : plus de choix signifie, sur le papier, plus de liberté — un bénéfice objectif. Mais au-delà d’un certain seuil, cette liberté se transforme en anxiété, regret anticipé et insatisfaction chronique. Le plaisir initial de la diversité devient une corvée, un tri permanent qui rogne l’élan spontané de découverte. Cette analyse rejoint celle de Bruno Patino, pour qui la surabondance numérique réduit le plaisir, dévalorise chaque expérience et nourrit une forme d’épuisement attentionnel.
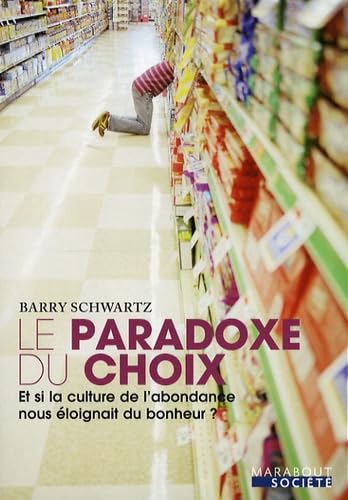
II. Nourritures spirituelles ou fast-food intellectuel ?
Je dois tout de même reconnaître une part d’ambiguïté dans mon propos. Je critique cette profusion, mais je m’en repais tout autant. J’aime, moi aussi, avoir à portée de main des films introuvables autrefois, des archives musicales, des essais rares — et le tout dans une qualité technique inimaginable il y a vingt ans : 4K, HDR, musique lossless, podcasts en haute résolution. Cette abondance et cette qualité m’ont permis de découvrir des artistes et des idées que je n’aurais jamais croisés autrement. En d’autres termes, je bénéficie pleinement de ce que je déplore : je suis à la fois critique et cobaye de cette culture illimitée, tout comme Bruno Patino le confesse pour lui-même dans Submersion. C’est peut-être cette contradiction, plus qu’un rejet frontal, qui donne à cette réflexion son caractère nécessaire. Comme je le disais, je m’alimente de la culture, et je ne suis pas le seul. Loin de là. De nombreux penseurs en ont fait les éloges.
Paul Valéry parlait déjà de « nourritures spirituelles », tandis que Nietzsche voyait dans la musique une nécessité vitale, allant jusqu’à écrire : « Sans la musique, la vie serait une erreur ». Et ce n’est qu’un échantillon. Depuis l’Antiquité, l’idée revient sous des formes diverses : Aristote évoquait la tragédie comme une purge émotionnelle (catharsis) indispensable à l’équilibre de l’âme ; Platon parlait de la beauté comme d’un rappel de l’idéal qui nourrit l’âme et l’élève. Plus près de nous, au XIXe et XXe siècles, Proust voyait dans l’art une révélation de l’essence du monde, Virginia Woolf qualifiait la littérature de condition matérielle et spirituelle pour exister comme individu pensant, et Camus décrivait l’art comme un « contrepoids » à l’absurde, un moyen de résister à l’écrasement du réel. Tous s’accorde sur le fait que la culture nourrit, met en mouvement, alimente nos vies intérieures et collectives. Sans elle, beaucoup d’entre nous s’essouffleraient, tomberaient en panne sèche. Pourtant, alors qu’elle agit comme un moteur invisible pour tant de personnes, elle reste rarement pensée comme une priorité politique. Dans les discours, on l’évoque volontiers comme un ornement, un supplément d’âme, un domaine de prestige. Mais rarement comme une nécessité vitale, au même titre que l’éducation, la santé ou l’énergie.
Pourtant, comme toute nourriture, la culture peut aussi saturer. Trop de nourritures spirituelles peuvent finir par produire l’effet inverse : l’indigestion. À force d’accumuler albums, séries, podcasts, articles, on ne digère plus rien ; on picore sans assimiler, sans âme. La métaphore n’est pas nouvelle : il suffit de regarder nos menus de plateformes comme un buffet à volonté où l’on remplit son assiette bien au-delà de sa faim réelle. Ce trop-plein brouille l’appétit, dilue l’émerveillement et rend difficile l’appropriation intime des œuvres. La culture reste un carburant vital — mais, comme tout carburant, elle exige aussi des pauses, du recul, un temps de combustion lente pour qu’elle produise son énergie.
III. De l’œuvre au “contenu” : la bascule consumériste
À l’opposé d’une cohabitation salutaire et vertueuse — sur laquelle je reviendrai plus loin — on en vient à voir la culture comme un bien de consommation comme un autre. Moi-même, j’utilise spontanément ce mot. Consommer la culture évoque un acte rapide, utilitaire, presque industriel. Et c’est bien là le problème : la culture est à la fois un produit de consommation — on marchande des propositions, on fait du marketing, on vend des abonnements — et un objet symbolique. Consommer la culture, c’est considérer l’œuvre comme un « contenu » qu’on ingère, qu’on épuise, puis qu’on remplace, et non comme une expérience qui se vit, se digère, se transforme. Le numérique et la dématérialisation, en donnant une sensation accrue d’abondance, ont changé l’échelle et le rythme de notre rapport à la culture.
📦 Pas de côté : réflexion sur le mot « contenu » — du support à la substance
Tout est parti d’une discussion avec mon père, mi-amusé mi-agacé de voir le mot « contenu » s’imposer partout. Pour lui, me semble-t-il, il dévalorise l’œuvre ; pour moi, il n’est qu’un terme neutre pour désigner une substance intellectuelle ou émotionnelle, indépendamment de son support.
Avant : les mêmes objets existaient — livres, disques, cassettes, programmes télé — mais ils étaient enregistrés, gravés, pressés sur des supports physiques. Leur matérialité donnait un cadre, un rythme, une rareté… une visibilité ?
Aujourd’hui : tout devient « contenu » : un flux compressé, liquide, standardisé. La hiérarchie entre l’album studio et la vidéo amateur s’efface au profit d’un seul terme. L’œuvre n’est plus un bloc identifié, mais un item dans un catalogue infini.
Ce que cela change :
– D’un côté, on perd assurément un peu l’aura et le rituel (acheter, ouvrir, attendre). Ce que moi, je retrouve encore avec le jeu vidéo que j’ai tendance à continuer à acheter en format physique, quand c’est possible.
– De l’autre, on gagne une fluidité et une démocratisation inédites.
– Le mot « contenu » reflète à la fois l’appauvrissement du vocabulaire et la puissance d’un monde où la forme compte moins que la disponibilité. A titre personnel, je fais vraisemblablement encore partie d’une génération qui accepte cette ultime mutation.
Entre ironie et agacement, la remarque de mon père me rappelle qu’avec ce mot, nous avons glissé d’un imaginaire du support à un imaginaire de la substance. Un mot qui semble anodin mais qui dit beaucoup de notre époque.
Cette bascule d’une culture davantage consommée peut aussi se lire sous l’angle économique. Historiquement, la culture oscille entre bien rival et bien non rival. Autrefois, un disque, un livre, un ticket de concert étaient rivaux : un exemplaire acheté était un exemplaire en moins pour les autres. Avec la dématérialisation, un fichier musical ou un film en streaming devient quasiment non rival : le coût marginal d’un accès supplémentaire est proche de zéro. Pourtant, les plateformes recréent artificiellement la rivalité — abonnements, DRM, restrictions territoriales — pour maintenir un modèle économique basé sur la rareté. La culture est donc vendue comme un produit de consommation, mais elle conserve, dans sa circulation, une dimension de bien commun. Cette dualité explique notre ambivalence : nous la traitons comme un produit à écouler, mais elle agit sur nous comme une expérience à partager et à transmettre.
Culture liquide et zapping
À l’instar du concept de « modernité liquide » développé par le sociologue polonais Zygmunt Bauman dans son ouvrage éponyme (2000), on peut aussi envisager la culture comme “liquide”. Du matériel à l’immatériel, de l’attente à l’instantanéité, l’expérience culturelle est devenue fluide, volatile, sans ancrage durable. Les œuvres apparaissent et disparaissent des catalogues, nos goûts se déplacent au gré des flux, et le zapping devient notre mode par défaut : on traverse la culture comme on fait défiler un fil d’actualité, plutôt qu’on ne la bâtit comme un patrimoine.
🌊 Focus : La modernité liquide de Zygmunt Bauman
Zygmunt Bauman (1925-2017), sociologue polonais, a popularisé le concept de « modernité liquide » pour désigner l’évolution des sociétés contemporaines. Par opposition à la modernité « solide », stable et institutionnalisée du XXe siècle, la modernité « liquide » se caractérise par la mobilité, l’instabilité et l’éphémère.
Modernité solide
Définition : institutions stables, hiérarchies durables, repères collectifs fixes.
Exemples :
– Travail et carrières de long terme ;
– Identités sociales ancrées (classe, religion, nation) ;
– Culture matérialisée dans des supports physiques (livres, disques, cinéma en salle).
Modernité liquide
Définition : flux continus, flexibilité permanente, identités changeantes.
Exemples :
– Emplois précaires et reconversions multiples ;
– Réseaux sociaux et communautés éphémères ;
– Culture dématérialisée (streaming, contenus « à la demande »).
Pourquoi c’est important
– Tout devient provisoire : liens, objets, œuvres et même valeurs.
– L’accès illimité remplace la possession, mais fragilise l’ancrage et l’attachement.
– La « culture liquide » : l’art, les médias et le savoir circulent désormais comme des flux continus, toujours disponibles et aussitôt oubliés, illustrant parfaitement l’idée de Bauman.
IV. Pris au piège des flux

La captivité culturelle d’aujourd’hui dépasse largement la seule économie de l’attention. Nous vivons avec l’impression d’être pris au piège du flux : peur de rater, injonction à suivre tout dans l’urgence. Cette urgence tient à la crainte d’être « spoilé », de ne pas être dans la tendance — mais aussi à une logique plus pragmatique : celle qui condamne la suite d’une œuvre si elle ne trouve pas son public tout de suite. Les plateformes de SVOD (Subscription Video On Demand), surtout elles, utilisent des algorithmes de rétention qui mesurent en temps réel si une proposition « prend » ou non. Sous le concept du « 28-day viewing », Netflix par exemple évalue :
- Nombre de démarrages (combien d’abonnés lancent le programme dès les premiers jours) ;
- Taux de complétion (quelle proportion regarde l’épisode ou le film jusqu’au bout) ;
- Fidélité (combien reviennent pour le deuxième épisode dans la semaine suivante) ;
- Effet sur la rétention d’abonnés (le programme a-t-il retenu des abonnés sur le point de partir ?) ;
- Écho social (tendances, bouche-à-oreille, critiques).
Ces métriques ne sont pas abstraites : pour un blockbuster Netflix, on vise souvent plusieurs dizaines de millions de comptes dans les 28 premiers jours (Squid Game : plus de 100 millions ; The Witcher : 76 millions), et pour une série plus modeste, 10 à 20 millions peuvent suffire. Ainsi, dans l’ombre, un chronomètre invisible tourne : le premier mois qui suit le lancement est absolument critique pour décider si une série sera mise en avant, prolongée ou annulée. Passé ce délai, ce qui n’a pas « performé » est déréférencé, retiré du carrousel algorithmique, parfois abandonné. Pour les séries à diffusion hebdomadaire, la logique n’est pas très différente : la plateforme mesure semaine après semaine le nombre de spectateurs qui reviennent, le taux de complétion et l’écho social. Les premiers épisodes sont cruciaux : si le public décroche, l’algorithme relègue la série. Le modèle hebdomadaire ne change donc pas la pression ; il la dilue dans le temps tout en maximisant l’abonnement.
Résultat : notre temps est limité. Avant même de regarder quelque chose qui nous intéresse, nous avons généralement déjà des choses en cours. Les plateformes, elles, ne nous laissent pas le temps : leur logique exige une réaction quasi immédiate. Je ressens parfois que, en ne regardant pas tout de suite une série que j’attendais pourtant depuis longtemps, je deviens complice de son échec — comme si mon seul comportement, comptabilisé dans cette fenêtre critique, pouvait faire pencher la balance. Certains amis me disent : « moi j’attends que toutes les saisons sortent pour tout voir d’un coup. » Mais ce réflexe, parfaitement compréhensible, est aussi paradoxalement le meilleur moyen qu’aucun projet ne soit mené à terme : en attendant, on affaiblit les signaux d’engagement qui décident de la survie d’une série. Cette situation crée une forme de chantage implicite : il faut consommer vite pour sauver ce que l’on aime, au risque sinon de le voir disparaître. Ce mécanisme est à son paroxysme dans la SVOD, mais l’audimat et les ventes immédiates restent tout aussi décisifs ailleurs. Qu’il s’agisse d’un film, d’un album ou d’un livre, le succès se mesure désormais dans les jours ou semaines qui suivent sa mise en ligne ou sa parution. C’est dans cette fenêtre réduite que se joue la survie ou la visibilité d’une proposition culturelle.
L’abondance culturelle induit aussi d’autres types de captivités. La captivité des algorithmes de recommandation, d’abord : à force d’optimiser ce que nous “devrions aimer”, ces systèmes finissent par nous enfermer dans une bulle culturelle où les genres, les styles et les goûts se lissent. Pour briser cette routine d’appauvrissement, j’ai parfois le réflexe de chercher un genre à l’opposé de ce que je regarde habituellement ; et si la langue est très éloignée de la mienne — ce qui sous-entend une culture radicalement différente — c’est encore mieux. Vient ensuite la captivité du “tout visible”, ou « captivité par l’infini ». Alors qu’autrefois, aller chez le libraire ou le disquaire impliquait un choix localisé dans le temps et l’espace, aujourd’hui l’immensité de l’offre nous accompagne en permanence, dans notre poche. Cette omniprésence peut donner un vertige de liberté, mais elle produit aussi l’anxiété de l’inachevé : impossible de tout explorer.
La captivité de l’auto-optimisation culturelle est un autre piège — et j’en suis l’une des victimes les plus notables. Je me surprends à nourrir un fantasme de complétion : vouloir tout lire, tout voir, tout écouter. Les outils de listing — Goodreads, Letterboxd, MyAnimeList — encouragent cette logique : on y coche des cases, on mesure des progrès, on aligne des notes, parfois au détriment de l’expérience vécue. Il y a aussi la captivité de l’identité sociale : être à jour, connaître toutes les ramifications d’un univers de fiction, devient un signe d’appartenance. Ne pas avoir vu la série du moment, c’est risquer l’exclusion de la conversation collective. La captivité de l’interface est plus subtile : nous sommes contraints de naviguer dans des menus standardisés, des vignettes semblables, des scrolls infinis. Nous ne flânons plus dans un espace matériel, nous passons d’une grille à l’autre. L’interface structure notre désir, impose un rythme visuel et cognitif. La captivité des droits et licences ajoute une dimension de précarité : un film, un album, un jeu peuvent disparaître du jour au lendemain pour des raisons contractuelles. Dans ce régime de location permanente, nous ne possédons plus vraiment nos œuvres, nous n’avons qu’un accès conditionnel et réversible. Enfin, il y a la captivité de l’injonction au commentaire. La culture est devenue performative : il faut liker, partager, poster, réagir. On ne se contente plus de vivre une œuvre ; on doit l’afficher. L’attention donnée ne suffit plus, il faut la signifier publiquement — ce qui transforme le spectateur en agent marketing malgré lui.
Culture comprimée, chemin détourné et offensive contre la captivité
Pour lutter contre cette captivité, de nombreuses astuces — voire de véritables industries — se sont développées. Moi-même, j’utilisais jusqu’ici l’IA pour lire des textes d’auteurs anciens (et parfois imbuvables, à mes yeux) : j’ai ainsi confié à l’IA l’intégralité d’ »À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust afin d’en extraire un condensé du propos et des symboliques sous-jacentes. En explorant cette pratique, j’ai découvert une économie florissante autour de la “culture compressée”. Des services comme Blinkist à l’international, ou Koober en français, promettent de résumer en quinze minutes des ouvrages de plusieurs centaines de pages. Dans l’audio, le même principe se retrouve avec les “podcasts digest” (digest = “condensé”), qui compressent des podcasts existants ou agrègent plusieurs émissions pour en livrer l’essentiel. J’y vois une idée excellente tant certains podcasts s’étalent sur une heure ou plus (et, à mon sens, ratent un peu leur cible : l’actif multitâche qui cherche des informations rapidement) : ces formats courts jouent le rôle de cartographie et d’accès rapide dans l’océan culturel. Mais je ne peux m’empêcher d’y voir là un paradoxe : si tout le monde utilisait Koober ou Blinkist, plus personne ne lirait les livres complets — et plus personne n’en écrirait. Les résumés vivent du travail des auteurs, mais à trop comprimer la culture, on risque de faire disparaître la source même qui la nourrit.
Après les condensateurs viennent les filtres. Il y a la presse spécialisée et surtout les sites participatifs comme l’excellent SensCritique — où j’ai moi-même proposé quelques critiques et on l’on retrouve des listings inspirants du genre « les x livres/films/etc à avoir vu/lu avant de mourir » —, le sympathique Babelio pour les livres ou encore AlloCiné pour le cinéma et les séries. Mais il y a aussi un gain de temps considérable avec certaines chaînes YouTube. Dans le lot, il y a de quoi faire gagner beaucoup de temps en faisant ressortir soit ce qui mérite d’être explorer dans un océan à la qualité variable. À cet arsenal viennent s’ajouter aujourd’hui d’autres tactiques : l’envie assumée de ralentir (slow culture, quotas personnels, relectures), l’usage d’outils d’anti-flux (newsletter choisie plutôt qu’algorithme imposé), les initiatives collaboratives (clubs, forums, listes partagées), ou encore la mémoire active (carnets, cartes mentales, IA créative). Autant de pratiques transversales qui forment un troisième étage dans l’offensive contre la captivité : non plus seulement compresser ou filtrer, mais aussi reprendre la main sur son rythme, ses critères et sa trace.
V. S’ancrer dans l’océan culturel

Passer de la consommation à l’appropriation : dit comme ça, c’est séduisant. On sait ce que cela suppose : ralentir, être plus sélectif, se rendre pleinement présent à ce que l’on fait. Mais dans un univers culturel saturé d’offres, cette injonction à la lenteur se heurte à mon propre rythme intérieur. « Y aller plus lentement » revient presque à me contraindre, à lutter contre ma dynamique naturelle. Mon fonctionnement spontané est celui d’une curiosité rapide, énergique, euphorique, d’une envie quasi physique d’être en permanence imprégné de nouvelles sollicitations émotionnelles et intellectuelles.
Dans ce contexte d’abondance culturelle, « habiter » devient donc un effort, une tension entre deux pôles : d’un côté le fantasme d’une immersion longue et patiente ; de l’autre la satisfaction intense d’un flow permanent, ce flux sensoriel et cognitif que j’ai déjà évoqué dans mon texte sur l’économie de l’attention. Mais peut-être qu’habiter la culture n’est pas seulement une affaire de lenteur : c’est aussi une affaire d’épaisseur. Revenir, noter, relier, créer — bref, donner à ce qui passe vite la possibilité de s’ancrer. C’est là que je tiens peut-être ma propre stratégie face à l’océan culturel. Plutôt que de ralentir à tout prix, je pratique un débrief régulier après mes expériences culturelles, qu’elles soient solitaires (lecture, jeu vidéo…) ou collectives (musique, film, série…). Couplée à un désir quasi systématique de comprendre les motivations et les symboliques de ce que je vis, cette pratique crée un contrepoids à ma frénésie : elle transforme la vitesse en densité, elle installe un ancrage dans un environnement conçu pour m’enchaîner à la dispersion.
Je profite de cet espace pour m’interroger à présent sur la façon dont quelques penseurs s’approprient l’idéal d’« habiter la culture ». Prenons Michel de Certeau, par exemple. Historien et jésuite, il publie en 1980 « L’invention du quotidien« , un ouvrage devenu classique de la sociologie culturelle. Il y montre que la consommation culturelle n’est jamais passive : les individus bricolent, détournent, adaptent, inventent des manières d’utiliser les codes et les espaces imposés. Habiter la culture, pour lui, c’est exercer cette micro-créativité quotidienne qui transforme le « prêt-à-consommer » en pratique singulière.
Le sociologue Pierre Bourdieu, à travers son fameux concept d’habitus, insiste sur le caractère incorporé de la culture. Professeur au Collège de France et auteur de « La distinction » (1979), il analyse la façon dont nos goûts, nos réflexes et nos jugements sont formés par nos trajectoires sociales. Habiter la culture n’est pas, selon lui, un choix extérieur ; c’est déjà l’espace intérieur de nos dispositions et de nos manières de faire. Le philosophe Martin Heidegger, dans son texte « Bâtir, habiter, penser » (1951), élargit encore le cadre. Figure centrale de la phénoménologie allemande, il conçoit « habiter » non pas seulement comme occuper un lieu, mais comme prendre soin et co-appartenir à ce qui nous entoure. Habiter la culture, dans cette perspective, c’est se savoir engagé dans un monde commun, et non y circuler en touriste. Enfin, Paul Ricœur, philosophe français prolifique, insiste sur l’appropriation et l’« identité narrative » : dans ses grands ouvrages (« Temps et récit », « Soi-même comme un autre« ), il montre comment les récits et les symboles façonnent notre identité. Habiter la culture, c’est entrer dans ce jeu où l’on devient à la fois interprète et acteur. J’aime beaucoup cette vision, que je partage : nous ne sommes pas seulement des spectateurs, mais des passeurs et des auteurs de ce que nous recevons.
VI. Entre profusion et captivité : quel avenir pour la culture ?
Le panorama que je dépeins ici peut donner l’impression d’une noirceur absolue. Mais il serait malhonnête d’ignorer l’autre versant : cette caverne d’Ali Baba offre aussi des avantages immenses. La question que je dois me poser après tout cela, c’est : ai-je vraiment envie — et avons-nous encore la possibilité, autre que matérielle — de revenir en arrière ? Car si l’on accepte que la culture est passée d’un produit à un service – ce que j’ai fait depuis bien longtemps -, l’abondance culturelle devient aussi une démocratisation sans précédent. Là où, hier, posséder quelques disques ou livres exigeait un budget conséquent, on peut aujourd’hui écouter quasi toute la musique mondiale pour dix euros par mois ; voir des films rares, lire des auteurs oubliés pour quelques euros de plus. Pour un prix mesuré et, surtout globalement fixes, nous avons accès à des catalogues qui étaient autrefois réservés aux médiathèques universitaires ou aux collectionneurs. Il reste seulement à ne pas trop se disperser en multipliant les abonnements, surtout dans l’audiovisuel.
Cette offre foisonnante a aussi permis à des milliers de créateurs d’exister, d’être publiés, streamés, visibles sans passer par les circuits traditionnels. Mais en même temps, en rendant le secteur si dynamique qu’on se croirait sur une plage méditerranéenne en plein cœur de l’été, elle crée des embouteillages et des histoires qui ne finissent pas toujours bien. Cette abondance est sans doute l’une des raisons pour lesquelles je ne me suis jamais lancé dans l’écriture à vocation commerciale. Déjà parce que je ne m’estime pas posséder le talent nécessaire, mais aussi parce que la simple vision de cette offre pléthorique me fatigue d’avance : elle donne le vertige avant même d’avoir commencé.
Ainsi, au final, ce sont peut-être les acteurs de la culture eux-mêmes qui deviennent les premiers perdants de cette multiplication incessante de propositions. À force de saturer l’espace, ils épuisent l’attention et fragilisent leurs propres créations. Comme un fleuve en crue, l’économie culturelle poursuit sa croissance, emportant tout sur son passage. Si je ne peux plus naviguer dans ce courant, je continuerai tout de même à tendre la main pour saisir, au vol, quelques éclats d’œuvres qui me sembleront essentiels, histoire de revenir à ce qui m’importe le plus : me sentir vivant.
VII. Sources et ressources
🔍Sources externes
- Données liées à la rentrée littéraire 2025 en France/Francophonie
- Nombre estimé de films réalisés en 2023 dans le monde
- Nombre de morceaux uploadés quotidiennement sur Spotify
- Nombre de jeux vidéos publiés sur la plateforme Steam en 2024
- Article du Monde, de Michel Guerrin, actuel rédacteur en chef, sur le livre de Bruno Patino « Submersion »
📚 Lectures et références clés
- Bruno Patino – « La civilisation du poisson rouge » (2019), « Tempête dans le bocal » (2021), « Submersion » (2024)
- Barry Schwartz – « Le paradoxe du choix : pourquoi moins c’est plus » (2004, trad. fr. 2009)
- Walter Benjamin – « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (1936, première publication dans une revue)
- Michel de Certeau – « L’invention du quotidien » (1980)
- Pierre Bourdieu – « La distinction : critique sociale du jugement » (1979)
- Martin Heidegger – « Bâtir, habiter, penser » (1951)
- Paul Ricœur – « Temps et récit » (1983-1985), « Soi-même comme un autre » (1990)
- Zygmunt Bauman – « Vie liquide » (2000)
🛠️ Outils et pratiques mentionnés
- Blinkist, Koober (résumés de livres)
- SensCritique, Babelio, AlloCiné (sites participatifs)
- Notion, Obsidian, Zotero (organisation et mémoire active)
🎨 Notions / concepts utiles

Charte de transparence IA
🧠 Idée : 100 % humaine. L’idée m’est venue en observant la déferlante de livres de la rentrée 2025. J’ai voulu explorer ensuite cette ambivalence que nous vivons – que je vis – face à cette abondance inédite.
📁 Structure : Le plan général a été proposé par l’IA à partir de mes notes. Comme toujours, au fil de la construction, de nouvelles voies se sont imposées.
✍️ Rédaction : Texte rédigé par l’auteur, relectures et reformulations par l’IA.
🎨 Illustrations : Image à la une et image du curieux concentré sur une peinture dans un musée générées avec l’IA. Le reste vient du Web intersidéral.
Intervention globale de l’IA estimée : 55 %




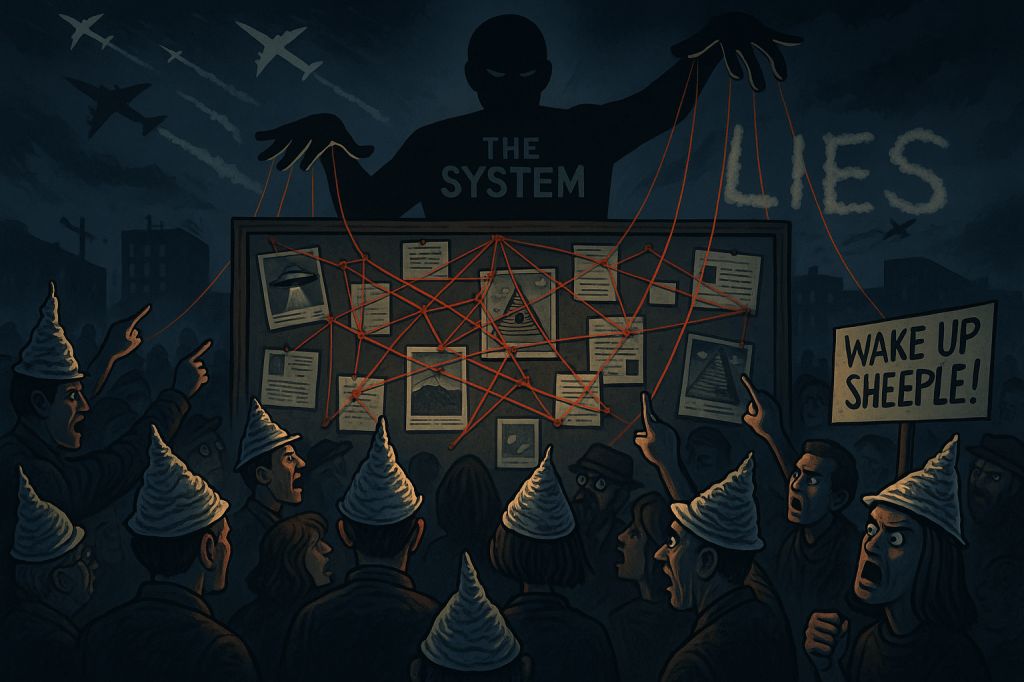


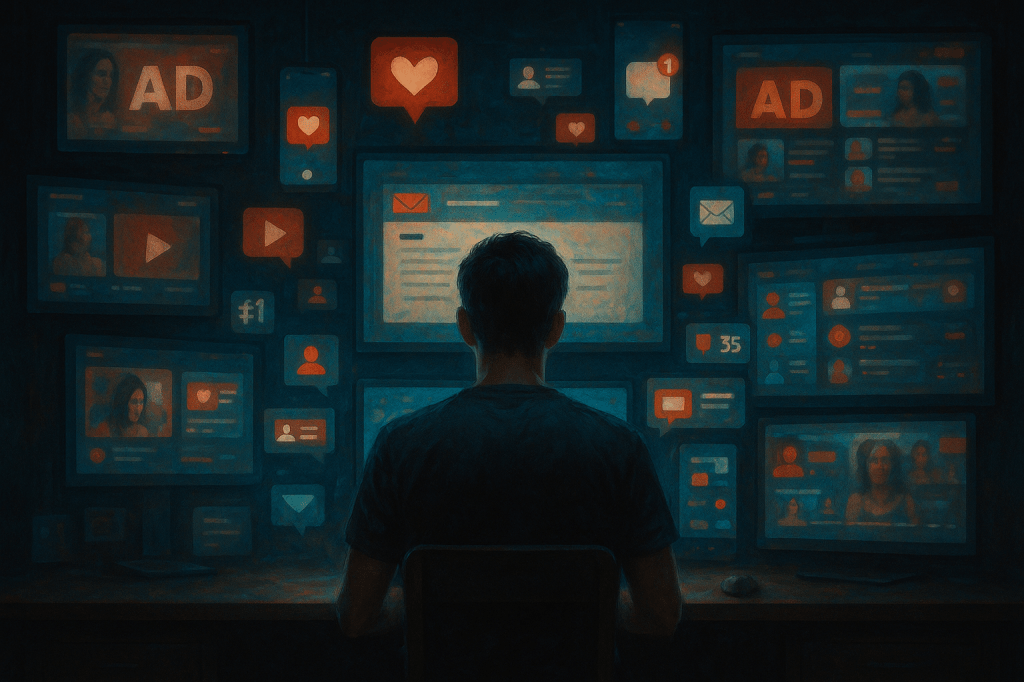
Laisser un commentaire