Nos perceptions sont traversées de biais invisibles qui nous placent toujours au centre : de nous-mêmes, de notre culture, de notre espèce, jusqu’à l’univers entier. En explorant ces strates, du plus intime au plus cosmique, ce texte interroge la déformation — et l’orgueil — qui orientent notre rapport au monde, tout en croisant des notions comme l’Anthropocène, la terraformation et nos projections fictionnelles.
- I. Soi — Égocentrisme et présentisme personnel
- II. Entourage proche — Sociocentrisme intime et proximité temporelle
- III. Communauté, ville ou région — Provincialisme
- IV. Nation / Culture — Ethnocentrisme et mythe national
- V. Humanité — Anthropocentrisme et chronocentrisme humaniste
- VI. Planète Terre — Géocentrisme et présentisme géologique
- VII. Univers / Cosmos — Cosmocentrisme et présentisme cosmique
- VIII. Ce que disent les biais de centralité de notre humanité
- IX. Ressources pour aller plus loin
Toute perception part de soi — c’est d’une logique implacable. Entre ce point de départ et le vaste monde, il existe une série de filtres : ces biais cognitifs pour lesquels, vous le savez, j’ai un faible assumé. Ici, j’aimerais explorer ce que j’appelle les biais de centralité. Du plus proche – au travers de l’égocentrisme – au plus lointain – via le cosmocentrisme -, ils tracent une graduation spatiale : ma personne, mon entourage proche, ma ville, mon pays, mon espèce, ma planète… jusqu’à notre place dans l’univers. Mais cette centralité ne se joue pas seulement dans l’espace : elle s’exprime aussi dans le temps, avec le présent comme pivot, comme centre invisible autour duquel gravitent passé et futur. L’exercice d’externalisation de soi est toujours quelque chose d’assez périlleux mais également très intéressant pour se décentrer et analyser notre comportement de la façon la plus neutre possible. Plusieurs disciplines s’y sont certes déjà essayés mais je tente une approche plutôt inédite ici avec une projection linéaire par cercles successifs sur le plan, donc, spatial et temporel.
Sur le centrisme spatial, parmi les ancrages théoriques connus, la psychologie sociale a largement exploré ce mécanisme à travers ce que l’on appelle le décalage de perspective interne et externe (self-distancing en anglais) : il s’agit de se percevoir comme si l’on était un observateur extérieur de soi-même. Cette posture, étudiée notamment par Ethan Kross et Özlem Ayduk (2011), est utilisée en thérapie pour prendre du recul et mieux réguler ses émotions. En philosophie, Thomas Nagel a formulé l’idée d’un passage du point de vue subjectif au point de vue universel dans The View from Nowhere (1986), tandis que Jean Piaget, en psychologie du développement, parlait de décentrement pour désigner la capacité à quitter l’égocentrisme cognitif afin de considérer d’autres perspectives. En anthropologie, Claude Lévi-Strauss évoquait un décentrement culturel, indispensable pour appréhender une culture étrangère selon ses propres codes et non à travers le prisme de l’ethnocentrisme. En sociologie, Pierre Bourdieu insistait sur la réflexivité : prendre conscience de sa propre position sociale et des biais qu’elle induit, condition nécessaire pour produire une analyse moins prisonnière de ses déterminismes. Les sciences cognitives, quant à elles, parlent de métacognition : la capacité à se penser en train de penser, à évaluer et ajuster ses propres processus mentaux, ce qui constitue l’une des clés du décentrement intellectuel. Enfin, certaines pratiques méditatives, notamment la pleine conscience (mindfulness), visent à observer pensées et émotions comme des phénomènes extérieurs, sans identification ni jugement, cultivant ainsi une forme d’extériorité intérieure proche du self-distancing.
Sur le centrisme temporel, plusieurs ancrages théoriques permettent d’en éclairer les mécanismes. En psychologie cognitive, on parle de présentisme (Tversky & Kahneman, 1974 ; Gilbert & Wilson, 2007) : la tendance à juger le passé et à anticiper l’avenir à partir de l’état émotionnel, des valeurs et des connaissances du moment présent, oubliant que nos perceptions évoluent. Les sciences de la décision y rattachent la préférence temporelle ou actualisme : accorder plus de poids aux bénéfices immédiats qu’aux gains différés, au détriment d’une vision de long terme. En histoire, François Hartog a conceptualisé le régime d’historicité présentiste, où le présent devient la référence centrale, reléguant passé et futur à des horizons flous ou instrumentalisés. En philosophie, Hans Jonas appelait au contraire au principe responsabilité orienté vers le futur, en particulier à l’ère technologique, pour contrer ce biais d’ancrage dans le présent. Les sciences sociales et politiques parlent aussi de myopie temporelle : un rétrécissement de l’horizon d’anticipation, favorisé par les cycles électoraux courts, l’accélération médiatique et l’instantanéité numérique. Enfin, certaines traditions spirituelles invitent à un rapport élargi au temps : non pas se fondre dans l’instant au point d’ignorer les leçons du passé ou les conséquences futures, mais habiter le présent comme un point d’équilibre conscient entre mémoire et projection.
I. Soi — Égocentrisme et présentisme personnel
Je ne suis pas bien différent des autres : mon niveau d’égocentrisme fluctue, mais il est bien là. Ma tendance naturelle est de percevoir le monde en fonction de ma propre trajectoire, de mes besoins, de mes priorités. Les autres deviennent alors, consciemment ou non, des figurants de mon récit personnel — parfois même de simples obstacles sur ma route. Cette façon de voir n’est pas sans lien avec ce que j’ai décrit dans mon texte sur le syndrome de Truman, lorsque j’évoquais ma vision du “syndrome du PNJ” : considérer certains comme de simples personnages secondaires, dont la fonction est limitée à leur rôle dans mon propre scénario.
Je le constate dans des situations pourtant triviales. Sur la route, j’ai souvent le sentiment que toutes les voitures sont là pour me ralentir, comme si la circulation se densifiait exprès autour de moi. Même réflexe face à une foule : récemment, devant la file interminable pour une exposition consacrée au peintre d’estampes japonaises Katsushika Hokusai, à Nantes, j’ai ressenti un agacement disproportionné. Une pensée absurde m’a traversé : « C’est impossible que tout ce monde soit vraiment passionné par le Japon ! » Comme si, par un étrange raccourci mental, la présence des autres n’était légitime que si elle rejoignait mes propres goûts ou objectifs. Ce décalage me frappe toujours a posteriori : à chaud, l’émotion semble fondée, presque rationnelle ; à froid, elle révèle toute la petitesse de cette vision centrée sur soi, qui transforme une situation neutre en offense personnelle.
L’égocentrisme, si souvent pointé du doigt, est pourtant l’un des traits les plus universels qui soient. Il découle d’un mécanisme psychologique de base : notre perception et notre cognition partent inévitablement de nos propres sens, émotions et expériences. Mais si tous les biais de centralité déforment notre vision du monde, l’égocentrisme est sans doute l’un des plus pénalisants sur le plan cognitif : il réduit notre capacité à intégrer d’autres perspectives, à remettre en question nos idées et à enrichir notre vision du monde. Plus l’ego occupe la scène, moins il laisse de place à la curiosité, à l’apprentissage et à la transformation personnelle.
Sur le plan temporel, ce biais trouve son équivalent dans le présentisme personnel : la tendance à accorder une importance disproportionnée à ce que je vis maintenant, au détriment du recul historique ou de la projection vers l’avenir. Ramener tout à soi, tout le temps, et tout à son temps, c’est réduire le monde à la taille d’une cellule : confortable, peut-être, mais close. On reste alors prisonnier de son propre moment, incapable d’intégrer pleinement les leçons du passé ou d’anticiper les perspectives futures. J’en fais moi-même l’expérience : il m’arrive de perdre mon sang-froid face à une situation donnée, obsédé par la micro-seconde qui vient de s’écouler. L’événement prend alors toute la place, comme s’il résumait à lui seul l’instant présent — impossible, sur le moment, de mobiliser le recul pourtant nécessaire pour relativiser.
Si je fais un rapprochement avec d’autres biais que l’égocentrisme, il y a d’abord le biais du protagonisme, que l’on retrouve également dans le syndrome de Truman : se percevoir comme le personnage principal du scénario global. Il y a aussi le biais d’auto-référentialité, qui désigne la tendance à relier spontanément les événements, informations ou comportements observés à soi-même. C’est le réflexe mental qui pousse à se demander « Qu’est-ce que ça dit de moi ? », « En quoi ça me concerne ? », même si le lien est objectivement faible ou inexistant. Cette tendance se traduit au quotidien, par exemple, lorsqu’on voit deux personnes rire et que l’on suppose qu’elles se moquent de nous, ou lorsque l’absence de réponse à un message est interprétée comme un signe de désapprobation. Sur le plan temporel, l’équivalent direct de ce biais est le biais de récence : la tendance à privilégier les informations récentes. Par exemple, lors d’un entretien, un recruteur est souvent plus influencé par la performance du candidat sur les dernières questions que par ses réponses initiales.
Comment s’en prémunir ?
De tous les biais de centralité, l’égocentrisme est assurément le plus coriace car il est enfermé dans un corps solitaire, un point de vue unique et une temporalité. Il prospère dans un huis clos dont nous sommes à la fois l’acteur, le scénariste et le spectateur. Et comme nul ne peut sortir de soi pour se regarder vivre en permanence, il n’existe pas d’angle mort plus difficile à cartographier. Eradiquer l’égocentrisme — ou du moins le restreindre — peut se fait via trois leviers :
- La mise à distance volontaire – Pratiquer l’auto-questionnement et s’efforcer d’adopter la perspective d’un observateur extérieur. Presque impossible lorsque l’ego est en pleine action : ceux qui souffrent le plus d’égocentrisme sont souvent les moins enclins — et les moins disposés — à remettre en question leur vision du monde.
- L’élargissement du contexte – Replacer un événement dans un cadre plus vaste : historique, social, collectif… pour en relativiser l’importance. Cela exige une force mentale rare : reconnaître ses propres biais et admettre que leurs effets sont nuisibles, autant pour soi que pour les autres.
- L’exposition à l’altérité – Multiplier les interactions, les expériences et les lectures qui sortent de sa zone d’intérêt immédiate. Un exercice salutaire que je recommande vivement à quiconque veut fissurer la bulle de ses certitudes.
II. Entourage proche — Sociocentrisme intime et proximité temporelle
Avec le sociocentrisme, on change d’échelle : c’est la première strate qui relève pleinement de l’analyse sociologique. L’égocentrisme appartient au domaine psychologique, celui des mécanismes mentaux individuels. Le sociocentrisme, lui, n’existe qu’au contact des autres : il se nourrit des appartenances, des loyautés et des frontières entre groupes. Il trouve sa racine dans l’un des fondements de l’espèce humaine : la vie en groupe, indispensable à notre survie pendant des millénaires. Mais ce réflexe protecteur peut se muer en biais, lorsque l’attachement au groupe se traduit par la propension à placer celui-ci — famille, cercle d’amis, clan, communauté restreinte — au centre de l’échelle de valeurs et d’interprétation du monde. Ce mécanisme rejoint l’effet d’endogroupe : favoriser spontanément les membres de son propre groupe, même sans conflit réel ni raison objective. On leur prête plus de qualités (compétence, moralité, intelligence…), on pardonne plus facilement leurs erreurs, on leur accorde davantage de confiance et d’opportunités, tandis que l’exogroupe est plus volontiers stéréotypé ou dévalorisé.
🔍 Focus : Endogroupe et Exogroupe
Endogroupe : ensemble auquel on s’identifie et auquel on accorde spontanément des qualités positives. Il peut être basé sur des liens de sang, une appartenance culturelle, professionnelle, religieuse, politique… ou même sur un simple goût partagé (club de lecture, équipe sportive, fandom).
Exogroupe : ensemble perçu comme extérieur ou différent, auquel on attribue plus facilement des défauts, une moindre fiabilité, voire une hostilité latente. L’exogroupe n’est pas forcément un “ennemi” déclaré — il peut simplement être “les autres”.
Mécanisme clé : l’effet d’endogroupe désigne notre tendance à favoriser, protéger et excuser les membres de notre endogroupe, tout en étant plus critique ou méfiant envers l’exogroupe. Ce biais fonctionne même en l’absence de rivalité réelle et peut influencer jugements, décisions et comportements quotidiens.
Contrairement à l’égocentrisme, le sociocentrisme renforce l’estime de soi et le sentiment de sécurité. Les exemples sont partout : supporters de football jugeant “injustes” les décisions qui pénalisent leur équipe mais “normales” celles qui touchent l’adversaire ; recruteurs favorisant inconsciemment un candidat issu de la même école ; voisin “du quartier” jugé plus digne de confiance qu’un inconnu. Pour ma part, je n’ai jamais vraiment ressenti cette mécanique de l’intérieur. Je suis le seul Belge dans mon environnement, sans communauté linguistique ou ethnique de rattachement. Même la “communauté” végane, à laquelle je pourrais me sentir lié, est trop dispersée, dans mon quotidien, pour former un bloc cohérent. J’observe donc le sociocentrisme comme un phénomène d’enracinement : familier chez les autres, mais auquel je reste, par nature et par circonstances, étranger.
On retrouve toute une série d’autres biais liés à la dynamique d’endogroupe et d’exogroupe. Il y a, par exemple, le biais de faux consensus, qui nous pousse à surestimer à quel point les autres partagent nos opinions, comportements ou valeurs — surtout au sein de notre propre groupe. Le classique biais de confirmation, lui, nous fait tourner en rond : nous retenons ou interprétons les informations de manière à confirmer ce que nous croyons déjà. J’apprécie aussi particulièrement le biais d’homogénéité de l’exogroupe, qui consiste à penser que “les autres” sont tous pareils, moins nuancés et moins individualisés que “les nôtres”. On peut y ajouter le biais de stéréotypisation, qui attribue à l’exogroupe des traits simplistes et souvent négatifs, même sans expérience directe ou encore l’effet de halo, qui nous pousse à étendre une impression positive ou négative sur un membre de l’endogroupe à l’ensemble de ses caractéristiques. Enfin, il y a le biais d’auto-complaisance collectif, que l’on croise souvent dans certaines passions collectives (comme le football) : quand le groupe gagne, c’est grâce à son talent ; quand il perd, c’est forcément la faute de facteurs extérieurs…
À cela s’ajoute un biais temporel propre à cette logique : nous accordons plus d’importance et de mémoire aux événements récents touchant notre endogroupe qu’à des faits similaires frappant un groupe extérieur. La proximité temporelle renforce ici la proximité émotionnelle : un incident survenu hier à un proche restera longtemps présent à l’esprit, alors qu’un événement équivalent touchant un inconnu sera vite relégué aux oubliettes. Ce mécanisme est le pendant temporel de ce que le journalisme appelle la “mort kilomètre” (death by distance), où la distance géographique réduit l’empathie : plus c’est loin, plus c’est abstrait — et plus c’est récent, plus c’est saillant. En psychologie sociale, la théorie de la distance psychologique (Construal Level Theory) montre d’ailleurs que plus un événement est éloigné — dans le temps, l’espace ou les liens sociaux — plus il devient abstrait et moins il suscite d’émotion. En économie comportementale, l’identifiable victim effect explique pourquoi un cas concret et familier émeut plus qu’une statistique impersonnelle. Toutes ces notions, issues de champs différents, décrivent au fond la même mécanique : nous ressentons, retenons et valorisons davantage ce qui est proche de nous — qu’il s’agisse de temps, d’espace ou d’appartenance sociale. Si la distinction endogroupe/exogroupe accompagne l’humanité depuis ses origines, sa déclinaison numérique est bien réelle — et souvent bien plus biaisée, polarisée et amplifiée que sa version vécue “dans la vraie vie” :
💻 Focus : Le pseudo-sociocentrisme des réseaux sociaux
Sur les plateformes en ligne, on observe une forme de pseudo-sociocentrisme : les dynamiques d’endogroupe/exogroupe y existent, mais elles reposent sur des appartenances artificielles et éphémères. Les communautés se forment autour de causes ponctuelles, de fandoms, de hashtags ou d’oppositions binaires (“pro” / “anti”) et peuvent se dissoudre du jour au lendemain.
Ces “clans” numériques reproduisent les mêmes biais que dans la vie réelle — confirmation, homogénéité de l’exogroupe, auto-complaisance collective — mais sur un mode performé et algorithmique. L’appartenance se résume souvent à un like, un partage ou une photo de profil, sans engagement concret hors ligne.
Surtout, l’effet de bulle informationnelle accentue l’impression d’être toujours entouré de son endogroupe : les algorithmes privilégient les contenus et les points de vue conformes à ceux de notre “camp”, renforçant ainsi la certitude que notre vision du monde est partagée par “tout le monde”… ou du moins, par tous ceux qui comptent.
Comment s’en prémunir ?
- Élargir le cercle mental – S’habituer à inclure des personnes extérieures à son groupe dans ses réflexions et décisions, même symboliquement, pour rompre le réflexe “nous d’abord”.
- Comparer les jugements – Observer si l’on applique la même exigence, la même indulgence et les mêmes critères à l’endogroupe qu’à l’exogroupe. Cette symétrie est un bon test de lucidité.
- Multiplier les ponts entre groupes – Fréquenter volontairement des espaces où plusieurs communautés se croisent (associations, débats, projets collaboratifs), pour nuancer l’image de “l’autre” et réduire l’homogénéité perçue. Exercice très inconfortable puisqu’il vient remettre en cause des croyances enracinées.
- Varier ses sources d’information – Éviter l’entre-soi médiatique qui renforce les biais de confirmation et de faux consensus. Croiser les points de vue, y compris ceux qui contredisent nos repères.
- Prendre de la hauteur contextuelle – Replacer les événements dans un cadre plus vaste (historique, géographique, sociologique) pour éviter de surestimer l’importance de ce qui touche “les nôtres” et de sous-estimer le reste.
- Pratiquer l’inversion des rôles – Imaginer ce que l’on penserait si les situations étaient inversées : notre groupe à la place de l’autre, et vice-versa. Un exercice simple mais souvent inconfortable… donc utile.
III. Communauté, ville ou région — Provincialisme
Si l’on monte d’une strate, on rencontre ce que l’on appelle communément le provincialisme. Le terme recouvre à la fois la loyauté profonde envers sa province ou sa région d’origine — ce que l’on pourrait qualifier de provincialisme horizontal — et l’opposition entre un centre et une périphérie, que l’on pourrait appeler provincialisme vertical. Dans les deux cas, cette tension nourrit à la fois l’attachement au territoire et les fractures internes d’un pays, qu’elles soient culturelles, économiques, politiques ou symboliques.
Le provincialisme vertical repose sur une dynamique de domination et de croyance en la supériorité du centre sur la périphérie. Le centre — souvent la capitale — concentre le pouvoir politique, économique et culturel, et se perçoit (ou est perçu) comme plus moderne, plus légitime, plus “avancé”. La périphérie, en retour, est fréquemment décrite comme en retard, provinciale ou moins “éclairée”. Ce rapport inégal est renforcé par des structures institutionnelles centralisatrices, la concentration des ressources et un traitement médiatique qui valorise le centre tout en invisibilisant ou caricaturant la périphérie. C’est ce que l’on appelle, en géographie urbaine et en aménagement du territoire, la macrocéphalie urbaine.
🏙️ Focus : La macrocéphalie urbaine
Ce déséquilibre territorial résulte souvent d’une combinaison de facteurs : histoire centralisatrice (monarchies absolues, administrations jacobines), concentration des infrastructures de transport et de communication vers la capitale, et effets cumulatifs liés à l’attraction économique, universitaire et culturelle. Une fois enclenché, le phénomène tend à s’auto-renforcer : les talents et les investissements affluent là où les ressources sont déjà concentrées.
Les conséquences dépassent l’aménagement du territoire : sentiment d’invisibilité ou de déclassement dans les régions périphériques, montée des revendications régionalistes, inégalités d’accès aux services publics et aux opportunités, et durcissement des stéréotypes mutuels entre centre et périphérie.
On retrouve ce schéma à des degrés divers dans de nombreux pays : Paris en France, Londres au Royaume-Uni, Buenos Aires en Argentine, Bangkok en Thaïlande… autant d’exemples où la capitale façonne à elle seule une grande partie de l’identité nationale — et alimente, en retour, les ressentiments périphériques.
Concernant le provincialisme vertical, le biais médiatique joue un rôle majeur. Globalement, les médias nationaux — et j’observe particulièrement ce phénomène sur les antennes de Radio France, que j’écoute beaucoup — consacrent davantage de temps, de détails et de moyens aux événements se déroulant dans la capitale, ou, dans une moindre mesure, dans les plus grandes métropoles. Les zones jugées “mineures” apparaissent surtout à travers des sujets gastronomiques ou touristiques… sauf lorsqu’un drame majeur bouleverse tout le pays. L’affaire du viol de Mazan, par exemple, a temporairement braqué les projecteurs sur ce coin du Vaucluse qui, sans cela, serait resté dans l’ombre. Bien sûr, un média national ne peut pas couvrir tout ce qui se passe sur le territoire. Les médias régionaux jouent ici un rôle de contrepoids, en mettant en lumière ce qui relève du quotidien local. Mais l’asymétrie de traitement à l’échelle nationale reste forte, et contribue à renforcer l’impression que “ce qui compte” se passe d’abord au centre.
Le provincialisme horizontal, lui, ne se limite pas à un simple attachement envers un territoire : il agrège langue, culture, mémoire collective et histoire politique. Et la sphère politique, loin de l’atténuer, joue parfois un rôle renforçant — voire toxique. Mon propre pays, la Belgique, en est un exemple parlant : l’opposition entre la Wallonie, région francophone, et la Flandre, région néerlandophone, est avant tout une fracture linguistique, mais elle dépasse largement la question de la langue. Elle s’enracine dans des trajectoires historiques différentes (industrialisation précoce au sud, prospérité portuaire et commerciale au nord), dans des choix politiques divergents et dans un système institutionnel qui renforce l’autonomie régionale. Ce clivage, entretenu par certains discours partisans, alimente un sentiment persistant de “nous” contre “eux”, jusqu’à influencer la perception mutuelle des habitants et la manière dont se distribuent les ressources et les opportunités. La Belgique n’est pas un cas isolé : d’autres tensions horizontales reposent aussi sur des lignes linguistiques, comme entre la Catalogne et le Pays basque en Espagne, ou entre l’Écosse et l’Irlande du Nord au Royaume-Uni. Mais le provincialisme horizontal peut aussi s’ancrer dans des rivalités économiques (Lombardie vs Mezzogiorno en Italie), historiques (Bretagne vs Normandie) ou culturelles (Marseille vs Lyon). Dans tous les cas, il s’agit d’une confrontation latérale entre régions dotées de leur propre poids historique, économique et culturel, sans passer par un centre unique dominant.
Même si la taille diffère, à part le biais médiatique évoqué plus haut, les biais inhérents au provincialisme sont proches de ceux rencontrés plus haut pour le sociocentrisme. L’on retrouve également la même logique d’endogroupe et d’exogroupe et les mêmes déformations quand il s’agit de qualifier celui qui n’est pas de notre région. Le provincialisme implique néanmoins des marqueurs identitaires plus forts sur bases d’accents, de dialecte, de traditions et d’histoire locale. Je ne sais pas si c’est parce que je suis expatrié depuis des années, mais je ne ressens absolument aucune attache liée au provincialisme. Je reconnais que, quand j’étais en Belgique, j’étais, comme d’autres, l’instrument d’une politique bien curieuse et que je n’éprouvais pas un amour fou pour le nord du pays… mon apprentissage du néerlandais a d’ailleurs été très difficile, cela a dû joué. En Bretagne, où j’habite désormais, je me suis amusé à interroger les locaux sur la volonté ou non d’un rattachement de la région nantaise à la Bretagne… mais c’était de la pure curiosité.
Comment s’en prémunir ?
C’est donc avec un regard assez extérieure que je vous propose ici quelques techniques pour ne pas succomber au provincialisme et ce qui s’en rapproche :
- Pratiquer l’immersion : à partir d’ici et pour la plupart des strates suivantes, plus que former la jeunesse, le voyage permet de diversifier ses points de vue et donner une image plus globale et réaliste aux cultures plus éloignées.
- Décentrer la langue : j’en reparle à la strate suivante, mais s’exposer à d’autres accents, dialectes et expression, et les considérer comme des richesses culturelles plutôt que comme des marqueurs de distance ou d’altérité
- Et plus que jamais : questionner les stéréotypes. Sur ce point, j’ai beau ne pas être « victime » du provincialisme, et encore moins du sociocentrisme, je suis soumis à de nombreux stéréotypes. Parfois, je les entretiens. L’exercice de déconstruction est sans doute le plus difficile à ce niveau.
IV. Nation / Culture — Ethnocentrisme et mythe national
L’image qui me vient à l’esprit quand il s’agit d’ethnocentrisme est cette façon dont se nomment eux-mêmes les Chinois pour désigner leur pays. En chinois, la Chine se dit Zhōngguó, traduit en français par “l’Empire du Milieu”. C’est ce que l’on appelle le biais de centralité cartographique — et la Chine n’est pas seule à le pratiquer. Chaque peuple a façonné la représentation du monde en se plaçant au centre : cartes médiévales européennes mettant Jérusalem au milieu du monde, Japon se définissant comme le “pays du soleil levant” (Nihon), orienté par rapport à la Chine ou peuples antiques situant leur terre au centre de l’oikouménè, le monde habité. Cette centralité symbolique n’est pas un simple détail de vocabulaire : elle reflète une vision où notre culture, notre langue et notre histoire deviennent la norme, voire le sommet. C’est le cœur de l’ethnocentrisme — et, sur le plan politique, le carburant du mythe national.
📜 Focus : Écoumène et mythe national
Écoumène : venu du grec ancien oikouménē, littéralement « la terre habitée », le terme désigne d’abord pour les Grecs et les Romains le monde connu, c’est-à-dire les terres explorées et civilisées, par opposition aux zones barbares ou inaccessibles. Au Moyen Âge, il survit dans le vocabulaire religieux — par exemple le « concile œcuménique », qui vise à réunir l’ensemble de la chrétienté.
À l’époque moderne, les géographes en font un terme technique : l’écoumène, c’est l’ensemble des espaces effectivement occupés et exploités par les sociétés humaines, par opposition à l’« anécoumène » (déserts, hautes montagnes, zones polaires). Aujourd’hui, des penseurs comme Augustin Berque l’élargissent encore : l’écoumène n’est pas seulement une surface habitée, mais un milieu de vie, qui inclut les relations entre humains, cultures et environnements.
Mythe national : là où l’écoumène décrit la réalité matérielle de l’habitat humain, le mythe national lui donne une dimension symbolique. Il s’agit du récit fondateur qu’une communauté construit pour se représenter et légitimer son existence sur un territoire. Ces récits servent à fédérer, à donner du sens et à projeter une continuité entre passé, présent et avenir.
Chaque pays en possède : la France républicaine exaltant 1789, les États-Unis invoquant leurs « Pères fondateurs », le Japon rattachant la figure impériale à la déesse Amaterasu. Mais derrière la force unificatrice, le mythe national comporte une part d’ombre : il simplifie, occulte ou réécrit l’histoire, invisibilisant souvent les minorités ou les violences qui ont aussi façonné la nation.
À retenir : l’écoumène dit où les hommes habitent, le mythe national raconte pourquoi ils s’y sentent « chez eux ».
Dans le fond, le seul ethnocentrisme objectivement fondé, à mon sens, serait celui qui place l’Afrique de l’Est comme point zéro de l’histoire humaine, puisque les données paléoanthropologiques montrent que tous les humains actuels en sont issus. Le reste n’est qu’une construction culturelle : chaque peuple a tenté de recentrer ce point d’origine sur son propre territoire, effaçant au passage notre origine biologique commune.
Mais cet ethnocentrisme ne se limite pas aux cartes et aux récits historiques. Il s’infiltre dans des domaines beaucoup plus quotidiens, presque invisibles. Dans la cuisine, par exemple, on juge un plat étranger à l’aune de ses propres habitudes — comme l’Italien qui s’indigne de la pizza à l’ananas ou l’Occidental qui “améliore” un sushi en y ajoutant de la mayonnaise. Dans l’art, on a longtemps parlé de “sculptures primitives” pour qualifier des œuvres africaines, faute de leur appliquer les critères esthétiques européens. Dans la langue, on simplifie et déforme un terme étranger pour le faire entrer dans nos cases, comme traduire samouraï par “chevalier japonais” en effaçant tout un contexte culturel. L’éducation n’y échappe pas : nombre de programmes scolaires racontent l’histoire mondiale presque exclusivement depuis la perspective nationale, en oubliant, par exemple, les mathématiques arabes ou l’astronomie maya. Même l’organisation sociale et politique porte ce biais, lorsqu’on considère la démocratie occidentale comme “le seul système avancé” ou que l’on hiérarchise les religions selon sa propre grille morale. De nombreux biais cognitifs découlent directement de cette posture : le biais de familiarité culturelle, qui nous pousse à surévaluer ce qui nous est familier et à sous-estimer ce qui ne l’est pas ; le biais de supériorité culturelle, qui nous persuade que nos institutions et nos traditions sont plus avancées ; ou encore le biais de “mission civilisatrice”, hérité du colonialisme, qui présume qu’apporter sa culture à d’autres est forcément un progrès pour eux. C’est certainement l’un des raisonnements dont j’ai le plus honte sachant que je fais partie de cette humanité qui se croit supérieure à une autre… Je pourrais aussi intégrer ce que l’on pourrait nommer le biais de glottomanie – que j’ai évoqué dans ce sujet sur la glottophobie – et qui va nous pousser à privilégier une langue, la nôtre le plus souvent, comme valeur et légitimité ultime. C’est un biais qui se manifeste également au niveau de la strate du provincialisme. Enfin, à tout cela, s’ajoutent le biais de traduction ethnocentré, qui aplatit les concepts étrangers, et pour les biais temporels liés à cette strate, on a le biais de cadrage historique, qui interprète le passé selon nos valeurs actuelles ou le biais de continuité nationale, qui nous fait croire que notre nation actuelle est la continuation directe et homogène de son passé. Bref, considérer tous ces biais, et voir comment ils se glissent partout — des manuels scolaires à nos assiettes, des musées aux bulletins d’information —, permettrait, je crois, de desserrer l’étau de notre vision du monde et d’ouvrir un peu plus la porte à d’autres manières de penser.
V. Humanité — Anthropocentrisme et chronocentrisme humaniste
L’anthropocentrisme désigne la croyance selon laquelle l’humanité se trouve au centre de tout, qu’elle est la référence et la mesure absolues, intrinsèquement plus importante que n’importe quelle autre espèce vivante sur Terre. Cette idée imprègne encore massivement notre imaginaire, y compris dans des œuvres qui se veulent progressistes. L’humanité y est non seulement le point de référence, mais aussi le modèle implicite de toute civilisation “réussie”. Les espèces extraterrestres, dans la science-fiction, sont ainsi fréquemment jugées à l’aune de nos valeurs : ouverture, rationalité, maîtrise technologique, équilibre entre droits individuels et collectifs. Le chronocentrisme humaniste, lui, agit sur l’axe temporel : il érige notre époque — ou un “futur supposé” — comme point d’aboutissement naturel de l’évolution culturelle. Le passé est relégué à un ensemble d’étapes “arriérées” à dépasser ; l’avenir, imaginé comme une extrapolation linéaire de ce que nous sommes aujourd’hui, truffée de nos idéaux… et de nos angles morts.
La franchise Star Trek illustre, pour moi, parfaitement cette double centralité. Sous couvert de diversité et de compréhension mutuelle, l’humanité — occidentalisée, démocratique, rationnelle et organisée selon une hiérarchie militaire “soft” — reste l’axe moral et politique autour duquel tout gravite. La diversité ethnique affichée sert souvent de vitrine à une homogénéité culturelle : les civilisations rencontrées sont évaluées selon la grille de lecture de la Fédération, et la “maturité” d’un peuple se mesure à sa proximité avec ce modèle. Sur le plan chronocentré, l’univers de Star Trek projette un futur où nos valeurs actuelles sont universalisées — comme si l’histoire ne pouvait que converger vers elles. Même les dilemmes éthiques interstellaires s’y résolvent à la lumière de cette philosophie dominante. Si Star Trek en est l’exemple le plus emblématique, ce biais structure nombre de récits futuristes : Star Wars, Battlestar Galactica ou encore la saga vidéoludique Mass Effect. Derrière la promesse d’un ailleurs radicalement différent se cache souvent le miroir, légèrement déformé, de notre propre monde.
Dans notre réalité, ce qui me dérange le plus dans l’anthropocentrisme, c’est cette arrogance tranquille qui nous pousse à croire que nous sommes à la fois le sommet et le pivot du vivant. Nous plions les espèces animales à nos besoins, les transformons pour qu’elles produisent plus vite, plus gras, plus docile… puis nous nous mettons des lauriers de “sauveurs” parce qu’un zoo protège quelques pandas ou qu’une ONG réintroduit des loups. Comme si tout l’écosystème attendait notre générosité éclairée. La vérité, c’est que nous avons souvent la même approche qu’un pyromane qui se félicite d’avoir éteint un coin de l’incendie qu’il a lui-même allumé. Et tout cela repose sur un non-dit : dans notre récit mental, la nature n’a de valeur que lorsqu’elle nous sert — ou qu’elle nous amuse. Vous remarquerez que cela a tendance à m’exaspérer… je ne m’exclus pas non plus de cet état des lieux puisque je fais partie du tout dans lequel nous faisons tous partie. Pour apporter une larme d’humilité, je vous propose cet encart sur le positionnement de l’humanité au niveau de ce que l’on appelle « l’échelle trophique » :
📊 Notre vraie place dans le vivant
Malgré notre ego démesuré, l’espèce humaine ne trône pas “au sommet” de la pyramide écologique. Sur l’échelle trophique, nous occupons une position intermédiaire (niveau 2,2 à 2,5 en moyenne) — à peine plus élevée que celle d’un anchois ou d’un cochon domestique. Cela signifie que, globalement, notre régime alimentaire est celui d’un omnivore opportuniste, loin des grands prédateurs au sommet (orques, requins, lions).
De plus, la biosphère n’a pas “besoin” de nous. Les écosystèmes ont prospéré pendant des centaines de millions d’années avant notre apparition, et ils se réorganiseraient sans peine après notre disparition. En revanche, la majorité des systèmes vitaux sur lesquels nous dépendons (pollinisation, cycle de l’eau, fertilité des sols) sont gravement perturbés par nous.
La véritable mesure de notre importance écologique n’est donc pas notre rôle indispensable, mais l’ampleur de nos perturbations.
Comment s’en prémunir ?
- Premier objectif, changer d’échelle mentale en s’habituant à penser en termes d’écosystèmes et de cycles naturels plutôt qu’en termes de besoins strictement humains… autant dire qu’il s’agit d’une mission impossible tant nous visons l’intérêt autocentré court-termiste.
- S’informer sur les autres espèces et comprendre la notion de spécisme : explorer leurs comportements, intelligences et interactions permet de dépasser la vision utilitariste ou décorative que l’humain projette souvent sur le vivant. Le spécisme, concept forgé par analogie avec le racisme ou le sexisme, désigne la hiérarchisation des êtres en fonction de leur espèce, plaçant l’humain au sommet et reléguant les autres animaux à des rôles subalternes ou exploitables. Le comprendre, c’est reconnaître que cette logique est une construction culturelle et non une vérité naturelle, et qu’elle influence profondément nos lois, nos pratiques et notre imaginaire collectif.
VI. Planète Terre — Géocentrisme et présentisme géologique
Le géocentrisme recouvre deux dimensions : la théorie scientifique aujourd’hui abandonnée, qui s’oppose à l’héliocentrisme, et un biais plus symbolique ou existentiel qui consiste à penser que la Terre occupe une place centrale dans l’univers. Pendant plus de quatorze siècles, ce modèle a façonné notre vision du cosmos, nous faisant croire que la Planète bleue était immobile et que tout gravitait autour d’elle. La transition vers l’héliocentrisme reste, à mes yeux, l’un des épisodes les plus fascinants de l’histoire intellectuelle : c’est sans doute l’un des rares cas où un biais de centralité a été progressivement déconstruit par la science et le temps. Je dois avouer être longtemps resté à distance de ce questionnement, jusqu’à ce que le manga/animé Du mouvement de la Terre (dont Netflix détient désormais les droits chez nous) me fasse percevoir la tension extrême entre un changement radical de paradigme et la résistance acharnée d’une autorité religieuse qui, pendant des siècles, a exercé un pouvoir absolu sur la vérité admise.
Trois personnalités sont centrales dans ce basculement de pensée. Nicolas Copernic (chanoine, médecin et astronome polonais, 1473 à 1543) propose, dans son ouvrage De revolutionibus orbium coelestium (paru volontairement en 1543, à la fin de vie du personnage), une vision selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil et non l’inverse. Son modèle reste encore imparfait : il se contente d’inverser la structure géocentrique et conserve l’idée que la Terre suit une orbite parfaitement circulaire. La portée de sa proposition est limitée par une diffusion mesurée, mais Copernic sait qu’elle contredit à la fois la lecture littérale des Écritures et la cosmologie aristotélicienne soutenue depuis des siècles par l’Église. Cette cosmologie, développée par Aristote au IVᵉ siècle av. J.-C., avait façonné la pensée occidentale jusqu’à la Renaissance. Elle plaçait la Terre immobile au centre de l’univers, divisait le cosmos en un monde sublunaire imparfait (terre, eau, air, feu) et un monde supralunaire parfait, immuable, fait d’éther, et concevait les astres comme animés de mouvements circulaires éternels.
Si Copernic formula l’hypothèse héliocentrique, Tycho Brahe, astronome danois, en collecta les données astronomiques les plus précises de son temps. C’est grâce à cet héritage que Johannes Kepler (mathématicien et astronome impérial allemand, 1571 à 1630) put reprendre le concept, le consolider et le faire évoluer, démontrant que les planètes suivent des orbites elliptiques autour du Soleil. Il a élaboré trois lois qui, en plus du mouvement en ellipse, décrivent le fait que les planètes se déplacent plus vite près du Soleil que quand elles en sont éloignées et que plus elles sont éloignées plus leur révolution – temps de rotation autour du Soleil – est lente. Enfin, Galilée Galilei (physicien, astronome et ingénieur italien, 1564-1642) est sans doute celui qui a rencontré le plus de difficultés pour imposer l’idée de l’héliocentrisme. Si Copernic avait fait preuve d’une prudence absolue toute sa vie, et si les lois de Kepler étaient restées relativement confinées aux cercles scientifiques, Galilée, lui, met les mains dans le cambouis. Grâce à ses observations au télescope — les phases de Vénus (similaires à celles de la Lune, preuve que Vénus tourne autour du Soleil) et les lunes de Jupiter (quatre satellites en orbite autour d’une autre planète, preuve que tout ne tourne pas autour de la Terre) — il rend l’hypothèse héliocentrique impossible à ignorer. Mais en publiant en italien, à la portée du grand public et des autorités religieuses, il se retrouve en confrontation directe avec l’Église, jusqu’à son procès retentissant de 1633. Procès qu’il a perdu. Mais la théorie de l’héliocentrisme était bien là et sa reconnaissance se fait ensuite par grignotage progressif, notamment par le biais d’Isaac Newton, dans son « Principia Mathematica« , couplé à un affaiblissement – salutaire et indispensable à mon sens ! – de l’autorité religieuse et l’essor de la science expérimentale… Ainsi, l’héliocentrisme a gagné par accumulation de preuves et par changement de climat intellectuel, jusqu’à ce que s’y opposer devienne scientifiquement intenable.
Plus symboliquement, le géocentrisme est encore très central dans nos raisonnements modernes. Nous nous plaçons encore comme le centre narratif de l’univers, en partant du principe que la vie intelligente est unique à la Terre. On continue de se représenter l’histoire cosmique comme orientée vers nous : l’apparition de l’humanité étant vue comme l’aboutissement naturel d’un processus, plutôt qu’un hasard local. Comme si l’évolution nous avait choisi, comme si nous étions des élus. S’il n’y a pas de valeur fiable pouvant donner la probabilité que la vie intelligente émerge ailleurs, tout indique pourtant que notre apparition résulte d’un enchaînement hautement contingent : conditions planétaires particulières, événements géologiques rares, extinctions massives opportunes et évolutions biologiques improbables. En l’état, nous ne connaissons aucun autre exemple de civilisation technologique, ce qui nourrit l’illusion que notre existence était inévitable. C’est là que le géocentrisme symbolique s’installe : il confond un hasard local avec une finalité universelle, et entretient le récit flatteur d’une humanité “destinée” à occuper le premier rôle dans l’histoire cosmique.
En parallèle, on nourrit le fantasme de “la première rencontre” — celui d’une découverte qui validerait notre importance en nous mettant face à “un Autre” à notre mesure, une civilisation extraterrestre. La fiction en est particulièrement friande : tantôt elle entretient l’attente, en suggérant une présence mystérieuse sans jamais la montrer (Contact, 2001 : l’Odyssée de l’espace), tantôt elle imagine la rencontre consommée et intégrée dans notre quotidien (Star Trek, Babylon 5). Cette oscillation traduit notre ambivalence : chercher à rompre notre isolement cosmique tout en voulant rester les héros de l’histoire, même face à plus évolué que nous. Dans tous les cas, c’est un paradoxe assez passionnant : on se croit seuls et uniques tout en espérant ardemment ne pas l’être.
Comment s’en prémunir ?
Là, on est sur une strate largement déconstruite sur le plan scientifique. Reste la valeur symbolique du géocentrisme et cette difficulté à se représenter un univers où nous ne serions qu’un point perdu, sans rôle central. Certains auteurs ont parfois tenté l’exercice périlleux d’imaginer un Autre radicalement non humain. Et, curieusement, dès que l’entité représentée n’est plus humaine, elle tend presque toujours à être mise en opposition à l’humain. Le cinéma l’a largement montré, d’Alien à The Thing : l’Autre radical est souvent une menace, un danger à éradiquer. Nos récits trahissent ici la persistance du biais de centralité : nous n’arrivons pas à penser l’altérité sans la confronter à notre survie. Quelques exceptions — Solaris de Lem, ou plus récemment Arrival — cherchent à rompre ce schéma, mais elles restent marginales. Et, enfin, pour finir, dans notre réalité, il reste également encore quelques irréductibles pour croire que la Terre est plate. Mais c’est justement la preuve qu’aucun biais de centralité ne disparaît jamais totalement : il se transforme, se recycle, et attend toujours un terrain propice pour ressurgir.
L’anthropocène : ce biais temporel inversé
L’Anthropocène est un biais temporel inversé : là où le géocentrisme consistait, malgré soi, à surestimer la place de la Terre dans l’univers, beaucoup refusent aujourd’hui de reconnaître la place de l’humain dans l’histoire géologique proche. L’anthropocène, proposé pour nuancer l’époque officielle, l’actuel Holocène (commencé il y a 11 700 ans), désigne cette nouvelle époque géologique proclamé par les plus lucides d’entre nous dont la caractéristique première serait l’empreinte durable (plastiques, béton, radioactivité, CO₂ accumulé) de l’humanité sur son environnement. Ce n’est plus seulement un biais spatial (où est le centre ?), mais temporel : l’humain serait devenu une force tellurique, au même titre que les grandes ères glaciaires ou l’impact de Chicxulub… du nom de la météorite qui a terrassé les dinosaures !
Là où nous avons longtemps surestimé notre importance cosmique, nous avons désormais tendance à la minimiser dès qu’il s’agit d’assumer nos responsabilités. C’est tout le paradoxe de l’Anthropocène : refusé en 2024 par les instances stratigraphiques IUGS, il demeure un concept puissant. Non reconnu comme époque géologique, il agit pourtant comme un miroir : nous ne sommes pas le centre de l’univers, mais nous sommes devenus le centre d’un dérèglement planétaire. Ce refus montre également, à mon sens, un biais de déni, car reconnaître l’Anthropocène, ça serait reconnaître nos actions devenues comparables aux grandes forces naturelles. On est passés d’un biais où nous placions la Terre et l’humain au centre du cosmos… à un biais où nous refusons d’admettre que l’humain a effectivement pris une place centrale dans la dynamique planétaire. En d’autres termes : nous ne sommes pas le centre de l’univers, mais nous sommes devenus le centre d’une perturbation terrestre.
VII. Univers / Cosmos — Cosmocentrisme et présentisme cosmique
Pour cette dernière strate, j’ai avancé au départ sans connaître le sens exact du mot cosmocentrisme. Dans mon esprit, il s’agissait d’un centrage par défaut sur notre planète, notre système solaire ou notre galaxie : non par conviction de supériorité, mais par simple absence de point de comparaison. Nous nous pensons au centre de “notre” univers observable, faute d’informations fiables sur les autres mondes, systèmes ou formes de vie.
En réalité, le cosmocentrisme est l’intrus de ma sélection de biais de centralité. Certes, il y a bien l’idée d’un centre, mais à une échelle si vaste qu’on ne peut guère dire que l’humain en soit le pivot. Dans son sens philosophique, il replace l’homme dans un ensemble plus grand et ordonné, dont il n’est qu’un élément. Certaines philosophies antiques — stoïcisme, néoplatonisme — voyaient l’univers comme un tout cohérent auquel l’homme devait se conformer. Dans sa version spirituelle ou mystique, il affirme que l’humain est secondaire face à une totalité englobant tout le vivant et la matière. Et, je dois le reconnaître, il y a peut-être là une forme de justice : un renversement bienvenu face aux excès de l’anthropocentrisme.
Reste que notre centrage par défaut sur “chez nous” tient aussi à des contraintes objectives. Les limites de notre univers observable, dictées par la vitesse de la lumière, restreignent notre connaissance aux régions accessibles à nos instruments. Le principe cosmologique, qui postule que l’univers est homogène (même répartition globale de la matière) et isotrope (mêmes propriétés dans toutes les directions), n’est qu’une hypothèse — séduisante, car plus simple à comprendre et à modéliser, mais jamais prouvée. À cela s’ajoute un biais d’unicité cosmique : la tentation de croire que les conditions terrestres sont uniques. Elles le sont sans doute à nos yeux, puisque notre monde résulte d’un enchaînement de hasards extrêmement improbables — distance idéale au Soleil, présence d’eau liquide, atmosphère protectrice, stabilité géologique… Mais l’immensité de l’univers rend plausible que ces combinaisons se reproduisent ailleurs. Une probabilité infime, multipliée par des milliards de planètes, cesse d’être négligeable. C’est toute l’ambiguïté : la Terre peut être exceptionnelle pour nous, tout en n’étant pas nécessairement seule en son genre.
Tout cela est renforcé par le paradoxe de Fermi, formulé dans les années 1950 par le physicien Enrico Fermi : si les conditions propices à la vie sont susceptibles d’apparaître ailleurs et si l’univers est si vaste et ancien, alors, statistiquement, des civilisations avancées devraient déjà avoir laissé des traces observables… Alors où sont-elles ? Les hypothèses pour expliquer ce silence vont de la rareté extrême de la vie complexe à l’idée que les civilisations s’autodétruisent avant de pouvoir voyager ou communiquer à grande échelle. Certains invoquent aussi le principe anthropique, l’idée fascinante qui admet que l’univers nous semble calibré pour la vie… mais uniquement parce que nous existons pour l’observer. Autrement dit, si l’univers n’avait pas les propriétés permettant à la vie d’apparaître, nous ne serions pas là pour en débattre. Ce principe peut se lire de deux façons : comme une simple tautologie scientifique, ou comme un indice que les conditions de l’univers ne sont pas un hasard complet — au risque de glisser vers des interprétations philosophiques ou métaphysiques. Face à ce vide, nous cherchons naturellement à combler l’inconnu par des récits : hypothèses scientifiques, mythes anciens ou fictions futuristes… Autant de manières de donner forme à un centre qui, peut-être, n’existe pas.
L’ultime centralité : exporter notre modèle
J’aimerais ici évoquer un autre paradoxe. Face à l’immensité de l’univers et la fragilité de notre condition terrestre, notre imaginaire collectif ne se tourne pas seulement vers les étoiles pour chercher un Autre mais pour chercher… une autre Terre. Le fantasme de coloniser Mars – scientifiquement, je trouve ça complètement incroyable ! – ou de transformer une planète voisine illustre à la fois nos ingéniosité et notre aveuglement. Nous projetons sur un autre monde les mêmes logiques d’appropriation et de centralité que celles qui ont déjà mis en péril notre planète. Comme si notre salut devait passer par la reproduction, ailleurs, d’un modèle déjà défaillant ici. Ce projet technologique titanesque révèle une contradiction criante : nous rêvons de remodeler un monde hostile plutôt que de préserver celui qui nous a donné naissance. Et là encore, le biais central se manifeste : nous ne pensons pas l’univers pour lui-même, mais uniquement comme une scène possible pour la continuation de notre propre histoire.
A la dernière minute…
Pour clore cette strate, et en tant que biais temporel, je vais explorer cette projection assez classique du temps humain, non pas sur la durée de la Terre, mais sur la durée de notre univers… histoire d’accentuer ce besoin alarmant d’humilité et de décentrage. L’image du temps humain sur une journée de 24 heures est souvent évoquée comme ceci :
- La Terre se forme à 0h00.
- La vie apparaît vers 4h00 du matin.
- Les dinosaures débarquent vers 22h24.
- Les humains modernes n’apparaissent qu’à 23h59 et 46 secondes.
- L’ère industrielle dure… 0,006 seconde avant minuit.
Passons maintenant au temps de l’univers et de ses 13,8 milliards d’années (estimation faite selon le consensus scientifique actuel) face au temps humain :
- 0h00 : Big Bang — naissance de l’espace, du temps, et de la matière.
- 0h03 min : Formation des premiers atomes légers (hydrogène, hélium).
- 0h10 min : Émission du fond diffus cosmologique — la lumière se libère.
- 4h00 : Naissance des premières galaxies et étoiles.
- 15h00 : Formation de la Voie lactée.
- 21h30 : Naissance du Système solaire.
- 21h39 : Formation de la Terre (4,54 milliards d’années).
- 22h13 : Apparition des premières formes de vie terrestres.
- 23h00 : Premières cellules complexes (eucaryotes).
- 23h37 : Explosion cambrienne : grande diversification animale.
- 23h56 : Extinction des dinosaures.
- 23h59m 46s : Apparition d’Homo sapiens.
- 23h59m 59,98s : Révolution industrielle.
- 23h59m 59,9999s : Nous, maintenant
Ici, difficile d’évoquer une quelconque façon de se prémunir du cosmocentrisme… cela nous dépasse dans tous les sens du terme.
VIII. Ce que disent les biais de centralité de notre humanité
Ces biais de centralité, tels que je les présente ici, sont à mes yeux des caractéristiques propres à notre espèce. Pourquoi ? Parce que ce réflexe du « moi » vient en grande partie de notre évolution cognitive. Si d’autres espèces ont aussi façonné un moyen de traiter ce qui touche directement à leur survie et, dans une certaine mesure, leur appartenance, elles n’ont pas développé une conscience réflexive de cette hiérarchie, ni la capacité d’ériger leur propre position en système global de valeurs.
Je trouve ces dérives cognitives aussi passionnantes que préoccupantes, car elles dessinent notre limite à reconnaître l’altérité et à nous soucier de ce qui est différent. Cela s’explique en partie par le fait que notre cerveau traite la réalité en repères relatifs : il n’évalue presque jamais les choses en absolu, mais toujours en comparaison avec autre chose. Notre esprit structure le monde en centres et périphéries, en points de référence. Cette organisation simplifie énormément la compréhension, mais elle induit un biais majeur : nous avons tendance à surestimer ce qui est proche du centre (moi, mon groupe, mon espèce) et à minimiser ce qui est périphérique (les autres, l’étranger, le non-humain).
Ces biais de centralité ne relèvent pas seulement de la cognition, ils sont aussi une construction culturelle. La plupart des religions ont placé l’homme au cœur de la création ; la philosophie occidentale classique l’a érigé en mesure de toute chose ; et même la science, pourtant émancipée du dogme, a longtemps affirmé la centralité de la Terre (géocentrisme) ou de l’humanité (maîtrise cartésienne de la nature). Autrement dit, nos récits collectifs ont légitimé et amplifié ces biais, au point d’en faire des évidences presque invisibles.
Mais ces biais fonctionnent également comme un effet miroir : ils en disent moins sur la réalité que sur nous-mêmes. Ils révèlent notre difficulté chronique à concevoir une altérité radicale, qu’il s’agisse d’un autre peuple, d’une autre espèce ou d’une autre forme de conscience. En définitive, ils trahissent une sorte de narcissisme métaphysique : nous ne savons penser l’univers qu’en y plaçant notre reflet.
🪞 Focus : le narcissisme métaphysique
On peut appeler narcissisme métaphysique cette tendance propre à l’humanité à se concevoir comme le centre et le sens de l’univers. Ce n’est plus seulement un biais psychologique, mais une déformation de notre rapport à l’être lui-même : tout ce qui existe ne vaudrait qu’en fonction de nous.
On en retrouve des traces dans les religions (l’homme créé à l’image de Dieu), dans la philosophie classique (l’homme mesure de toute chose), et même dans certains récits scientifiques où l’humain reste la référence ultime. Il s’agit d’une façon de rendre supportable notre insignifiance cosmique, en transformant l’univers en miroir.
Ce narcissisme se traduit concrètement par une hiérarchisation des vies (animaux de compagnie vs animaux d’élevage), une vision utilitaire de la nature (décor ou ressource), et une difficulté à imaginer des formes de vie radicalement autres. En somme, il empêche de reconnaître la valeur intrinsèque de l’altérité.
Ces biais, j’y suis moi-même soumis, comme tout un chacun. Je joue au même jeu que vous. À mes yeux, jusqu’à l’ethnocentrisme, ce n’est pas le plus insurmontable : il peut générer de fortes tensions géopolitiques, certes, mais il demeure une déformation exclusivement intra-humaine. En revanche, c’est l’anthropocentrisme qui me gêne le plus. Ici, on bascule vers une strate extra-humaine : ce biais ne se contente pas de fausser notre regard, il fonde notre rapport d’exploitation au monde. Là réside ce qui le rend éthiquement insupportable. L’ethnocentrisme crée des conflits ; l’anthropocentrisme justifie des dominations. Comme je le soulignais plus haut, la nature — dans son sens le plus large — et son lore sont, à nos yeux, mis à notre service. On dit souvent que nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. L’ironie est là : à force de vivre comme si nous étions le centre de tout, nous finissons par rendre notre environnement invivable… pour nous-mêmes. On ne se défait jamais vraiment de nos biais de centralité. Mais y réfléchir — comme à tout mécanisme invisible qui oriente nos perceptions — reste sans doute la meilleure manière de s’en prémunir. Nous ne sortirons jamais de nous-mêmes. Mais nous pouvons, à défaut, apprendre à voir nos propres miroirs — et peut-être, dans ce reflet, entrevoir enfin l’altérité.
IX. Ressources pour aller plus loin
Ouvrages de référence :
- Hannah Arendt — Condition de l’homme moderne (sur l’anthropocentrisme et la responsabilité).
- Lynn Margulis — Symbiotic Planet (vision non anthropocentrée du vivant).
- Philippe Descola — Par-delà nature et culture (déconstruction de la centralité occidentale).
- Timothy Morton — Hyperobjects (idée que certains phénomènes dépassent radicalement l’humain).
- Christophe Bonneuil & Jean-Baptiste Fressoz — L’événement Anthropocène.
Articles/études clés :
- L’étude de l’IUGS 2024 rejetant la formalisation de l’Anthropocène.
- Travaux de l’IPCC (GIEC) sur les bouleversements planétaires liés aux activités humaines.
- Articles de vulgarisation (CNRS, Nature, The Conversation) sur biais cognitifs et anthropocentrisme.
Quelques films et livres (qui m’ont beaucoup marqué et qui gravitent autour de ce sujet) :
- The Truman Show (1998, Peter Weir) — le monde centré sur un seul individu.
- 2001: L’Odyssée de l’espace (1968, Stanley Kubrick) — décentrement radical de l’humanité.
- Interstellar (2014, Christopher Nolan) — temporalité cosmique et relativité humaine.
- Arrival (Premier Contact, 2016, Denis Villeneuve) — rencontre avec une altérité radicalement non humaine.
- Avatar (2009, James Cameron) — anthropocentrisme versus écocentrisme.
- Melancholia (2011, Lars von Trier) — indifférence cosmique face à la fin du monde.
- Wall-E (2008, Pixar) — critique de l’exploitation consumériste de la Terre.
- Alien (saga, 1979–2024) — confrontation brutale à une altérité biologique.
- Don’t Look Up (2021, Adam McKay) — déni collectif face à une menace planétaire.
- La Planète des singes (1963, Pierre Boulle) — inversion de la hiérarchie anthropocentrée.
- Solaris (1961, Stanislas Lem) — intelligence non humaine incompréhensible.
- Fondation (Isaac Asimov, 1951–1993) — tentative d’historiciser l’humanité à l’échelle galactique.
- Dune (1965, Frank Herbert) — écologie, pouvoir et humanité recontextualisée par un désert-planète.
- Ubik (1969, Philip K. Dick) — réalité instable, décentrement ontologique.
- Le Cycle de Culture (Iain M. Banks) — sociétés post-humaines relativisant notre centralité.
- La Mort de la Terre (1910, J.-H. Rosny Aîné) — humanité marginalisée par d’autres formes de vie minérales.

Charte de transparence IA
🧠 Idée : 100 % humaine
📁 Structure : J’ai voulu organiser le texte en plaques, comme des sphères imbriquées de biais successifs. L’IA m’a soufflé d’ajouter les biais temporels à la suite des biais spatiaux par strate : une proposition originale que j’ai adoptée. Et à partir de ce texte, je vous propose un renvoi vers la définition de mots un peu complexes vers mon nouveau dictionnaire sur-mesure.
✍️ Rédaction : L’IA m’a beaucoup épaulé, notamment sur les strates dont je n’avais pas l’expertise directe. J’ai appris en chemin, par exemple sur l’histoire de l’héliocentrisme et ses étapes. Ce qui m’a marqué, c’est à quel point l’intégration d’une idée peut sembler impossible tant que l’époque n’y est pas prête. J’ai souvent pensé qu’il aurait suffi de peu pour que tout s’écroule.
🎨 Illustrations : IA à 100 %.
Intervention globale de l’IA estimée : 70 %




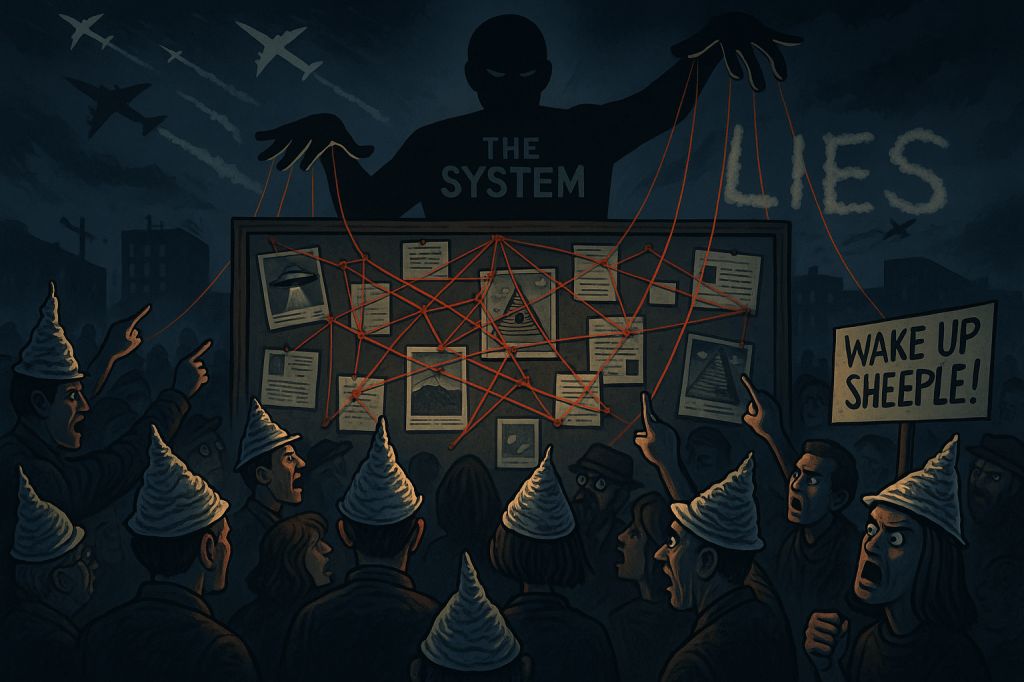



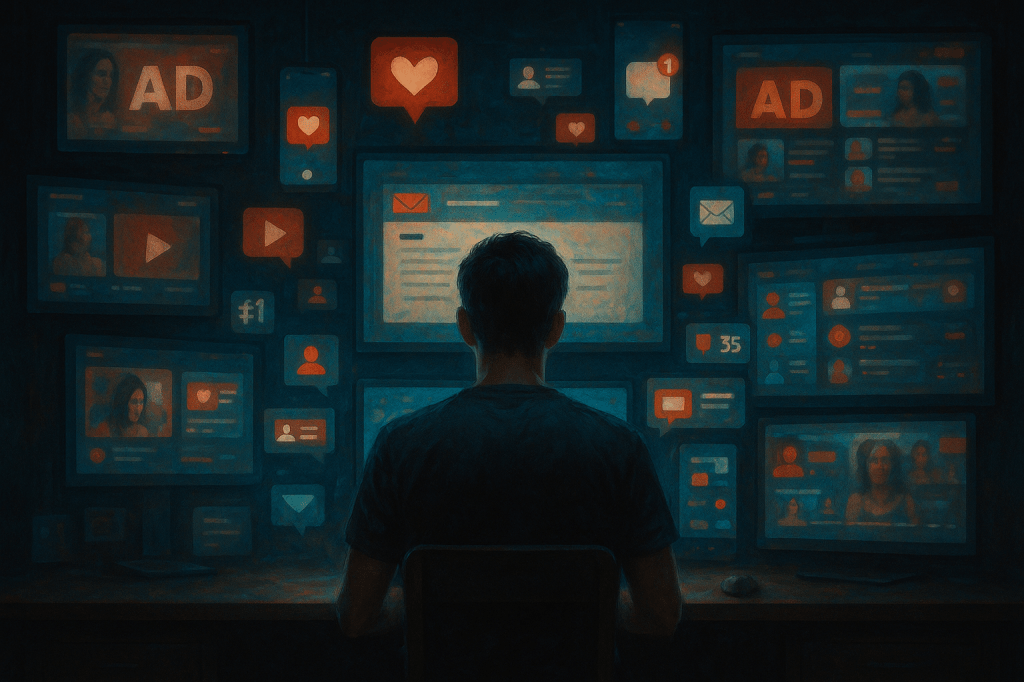
Laisser un commentaire