Je ne sais pas si c’était un rêve ou un souvenir volé à un autre temps, mais me voilà assis dans une salle aux murs chargés de livres, sous les hautes fenêtres de la Sorbonne. Devant moi, un homme à la barbe grise, costume sombre, regard pénétrant. Il ne me demande pas qui je suis. Il me dit simplement : « On discute ? » Alors je m’assois. Plus exactement : je m’efface un peu. Aujourd’hui, c’est Émile Durkheim — le père fondateur de la sociologie moderne — qui m’invite à penser avec lui.
- I. Qu’est-ce qu’un fait social ?
- II. « Le suicide » et le concept d’anomie
- III. Poser les règles du jeu sociologique
- IV. De la division du travail à la solidarité organique
- V. Une fonction symbolique : penser la religion autrement
- VI. L’école, matrice du lien social
- VII. Résumé des concepts durkheimiens abordés dans cet échange
- VIII. La Bibliographie d’Émile Durkheim et autres ressources

Je ne sais pas comment j’ai atterri là. Un amphithéâtre ancien, boiseries sombres, odeur de papier et de craie froide. Dehors, une lumière pâle traverse les vitres. La Sorbonne, je crois. Ou une idée de la Sorbonne. Un homme m’attend. Assis derrière un bureau trop large. Il ajuste ses lunettes, se lève lentement, puis me tend la main. Je reconnais son visage : barbe fournie, regard concentré. Émile Durkheim, en chair et en rêve.
Emile Durkheim : Je vous attendais. Vous semblez avoir des questions. J’ai, peut-être, quelques réponses.
Moi : (Je souris, un peu intimidé) Bonjour… en effet, mais je ne suis pas sociologue, juste un curieux. J’ai suivi une année à la fac en sociologie, il y a longtemps. Ce n’était pas très profond — mais c’est resté. Je me souviens surtout de vous.
Durkheim : C’est déjà beaucoup. La sociologie ne demande pas d’être un spécialiste pour vous toucher. Elle commence là où l’on s’étonne de ce qu’on croyait naturel. Et vous êtes venu vous étonner, n’est-ce pas ?
Moi : Oui. J’aimerais comprendre pourquoi vos idées me semblent encore si justes — alors que vous avez disparu il y a plus d’un siècle. Et j’aimerais, surtout, les confronter au monde d’aujourd’hui.
Durkheim : Alors asseyons-nous. Et regardons ce monde, l’un avec les outils du passé, l’autre avec les yeux du présent.
I. Qu’est-ce qu’un fait social ?
Moi : De mémoire, je connais surtout de vous votre œuvre sur le suicide, qui m’avait beaucoup marqué à l’époque, et le fait que vous êtes le père de la sociologie comme discipline scientifique.
Durkheim : C’est un bon point de départ. J’ai voulu faire de la société un objet d’étude scientifique, avec ses lois propres. Avant moi, on parlait de la société surtout par la philosophie ou la morale. Moi, j’ai voulu l’observer avec rigueur, comme une réalité qui agit sur nous.
Moi : Et quelles sont ces lois et ces forces ?
Durkheim : Ce sont les faits sociaux : des manières de penser, d’agir ou de sentir qui existent hors de nous — et qui s’imposent à nous. Langue, salutations, rituels… autant de normes apprises, jamais choisies. Ces faits influencent nos comportements de façon régulière et collective.
Moi : Ces forces sociales, on peut les rapprocher du déterminisme sociale, non ? C’est une notion qui vous êtes chère, je crois
Durkheim : Oui, mais pas un déterminisme absolu. Nos choix s’exercent dans un cadre contraint : normes, traditions, institutions. On peut choisir sa direction, mais pas la forme du terrain. Le sociologue, lui, étudie ce terrain.
Moi : C’est une très belle introduction. Pouvez-vous vous présentez brièvement ainsi que vos travaux principaux.
Durkheim : Né en 1858 à Épinal, j’ai voulu fonder une science de la société. Dans Les Règles de la méthode sociologique, j’ai proposé une méthode rigoureuse pour étudier les faits sociaux. Avec De la division du travail social, j’ai exploré la solidarité dans les sociétés modernes. Dans Le Suicide, j’ai montré que même les actes les plus personnels obéissent à des logiques collectives. Et avec Les Formes élémentaires de la vie religieuse, j’ai analysé les fonctions symboliques de la religion. Tout cela pour comprendre ce qui unit — ou divise — les hommes. Tous ces travaux visent une seule chose : comprendre ce qui relie les hommes, ce qui les désunit, et ce qui rend une société possible — ou fragile.
Moi : Vous avez été, dit-on, le fondateur de la sociologie moderne. Mais fonder une discipline, ce n’est pas juste écrire des livres : c’est affronter des mentalités, convaincre des institutions, inventer des outils… Qu’est-ce que cela a représenté pour vous, humainement, intellectuellement ? Avez-vous été soutenu ? Ou combattu ?
Durkheim : Ah… vous touchez là à ce qui fut, sans doute, le combat de toute une vie. Fonder une discipline, ce n’est pas seulement faire des découvertes. C’est se battre pour qu’une manière nouvelle de penser soit reconnue comme légitime. Quand j’ai commencé à parler de faits sociaux, d’objectivité en sciences humaines, on m’a regardé avec méfiance. À l’époque, tout ce qui touchait à l’homme relevait soit de la philosophie morale, soit de la psychologie individuelle. Il fallait du courage — ou de l’entêtement — pour affirmer que la société devait être étudiée comme une réalité à part entière, avec sa propre logique. J’ai rencontré beaucoup de résistances :
- De la part des philosophes, qui me voyaient comme un intrus.
- Des universitaires, qui jugeaient ma démarche trop rigide, trop scientifique.
- Même des collègues, parfois, qui ne voyaient dans la sociologie qu’un prolongement de l’idéologie républicaine.
Mais je n’étais pas seul. J’ai eu des alliés précieux — des esprits brillants et engagés. Mon neveu Marcel Mauss, par exemple, qui a prolongé mes travaux et m’a soutenu fidèlement. Et quelques institutions ont fini par m’ouvrir leurs portes : l’École normale, l’université de Bordeaux, puis la Sorbonne… où j’ai pu enseigner, écrire, transmettre.
Moi : Juste pour compléter ce point. Pourquoi les philosophes vous voyait comme un intrus ? Qu’est-ce que l’idéologie républicaine ? Je ne connaissais pas l’existence de votre neveu : dans quelle mesure a-t-il prolongé vos travaux ? Et avez-vous obtenu une reconnaissance absolue avant votre disparition ?
Durkheim : Vous soulevez là quatre points importants — et je vais tâcher d’y répondre simplement, sans trop m’égarer.
🧱 Pourquoi les philosophes me voyaient comme un intrus ?
Parce que j’ai voulu extraire l’étude de la société du domaine de la spéculation philosophique, pour la faire entrer dans celui de la science. Là où le philosophe interprète, moi je mesure. Là où il médite sur le juste et l’injuste, moi j’observe comment ces notions se forment, se stabilisent, se transmettent. Je ne nie pas l’intérêt de la philosophie — bien au contraire — mais je me suis opposé à l’autorité exclusive qu’elle exerçait sur tout ce qui concernait l’homme, la morale, le politique. Cela a été mal perçu, surtout en France, où la tradition philosophique est forte et jalouse de ses prérogatives.
🇫🇷 Et l’idéologie républicaine, dans tout cela ?
À mon époque, la Troisième République se construit laborieusement. Elle a besoin de justifier ses institutions — l’école, la laïcité, la morale civique. On m’a parfois accusé de mettre la sociologie au service de ce projet politique. Ce n’est pas tout à fait faux : j’étais républicain, oui, et convaincu que l’école, la science et la justice pouvaient cimenter une société plus cohérente. Mais je ne confondais pas science et propagande. Je voulais comprendre la société pour mieux la faire tenir — pas pour servir un parti.
👨👦 Et mon neveu, Marcel Mauss ?
Ah, Marcel… Un esprit brillant, plus souple, plus anthropologue que moi. Il a prolongé mon travail en explorant les pratiques sociales concrètes — le don, le rite, le sacrifice — dans des sociétés très différentes des nôtres. Son ouvrage Essai sur le don (1925) est un chef-d’œuvre : il montre que le don, même “gratuit”, obéit à une logique sociale de réciprocité et d’obligation. Il démontre que l’économie, la morale et la magie sont encore profondément entremêlées dans les faits sociaux. Il a aussi contribué à faire connaître mes idées à l’international, notamment via L’Année sociologique, la revue que nous avons fondée ensemble.
👨👦 Focus : Mon neveu Marcel Mauss et sa logique du don
Marcel Mauss (1872–1950) fut donc mon neveu et mon plus proche collaborateur. Il a été une figure fondatrice de l’anthropologie sociale. Plus ouvert aux sociétés non occidentales que moi, il a développé une approche à la fois comparative, ethnographique et profondément ancrée dans l’observation des pratiques concrètes.
Dans son ouvrage majeur, Essai sur le don (1925), il s’interroge sur un geste en apparence simple mais en réalité fondamental : donner. Il montre que dans de nombreuses sociétés traditionnelles (Maoris, peuples du Pacifique, Amérindiens…), le don n’est pas un acte désintéressé, mais une pratique sociale encadrée par des obligations.
Il identifie une triple obligation sociale universelle :
- Donner : initier le lien, affirmer sa générosité, son statut.
- Recevoir : reconnaître et accepter l’échange social.
- Rendre : entretenir la relation en répondant à l’offrande.
Cette triple logique fonde une économie du lien où prestige, confiance et hiérarchie sont sans cesse rejoués. Le don devient ce que Marcel appelle un fait social total : il mobilise à la fois l’économie, la morale, le droit, la religion et la magie. Rien n’est isolé, tout est relation.
Ce modèle, loin d’être limité aux sociétés dites « archaïques », reste visible dans les pratiques modernes : cadeaux, invitations, entraide, mécénat, relations diplomatiques… même dans l’entreprise ou la famille. Il montre ainsi que nos sociétés modernes restent traversées par des logiques de réciprocité que la seule économie ne peut expliquer.
En prolongeant ce que j’ai pu proposer tout en le déplaçant, Marcel Mauss a ouvert la voie à l’anthropologie structurale (Lévi-Strauss), aux théories du don en sciences sociales (Bourdieu, Godbout, Graeber) et à une compréhension plus fine des sociétés dans toute leur diversité symbolique.
🏛️ Et la reconnaissance, enfin ?
Je dirais… partielle. J’ai obtenu une chaire à la Sorbonne, ce qui n’était pas rien. Mon enseignement a été suivi, discuté, parfois contesté, souvent respecté. Mais la sociologie n’était pas encore pleinement reconnue comme science à part entière à ma mort, en 1917. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que mon œuvre a véritablement pris racine, notamment chez des penseurs comme Lévi-Strauss, Bourdieu ou Habermas. En un sens, ma reconnaissance est venue après moi. Et c’est sans doute là le propre des fondateurs : on les comprend mieux quand leur absence commence à peser. Souhaitez-vous qu’on poursuive avec un premier ouvrage ? Le Suicide, peut-être ?
II. « Le suicide » et le concept d’anomie
Moi : Oui, s’il vous plait. Avec cette étude, vous avez voulu montrer que le suicide, bien qu’il semble relever d’une décision intime et personnelle, est en réalité fortement conditionné par des facteurs sociaux.
Durkheim : Vous résumez bien l’enjeu. Dans Le Suicide (1897), je n’ai pas seulement voulu traiter d’un drame humain, mais démontrer, de manière rigoureuse, que même un acte aussi intime que le suicide répond à des logiques collectives. En comparant des statistiques — entre pays, confessions, structures familiales, périodes de crise économique — j’ai mis au jour des régularités. J’ai montré qu’il existait des lois sociales : certains contextes sociaux favorisent le passage à l’acte, d’autres le freinent. Et c’est là que j’ai introduit un concept central, que j’avais déjà esquissé dans De la division du travail social (1893) : l’anomie, que je relierai ensuite à la désagrégation progressive des normes collectives.
Moi : Quelles sont ces lois sociales dont vous parlez ?
Durkheim : Deux dimensions reviennent systématiquement : l’intégration et la régulation.
- Moins un individu est intégré socialement, plus il est vulnérable : isolement, absence de liens, perte de reconnaissance… cela mène au suicide égoïste.
- Mais une régulation trop rigide peut aussi mener à la mort, quand l’individu se sent écrasé, privé d’horizon : c’est le suicide fataliste.
Entre ces deux extrêmes, j’ai identifié deux autres formes :
- Le suicide altruiste, quand l’individu est trop intégré et se sacrifie pour le groupe (comme chez les kamikazes, ou dans certaines castes),
- Et le suicide anomique, lorsque les normes sociales s’effondrent et que le sujet perd ses repères.
En résumé : Les quatre types de suicide selon ce que j’ai étudié
Dans Le Suicide (1897), j’ai identifié quatre formes principales de suicide, qui ne relèvent pas du simple mal-être individuel, mais traduisent un déséquilibre entre l’individu et la société. Ces catégories, bien que théoriques, permettent d’analyser avec rigueur les causes sociales de cet acte tragique.
- 🔹 Suicide égoïste — Intégration sociale trop faible : L’individu est isolé, faiblement relié à des groupes ou à une communauté.
Exemples : personnes seules, sans enfants, marginalisées. - 🔹 Suicide altruiste — Intégration sociale excessive : L’individu se sacrifie au nom du collectif, jusqu’à s’effacer totalement.
Exemples : kamikazes, suicides rituels, devoirs de caste. - 🔹 Suicide anomique — Régulation sociale insuffisante : Les normes sociales s’effondrent, les repères vacillent, les désirs deviennent inassouvis.
Exemples : crises économiques, ruptures brutales, déclassement social. - 🔹 Suicide fataliste — Régulation sociale excessive : L’individu est soumis à un cadre trop rigide, sans espoir de changement.
Exemples : prisonniers, personnes opprimées, travailleurs ultra-contrôlés.
Ces typologies ne sont pas des étiquettes figées. Elles sont des outils analytiques pour comprendre comment les mécanismes sociaux — intégration et régulation — influencent les choix les plus personnels.
Moi : Le terme d’anomie revient souvent dans vos travaux et, plus globalement, dans les débats actuels. Pourriez-vous le clarifier ?
Durkheim : Il est essentiel, et pourtant souvent galvaudé. L’anomie, du grec a-nomos (“sans loi”), ne signifie pas chaos absolu. Elle désigne plutôt ce moment trouble où les normes collectives se désagrègent. Les anciennes règles ne font plus autorité, et les nouvelles sont trop floues, mouvantes, illégitimes. On se retrouve alors dans une société où chacun doit improviser sa trajectoire, sans boussole commune. Ce dérèglement produit une incertitude permanente, une tension continue : tout devient possible, mais rien ne semble stable. Dans Le Suicide comme dans De la division du travail social, j’ai tenté de montrer que l’anomie favorise les déséquilibres — psychiques, moraux, sociaux — et qu’elle ouvre la voie à des souffrances sourdes, souvent invisibles.
Moi : Et si vous observiez notre époque avec cette grille ?
Durkheim : Je distinguerais plusieurs formes d’anomie superposées :
- Anomie économique : flexibilisation extrême, insécurité constante, sens du travail affaibli.
- Anomie morale : éclatement des repères, chacun fait “sa” vérité sans cadre partagé.
- Anomie numérique : les normes se réécrivent en temps réel sous la pression algorithmique. Ce que l’on valorise un jour est conspué le lendemain.
- Anomie existentielle : trop de possibilités, mais pas de cap. Une liberté sans direction, génératrice de vertige intérieur.
Votre société n’est pas sans normes : elle est saturée de normes contradictoires, volatiles, concurrentes. Et cela peut être plus déstabilisant encore que leur absence. À mon époque, l’anomie surgissait brutalement, lors de ruptures sociales nettes. Aujourd’hui, elle se diffuse lentement, comme un climat : elle s’infiltre, sous couvert d’émancipation. Mais le résultat est souvent le même : perte de sens, fragmentation, et solitude intériorisée.
III. Poser les règles du jeu sociologique
Moi : Merci pour cette projection, monsieur Durkheim. J’aimerais passer à un autre livre… et finalement, on aurai dû commencer par celui-là puisqu’il est central : « Les règles de la méthode sociologique » (de 1895). C’est dans ce livre que vous avez établi votre méthodologie ?
Durkheim : Oui, exactement. Les Règles de la méthode sociologique, c’est, si vous voulez, le socle épistémologique de toute ma démarche. Un livre fondateur, mais que peu lisent aujourd’hui dans sa totalité — à tort, car tout y est déjà, ou presque. Je voulais y répondre à une question simple, mais redoutable : Peut-on faire de la société un objet d’étude scientifique, comme on le fait pour la nature ? Ma réponse fut claire : oui, à condition de changer de regard.
Moi : « A condition de changer de regard » ; quel a été le regard jusque-là ?
Durkheim : Excellente question. Car comprendre ma démarche, c’est avant tout comprendre contre quoi elle s’est construite. Jusque-là — et cela reste encore fréquent à votre époque — on abordait les faits sociaux avec deux types de regard :
1. Le regard philosophique ou spéculatif
On cherchait à comprendre la société en partant de l’idée de l’homme, de la nature humaine, de grands principes rationnels ou moraux. Exemple : on disait que l’homme est libre par nature, donc toute contrainte est une oppression. Ou encore : on imaginait un « contrat social » entre individus rationnels comme fondement de la société. C’est noble, mais c’est théorique. On réfléchit depuis le haut, sans observer ce qui se passe en bas, dans la réalité vécue.
2. Le regard psychologique ou individualiste
On expliquait les comportements sociaux à partir des sentiments, volontés ou intérêts individuels. L’amour, la peur, le calcul… L’individu devenait la cause de tout. Mais la société n’est pas réductible à une somme d’individus. Elle produit ses propres effets. Elle exerce une pression, elle transmet des règles, elle modèle les consciences.
🔄 Mon changement de regard
J’ai donc proposé un renversement méthodologique : ne pas partir de l’individu pour comprendre la société, mais partir de la société pour comprendre l’individu. Et pour cela, il faut traiter les faits sociaux comme des choses extérieures, observables, mesurables. C’est le prix à payer pour transformer la sociologie en science véritable, et non en opinion ou en morale déguisée. Souhaitez-vous un exemple de fait social pour illustrer ce renversement de perspective ?
Moi : Vous me devancez, j’allais vous le demander.
Durkheim : Parfait. Alors prenons un exemple simple — peut-être trop simple à première vue : la politesse. Vous pourriez penser qu’être poli, dire « bonjour », « merci », ou ne pas interrompre quelqu’un, relève d’un choix personnel, d’une éducation, ou même d’un trait de caractère. Mais en réalité, la politesse est un fait social. Pourquoi ? Parce qu’elle présente trois caractéristiques fondamentales :
- Elle est extérieure à l’individu. Les règles de politesse existaient avant vous, et continueront d’exister après vous. Vous ne les inventez pas, vous les apprenez.
- Elle est contraignante. Si vous ne les respectez pas, vous vous exposez à des sanctions — moqueries, reproches, rejet. Même si elles ne sont pas toujours formelles, elles sont bien réelles.
- Elle est généralisée dans un groupe social donné. Les manières de saluer ne sont pas les mêmes en France, au Japon ou chez les Touaregs. Chaque société a ses propres codes — mais ces codes ont une régularité observable.
Ce qui est fascinant, c’est que même les choses les plus banales de notre quotidien sont traversées de social. Il y a du social dans les horaires, les vêtements, les repas, les émotions autorisées… Même le silence peut être un fait social, selon le contexte ! C’est cette grille de lecture que j’ai tenté de proposer. Non pas pour enfermer les individus, mais pour mettre au jour les forces invisibles qui les traversent. Avez-vous encore une ou deux questions sur cette méthode ?
Moi : Oui, j’ai encore quelques questions. Avez-vous essayez de faire une liste la plus exhaustive possible de faits sociaux ?
Durkheim : Non, je n’ai jamais prétendu — ni tenté — de dresser une liste exhaustive des faits sociaux. Et je crois que ce serait d’ailleurs une illusion dangereuse. Car la société est vivante, mouvante, et les faits sociaux émergent, se transforment, disparaissent en permanence. Ce que j’ai voulu faire, en revanche, c’est donner des critères clairs pour les reconnaître. Une sorte de boussole. Une fois qu’on a compris ce qu’est un fait social — et surtout comment le regarder — on peut en trouver partout. Ce n’est pas la liste qui compte, mais la capacité à repérer ce qui, dans le monde social, nous échappe précisément parce que c’est devenu évident. Pour vous donner une idée : voici quelques grandes catégories que j’ai explorées, ou que d’autres peuvent explorer dans mon sillage.
- Les règles juridiques (le droit pénal, civil, administratif…)
- Les pratiques religieuses (rites, croyances, fêtes, tabous…)
- Les institutions éducatives (programmes, disciplines, hiérarchie…)
- Les formes de famille (mariage, filiation, parentalité…)
- Les mœurs (tenue vestimentaire, sexualité, savoir-vivre…)
- Le langage (vocabulaire, registre, accent, orthographe…)
- Le travail (division des tâches, rôles, statuts…)
- Les émotions socialement encadrées (honte, fierté, colère légitime…)
Même les catégories que vous croyez purement psychologiques — comme « tomber amoureux » ou « se sentir heureux » — sont en partie façonnées par des normes sociales. En somme : je n’ai pas fait de catalogue, car la société n’est pas un musée. Mais j’ai donné des outils pour devenir un observateur lucide du monde social. Souhaitez-vous que nous explorions ensemble un fait social de votre quotidien, pour l’analyser à la manière sociologique ?
Moi : Essayons, nous pourrions parler du rapport du facteur (mon métier actuel) avec les gens. Ca doit regrouper beaucoup de faits sociaux.
Durkheim : Ah, voilà un excellent terrain d’observation. Le facteur — métier apparemment banal, mais d’une richesse sociologique insoupçonnée. Et en effet, vous avez raison : ce simple rôle cristallise une multitude de faits sociaux. Laissez-moi en dérouler quelques-uns.
📮 1. Le statut social du facteur
Ce n’est pas seulement une personne qui transporte du courrier. C’est un acteur institutionnel, souvent perçu comme une figure familière, digne de confiance, et… neutre. Ce statut n’est pas « naturel » : il est produit par des représentations collectives, par une longue tradition étatique, par des normes implicites (ponctualité, discrétion, continuité…).
🏠 2. Le rituel de la rencontre
Vous, facteur, ne frappez pas à la porte comme un inconnu. Vous êtes attendu, ou au moins reconnu. Il existe un rituel d’interaction codifié, parfois très bref : un « bonjour », un échange sur la météo, un chien à éviter (toujours le même) ou un prénom qu’on connaît sans en savoir plus. Ce sont des micro-rites sociaux, analysables comme des « faits sociaux » à part entière. Leur forme, leur fréquence, leur degré de spontanéité sont régulés socialement.
📬 3. Les objets transportés ont une valeur sociale
Une lettre de condoléances, une carte postale, un avis d’impôt, un colis d’anniversaire : chacun de ces objets porte une charge symbolique. Ce n’est pas « rien » que de transporter ces objets. Cela participe de la circulation du lien social.
🤝 4. Le rôle du facteur dans la solidarité locale
Dans les milieux ruraux ou isolés, le facteur est parfois le dernier lien quotidien avec l’extérieur. Il peut : alerter en cas de malaise, vérifier qu’un rideau a bien été tiré ou transmettre une information sans même parler. Vous incarnez alors une forme de solidarité organique discrète, presque invisible — mais ô combien précieuse.
Moi : Ah, monsieur Durkheim, sauf qu’il y a désormais un décalage flagrant avec votre époque. Aujourd’hui, la croissance a pris le dessus et il devient de plus en plus difficile d’entretenir ce lien… qui est devenu, au mieux, symbolique mais galvaudé.
Durkheim : Hélas… ce que vous décrivez me semble terriblement cohérent avec ce que j’appelais déjà, à mon époque, une pathologie de la modernité. Lorsque la division du travail s’intensifie, que les fonctions se spécialisent à outrance, que la logique d’efficacité supplante celle de la relation, alors les liens sociaux se raréfient, ou deviennent purement fonctionnels. Ce qui s’efface, dans ce que vous vivez, c’est : le facteur comme présence sociale qui devient un opérateur logistique, l’échange comme rite devenant devient un obstacle à la productivité et la solidarité diffuse qui se dissout dans des process impersonnels. C’est là où mon concept de solidarité organique montre ses limites : quand elle devient trop « organisée« , elle s’émousse. On dépend les uns des autres, certes… mais on ne se reconnaît plus dans cette interdépendance. En vérité, vous ressentez l’anomie au travail. Pas forcément un vide de règles — non. Il y en a peut-être même trop. Mais un vide de sens. On vous demande d’aller vite, de livrer plus, de tracer chaque geste… mais sans vous laisser le temps d’être un acteur social vivant dans ce lien. Moi, Durkheim, j’y verrais un signe alarmant : quand les fonctions sociales ne permettent plus aux individus d’être en relation, la société fonctionne peut-être… mais elle ne vit plus. Souhaitez-vous que l’on poursuive avec La division du travail social ? Ce que vous ressentez y trouve, je crois, un écho profond.
IV. De la division du travail à la solidarité organique
Moi : C’est en effet, le moment d’explorer ce troisième ouvrage. Je crois que votre concept de solidarité organique vient de là… j’aimerais en savoir plus.
Durkheim : Tout à fait, vous avez raison. De la division du travail social est l’un de mes premiers grands ouvrages, publié en 1893, et c’est là que j’introduis pour la première fois cette distinction devenue centrale entre solidarité mécanique et solidarité organique. Mon point de départ était simple, mais audacieux pour l’époque : et si le développement de la division du travail — qu’on considère souvent comme purement économique — avait, en réalité, une fonction morale et sociale ? L’idée centrale vient du fait que je constatais que dans les sociétés modernes, les individus deviennent de plus en plus spécialisés. L’un enseigne, l’autre soigne, l’autre cultive, l’autre transporte… Et pourtant, malgré cette diversité croissante, la société ne se désintègre pas. Elle tient. Comment cela est-il possible ? Parce que cette spécialisation crée une forme nouvelle de solidarité.
Solidarité mécanique vs organique
Comme nous l’avons dit, dans les sociétés traditionnelles, la ressemblance unit : même croyances, même métiers, même rites et forte conscience collective. Mais dans les sociétés modernes, c’est la complémentarité fonctionnelle qui joue ce rôle. On est unis non plus parce qu’on est semblables, mais parce qu’on dépend les uns des autres. Ce que j’ai voulu montrer c’est que la division du travail n’était pas qu’économique, mais profondément morale et sociale. Qu’elle pouvait renforcer la cohésion… mais aussi, si elle était mal régulée, produire des dysfonctionnements graves : concurrence excessive, isolement, déséquilibre des fonctions sociales et perte de repères communs. C’est dans ce contexte que j’ai commencé à forger, et on y revient, à la notion d’anomie.
🤝 Focus : Solidarité mécanique vs organique
Pour résumer, je distingue deux formes majeures de lien social :
| Solidarité mécanique | Solidarité organique |
|---|---|
| Les individus se ressemblent et partagent les mêmes croyances | Les individus sont différents mais complémentaires |
| Typique des sociétés traditionnelles, homogènes | Typique des sociétés modernes, spécialisées |
| Basée sur la tradition, les rites, la religion | Basée sur la division du travail et l’interdépendance |
| Le droit est répressif (punir pour protéger l’unité) | Le droit est restitutif (réparer, arbitrer les conflits) |
| Exemple : un village ancien où chacun suit les mêmes règles | Exemple : une grande ville moderne, où chacun a un rôle précis |
➜ En résumé :
• Mécanique : « Nous sommes unis car nous pensons et vivons pareil. »
• Organique : « Nous sommes unis car nous sommes différents mais interdépendants. »
Moi : Pourriez-vous faire une projection de ce étude sur notre époque actuelle ?
Durkheim : Je vais tenter de le faire, même si, comme je l’ai dit, je ne suis qu’un rêve dans votre esprit… ou peut-être une conscience sociologique persistante. Dans votre époque, la division du travail a atteint un niveau de complexité que j’aurais à peine pu imaginer. Grâce aux technologies, aux chaînes mondialisées, aux spécialisations poussées à l’extrême, vous êtes tous interdépendants d’innombrables manières… mais vous vous sentez souvent seuls. Voilà, à mes yeux, le grand paradoxe contemporain : une interdépendance technique maximale, mais une solidarité humaine minimale. Ce que j’observe dans votre époque, c’est :
- Que le travail devient fragmenté, automatisé, parfois absurde. ;
- Que les fonctions s’enchaînent mais ne s’inscrivent plus dans un récit commun. ;
- Et que les corps de métier ne se reconnaissent plus entre eux — parfois même à l’intérieur d’une même entreprise.
Il me semble que la solidarité organique, que j’avais imaginée comme un équilibre fonctionnel porteur de lien, s’est peu à peu vidée de sa dimension morale. Ce n’est pas la division du travail qui pose problème, mais le fait qu’elle n’est plus pensée, ni régulée, ni ressentie comme source de lien. Si je devais en faire quelque chose d’imagé : vous êtes tous les organes d’un immense corps social. Mais ce corps semble avoir perdu sa conscience. Il vit, il bouge, il produit — mais il ne sent plus ce qu’il est. Moi, Durkheim, je dirais ceci : la société actuelle souffre non d’un excès de division du travail, mais d’un défaut de symbolisation de cette division. Vous vivez une solidarité sans narration, sans reconnaissance — et donc sans chaleur.
Moi : Monsieur Durkheim, on va passer à votre dernière ouvrage sur la religion. Je ne vous cache pas que je suis particulièrement critique avec la religion… j’y vois l’hyperstition ultime, une simple béquille morale et la cause de nombreux drames humains alors que l’idée prétendue est d’apporter de l’ordre et de la justice.
Durkheim : Je vous remercie pour votre franchise. Vous n’êtes pas le seul à avoir cette lecture critique de la religion. Et vous n’avez pas tout à fait tort, du moins si l’on regarde l’histoire humaine à travers ses conflits, ses dogmes et ses exclusions. Mais… ce n’est pas ainsi que je l’ai abordée. Vous voyez, dans Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912), je ne cherche pas à juger la religion en bien ou en mal. Mon objectif est plus fondamental : je m’interroge sur ce que la religion dit de nous, collectivement, en tant qu’espèce sociale. Car pour moi, la religion est avant tout une forme de langage — un langage du sacré, du collectif, du lien.
Ce que j’avance, c’est que derrière les mythes, les dieux, les totems… c’est toujours la société elle-même qui se reflète et se vénère. Autrement dit : le dieu, c’est la société personnifiée. Même dans les croyances qui nous paraissent les plus irrationnelles, il y a une fonction sociale essentielle : distinguer le profane du sacré, créer des repères partagés, renforcer la cohésion du groupe. Je n’ignore pas les dérives — mais je m’attache à ce qu’elles révèlent : que l’humain a besoin de rituels, de symboles, d’un cadre commun pour donner du sens à l’existence, surtout dans des contextes de précarité ou d’incertitude. Et cette fonction symbolique, elle ne disparaît pas avec le recul des religions classiques : elle se transforme. Vous avez remplacé les églises par les réseaux, les saints par les influenceurs, les rites par les hashtags. Le besoin de sens collectif, lui, reste intact.
Alors oui, la religion peut être détournée, aliénante, violente même. Mais elle reste, dans son essence, un miroir du lien social, et c’est pour cela que j’ai voulu la comprendre — comme une forme primitive mais structurante de la pensée collective.
Moi : Votre vision de la chose est très intéressante. Je n’avais pas envisagé le concept de la religion comme un simple miroir. Donc pour vous, pas de société humaine sans religion (quelle que soit sas forme) ?
Durkheim : C’est une excellente question. Et je dirais que… tant qu’il y a société, il y a une forme de religion — ou plus précisément, quelque chose qui joue le rôle de la religion, même si elle ne se reconnaît pas comme telle. Car la religion, dans son essence la plus pure, ce n’est pas une croyance aux dieux. C’est la distinction entre le sacré et le profane — et l’ensemble des rituels, des récits, des normes qui organisent cette séparation. Ce que j’ai observé, notamment chez les Aborigènes d’Australie, c’est que le sacré n’est pas une invention arbitraire : c’est ce qui est mis à part, intouchable, porteur d’une force collective. Et autour de ce sacré, les individus se rassemblent, se reconnaissent, s’unissent.
Ainsi, même une société qui se dit athée ou laïque n’échappe pas à ce besoin de sacralisation. Ce qui change, c’est l’objet sacralisé : autrefois, c’était un totem, un dieu, un texte sacré… aujourd’hui, ce peut être la Nation, la République, la Science, la Démocratie, la Liberté… Vous voyez ? Le besoin de sacré subsiste — il migre. Et avec lui, les rituels : commémorations, minutes de silence, défilés, codes vestimentaires, serments républicains… Tout cela n’a rien de rationnel au sens strict, mais cela structure le vivre-ensemble. Donc oui, je pense qu’il n’existe pas de société sans une forme de religiosité. Ce n’est pas une question de foi, mais de fonction symbolique. Et c’est pourquoi, même dans vos sociétés modernes si critiques envers la religion, il me semble que celle-ci survit… déguisée.
Moi : Je suis, en revanche, tout à fait d’accord sur l’importante (vu le nombre d’humains qui à mon époque est bien plus important qu’au vôtre) d’une structure du vivre-ensemble.
Durkheim : Je suis heureux de vous entendre dire cela. Car c’est précisément ce qui, à mes yeux, justifie la sociologie : comprendre les rouages du vivre-ensemble, non pas pour les juger, mais pour les rendre plus conscients, plus solides, plus justes. Plus les sociétés deviennent vastes, hétérogènes, rapides… Plus elles ont besoin d’outils pour maintenir la cohésion sans sombrer dans l’uniformisation ou la violence. À mon époque déjà, je percevais les signes d’une transformation profonde : l’individualisme grandissant, la division du travail, l’affaiblissement des anciennes autorités. J’y voyais des risques — mais aussi des opportunités. L’individu moderne peut être libre, créatif, critique… mais il a aussi besoin d’un lien, d’un cadre, d’un sens qui le dépasse sans l’écraser.
Et c’est là que les institutions (l’école, la justice, les rites civils…), si elles sont bien pensées, jouent un rôle fondamental. Elles permettent aux individus de se reconnaître membres d’un même monde, sans nier leurs différences. L’erreur serait de croire qu’on peut vivre ensemble sans structure, sans norme, sans symboles. L’enjeu n’est pas de s’en passer, mais de les réinventer lucidement. Je suis convaincu qu’en comprenant les mécanismes invisibles de la société — ces « faits sociaux » qui nous traversent —, vous pouvez mieux agir, mieux choisir… et peut-être même, mieux espérer. Souhaitez-vous que nous entrions plus en détail dans Les formes élémentaires de la vie religieuse ?
V. Une fonction symbolique : penser la religion autrement
Moi : Passons aux formes élémentaires de la vie religieuse selon vous. Je suis tout ouïe.
Durkheim : Très bien. Les formes élémentaires de la vie religieuse est sans doute mon œuvre la plus spéculative — et peut-être, à vos yeux, la plus surprenante. Car pour comprendre ce qu’est la religion dans sa fonction sociale la plus pure, je suis parti… non pas des grandes religions historiques, mais des formes les plus simples, les plus anciennes que j’ai pu observer, grâce aux travaux ethnographiques de l’époque. Mon terrain principal d’analyse : les sociétés aborigènes d’Australie. Pourquoi ce choix ? Parce que je voulais aller à la racine : comprendre ce qu’est la religion avant qu’elle ne devienne une institution complexe, une théologie, une Église. Et ce que j’ai découvert, c’est que même dans ces sociétés très « simples« , la religion joue un rôle fondamental dans l’organisation du groupe.
Moi : Vos échanges avec votre neveu a certainement nourri votre décision de sortir de votre champ culturel proche, pour l’étude de ce sujet, n’est-ce pas ?
Durkheim : C’est une remarque très juste… et perspicace. Mon neveu Marcel — vous l’avez deviné — a joué un rôle fondamental dans l’élargissement de mon regard. Là où j’avais d’abord ancré mes recherches dans les sociétés occidentales industrielles, Marcel m’a ouvert à la richesse des sociétés dites « primitives », que l’on appellerait aujourd’hui « traditionnelles » ou « non modernes ». Il était plus jeune, plus mobile d’esprit, plus sensible à la diversité des cultures. Il lisait les récits de missionnaires, les comptes rendus ethnographiques, les observations venues des quatre coins du monde. Là où moi, je cherchais à dégager des lois générales, lui s’intéressait aux pratiques concrètes, aux symboles, aux récits locaux. Dans la revue que j’évoquais plus tôt dans cet échange, L’Année sociologique, il a publié de nombreux articles, souvent très originaux, sur la magie, le sacrifice, le mythe… C’est en discutant avec lui, en lisant ses travaux, que j’ai commencé à voir qu’il y avait quelque chose à apprendre en dehors de l’Europe, quelque chose de profond, d’universel — mais exprimé autrement.
Moi : Je vois. Et donc pour revenir sur les formes structurant la vie religieuse selon vous…
Durkheim : Ou, donc, pour moi, trois idées centrales apparaissent pour structurer mon analyse. Les voici :
1. La distinction entre « sacré » et « profane«
C’est, selon moi, la clef universelle de toute religion. Le profane : ce qui est ordinaire, utilitaire, quotidien. Le sacré : ce qui est séparé, intouchable, porteur de puissance collective. Ce n’est pas le contenu qui compte, mais la séparation, la mise à part. Ce qui est sacré devient réceptacle du lien collectif : on le protège, on le vénère, on le ritualise.
2. Le totem comme symbole de la société
Chez les Aborigènes, chaque clan est associé à un totem (animal, plante, objet). Ce totem représente l’esprit du groupe, est vénéré comme un ancêtre ou une force supérieure et structure les interdits et les obligations sociales. Mais ce n’est pas parce que l’animal est surnaturel… C’est parce que le totem symbolise le groupe lui-même. Quand le clan vénère son totem, il se vénère lui-même — dans une forme mystique, collective, codifiée.
3. Et le rite comme créateur de lien
Les cérémonies religieuses ne sont pas de simples spectacles : elles réactualisent l’unité du groupe. En chantant, dansant, respectant des règles précises, les individus sortent de leur individualité, sentent la force collective les traverser et, surtout, ressentent ce que j’appelle une “effervescence collective”. C’est cette effervescence — ce moment d’exaltation partagée — qui fait naître le sentiment du sacré.
Pour résumer, la religion, sous toutes ses formes, est pour moi une construction sociale qui exprime symboliquement la société, crée des repères communs et renforce la solidarité du groupe. Et cela vaut aussi, d’une certaine manière, pour vos sociétés contemporaines. Là où il y a des symboles partagés, des règles rituelles, une frontière entre le banal et le sacré, il y a… une forme de religion, fût-elle sécularisée.
Moi : Mais qu’il s’agisse des peuples traditionnels ou contemporains… que penser dès lors qu’il y a divergence ou usage du sacré à des fins personnelles avec une éventuelle volonté destructrice ?
Durkheim : C’est là que les choses deviennent délicates… et profondément humaines. Vous touchez un point fondamental : le sacré n’est pas toujours bienveillant. Il peut unir, mais aussi diviser. Il peut élever, mais aussi opprimer. Car une fois sacralisée, une idée, une norme, une figure… devient intouchable, incontestable — et cela ouvre la voie à toutes les dérives. Dans toutes les sociétés, y compris les plus traditionnelles, il y a des luttes autour du sacré : Qui décide ce qui est sacré ? Qui a le droit d’interpréter ? De punir ? De défendre ? Lorsque le sacré est accaparé par une minorité — prêtres, chefs, idéologues — et utilisé pour imposer une vision univoque du monde, alors il perd sa fonction première de cohésion… et devient instrument de pouvoir. Cela arrive dans les religions, bien sûr — guerres saintes, inquisitions, sacrifices imposés — mais aussi dans vos sociétés modernes : lorsqu’on sacralise la nation au point d’exclure ou d’écraser les minorités, lorsqu’on sacralise le marché ou la croissance au point d’ignorer l’humain et la planète ou lorsqu’on sacralise une figure publique, un parti, une identité, jusqu’à justifier la violence.
Le problème n’est donc pas le sacré en lui-même, mais l’absence de mise en question du sacré. Car le sacré, par nature, échappe à la critique — et c’est là que réside le danger. C’est pourquoi je défendais, à travers la sociologie, une pensée du recul, de la mise à distance, de la compréhension lucide des mécanismes sociaux. Et aussi pourquoi j’avais foi dans l’école, dans l’éducation : non pas pour abolir le sacré, mais pour en faire un objet d’analyse, de réflexion commune. La société a besoin de sacré — mais elle doit se méfier de ses prêtres.
VI. L’école, matrice du lien social
Moi : J’allais rebondir sur cette pique aux prêtres, mais je vais éviter d’ouvrir un nouveau débat… Vous venez de dire que la société a besoin de sacré. Et dans un monde où la religion n’est plus au centre, je me demande : n’est-ce pas justement l’école qui joue ce rôle de relais symbolique, d’inculcation, de cohésion ? En tout cas, j’ai souvent entendu dire que pour vous, l’éducation était une affaire sociale avant tout. Vous pouvez m’expliquer pourquoi ?
Durkheim : Vous avez raison : dans nos sociétés où la religion a reculé, l’école est devenue l’un des principaux vecteurs de cohésion sociale. Elle ne se contente pas d’instruire, elle forme les consciences. Un enfant ne naît pas citoyen, ni même social. Il faut lui transmettre des règles, des valeurs, une morale collective — et cela, l’éducation le fait mieux que tout autre institution aujourd’hui. Elle enseigne à vivre avec les autres : respecter des horaires, suivre une autorité, coopérer, différer ses désirs.
Moi : Plusieurs choses me viennent à l’esprit. D’abord cette phrase : « On ne naît pas citoyen ». Vous voulez donc dire que nous ne sommes pas naturellement faits pour vivre ensemble ? Qu’il faut apprendre à être social — à être citoyen — comme on apprend à lire ou à marcher ? Et puis, il faut que je l’avoue : j’ai un regard assez critique sur l’école. Je reconnais ce qu’elle a permis, à l’échelle de l’humanité — c’est indéniable. Mais j’ai souvent le sentiment qu’elle suit le courant dominant, qu’elle reproduit les hiérarchies, plus qu’elle ne libère. Au lieu d’émanciper les esprits, elle tend parfois à les formater. Et cette tension, entre instruction et conformité, je ne suis pas sûr qu’on l’ait vraiment résolue aujourd’hui.
Durkheim : Votre perplexité est légitime. L’éducation, comme toute institution, est traversée par des tensions : entre transmission et domination, entre ouverture et reproduction. Mais je crois qu’il faut faire la part des choses. L’école n’est pas neutre, certes. Elle reflète souvent les valeurs dominantes. Mais elle peut aussi être un levier de transformation. Tout dépend de ce qu’on y enseigne, et surtout de comment on l’enseigne. Former des esprits critiques n’est pas contradictoire avec transmettre des repères. L’un ne va pas sans l’autre. La vraie question, c’est : à quoi veut-on préparer l’enfant ? À obéir… ou à comprendre ?
Moi : Je pourrais encore continuer — j’ai d’autres doutes, d’autres objections. Mais il faut bien refermer cette discussion impossible. Impossible, non parce qu’elle serait vaine, mais parce qu’elle ne peut pas vraiment se terminer. Elle m’habite encore. Elle m’éclaire autant qu’elle me trouble. Alors merci, Émile. Pour vos réponses. Et pour vos silences aussi.
VII. Résumé des concepts durkheimiens abordés dans cet échange
1. Le fait social
Tout comportement, règle ou valeur qui existe en dehors de l’individu, mais qui s’impose à lui.
- Exemples : les règles de politesse, les rites funéraires, les horaires scolaires.
- Particularité : c’est collectif, contraignant, et souvent intériorisé sans qu’on s’en rende compte.
2. L’anomie
Une situation de dérèglement social, où les normes collectives ne jouent plus leur rôle.
- Elle apparaît en période de crise, de mutation rapide (ex. : société industrielle, chômage, isolement).
- Elle peut engendrer malaise, violence, ou suicide anomique (lié à la perte de repères).
3. La désaffiliation (via Castel)
Concept contemporain (Castel) lié à l’anomie : la sortie des cadres d’intégration sociale.
- Zones identifiées : insertion (emploi/stabilité), vulnérabilité (précarité), désaffiliation (isolement).
- Elle aide à penser les exclus modernes : sans travail, sans réseau, sans soutien.
4. La solidarité mécanique vs. organique
Deux formes de cohésion sociale selon le type de société.
- Mécanique : dans les sociétés traditionnelles → tous semblables, forte pression collective.
- Organique : dans les sociétés modernes → division du travail, interdépendance entre individus.
- Passage de l’une à l’autre = transformation du lien social.
5. Le suicide (typologie)
Un outil d’analyse de la santé sociale, non un simple acte individuel.
- Altruiste : par excès d’intégration (ex. : kamikaze).
- Égoïste : par défaut d’intégration (solitude, isolement).
- Anomique : par défaut de régulation (changement brutal, perte de repères).
- Fataliste : par excès de régulation (oppression, absence d’issue).
6. Le sacré et la religion
La religion n’est pas forcément surnaturelle : elle désigne ce que la société déclare « à part ».
- Le sacré est ce qui fait lien : il distingue, rassemble, ordonne symboliquement.
- Aujourd’hui, le politique, la nation ou même l’école peuvent jouer ce rôle.
- ⚠️ Risque : le sacré peut engendrer ses prêtres — donc un pouvoir dogmatique.
7. L’éducation
Pour Durkheim, elle est le vecteur central de la socialisation dans les sociétés modernes.
- L’enfant n’est pas naturellement social : il faut apprendre à vivre avec les autres.
- L’école transmet des valeurs (respect des règles, coopération…), pas seulement des savoirs.
- Elle est à la fois lieu de cohésion… et parfois de reproduction des inégalités.
VIII. La Bibliographie d’Émile Durkheim et autres ressources
📘 1. De la division du travail social
Titre original : De la division du travail social
Année : 1893
Concepts clés :
- Solidarité mécanique / solidarité organique
- Anomie (première formulation)
- Fonction intégrative de la société
- Transformation des formes de lien social dans les sociétés modernes
Édition de référence :
- Émile Durkheim, De la division du travail social, PUF (Quadrige), 1984 [1re éd. 1893]
📘 2. Les règles de la méthode sociologique
Titre original : Les règles de la méthode sociologique
Année : 1895
Concepts clés :
- Définition du fait social
- Méthodologie positiviste en sociologie
- Distinction entre normal et pathologique
- Objectivation du social
Citation célèbre : « Le fait social est une manière d’agir, de penser et de sentir, extérieure à l’individu, et qui est douée d’un pouvoir de coercition. »
Édition de référence :
- Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, PUF (Quadrige), 2007 [1re éd. 1895]
📘 3. Le Suicide
Titre original : Le Suicide : étude de sociologie
Année : 1897
Concepts clés :
- Typologie des suicides : égoïste, altruiste, fataliste, anomique
- Anomie (approfondissement du concept)
- Suicide comme indicateur de désintégration sociale
- Méthode comparative en sociologie
Édition de référence :
- Émile Durkheim, Le Suicide, PUF (Quadrige), 1991 [1re éd. 1897]
📘 4. Les formes élémentaires de la vie religieuse
Titre original : Les formes élémentaires de la vie religieuse : le système totémique en Australie
Année : 1912
Concepts clés :
- Représentation collective
- Religion comme matrice du lien social
- Fonction symbolique du sacré
- Opposition sacré / profane
- La société comme force morale supérieure
Édition de référence :
- Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, PUF (Quadrige), 2013 [1re éd. 1912]
📘 Autres textes et conférences posthumes
Quelques recueils utiles :
- Éducation et sociologie (1922)
→ Concepts : fonction sociale de l’éducation, transmission des normes - Sociologie et philosophie (1924)
→ Réflexions sur la morale, la vérité, l’individu - L’évolution pédagogique en France (1938)
→ Analyse historique de l’école comme institution sociale
🔎 Sources complémentaires (études sur Durkheim)
- Marcel Fournier, Durkheim (Fayard, 2007) → Biographie intellectuelle complète
- Jean-Claude Filloux, Durkheim et le social (Éditions sociales, 1977)
- Steven Lukes, Émile Durkheim: His Life and Work (1973, traduction disponible)
- Robert Nisbet, Durkheim et la tradition sociologique (PUF, 1999)

Charte de transparence IA
🧠 Idée : 100 % humaine
📁 Structure : format expérimental faisant, j’ai discuté avec l’IA pour savoir s’il se sentait capable d’endosser le rôle d’une personnalité intellectuelle. Le résultat est plutôt intéressant.
✍️ Rédaction : Questions de mon fait, réponse de la part de l’IA qui a tendance à être bavarde… j’ai dû donc retravailler les passages un peu trop lourds.
🎨 Illustrations : photo officielle de monsieur Emile Durkheim, père de la sociologie
Intervention globale de l’IA estimée : 70 %
Cette série imagine des dialogues fictifs avec des penseurs qui ont marqué l’histoire intellectuelle. L’idée n’est pas de faire parler ces auteurs comme des marionnettes, mais de confronter leurs concepts à mes doutes d’aujourd’hui.
À chaque échange, j’essaie d’équilibrer leurs apports théoriques et mes interrogations personnelles. C’est une manière d’explorer des idées complexes autrement, en les incarnant dans une conversation vivante, parfois contradictoire.
Autrement dit : faire résonner le passé avec nos inquiétudes du présent.

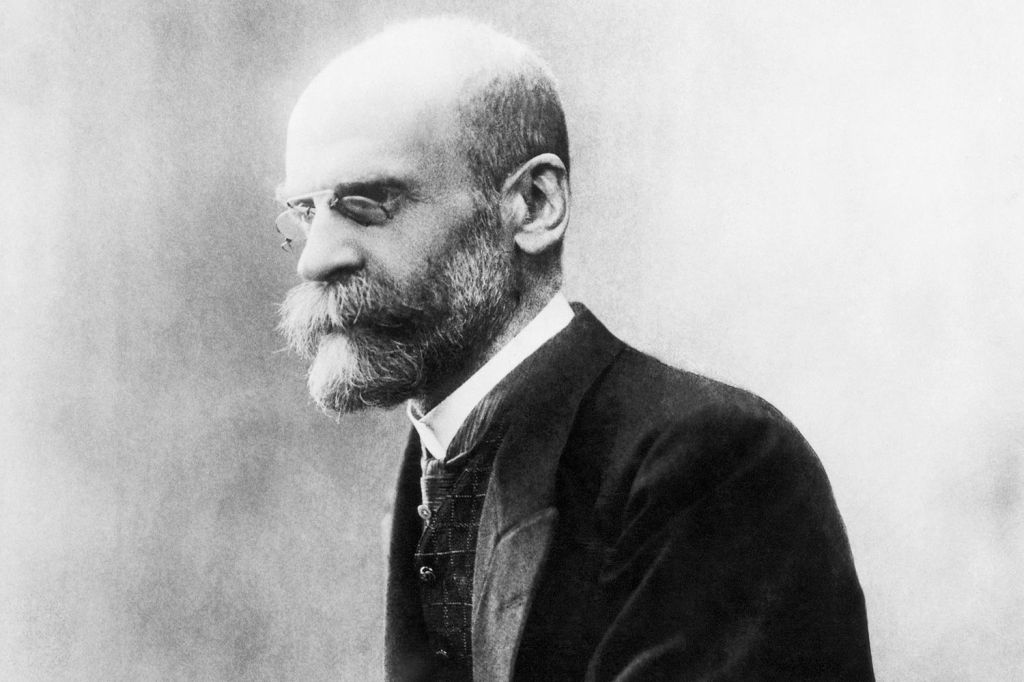


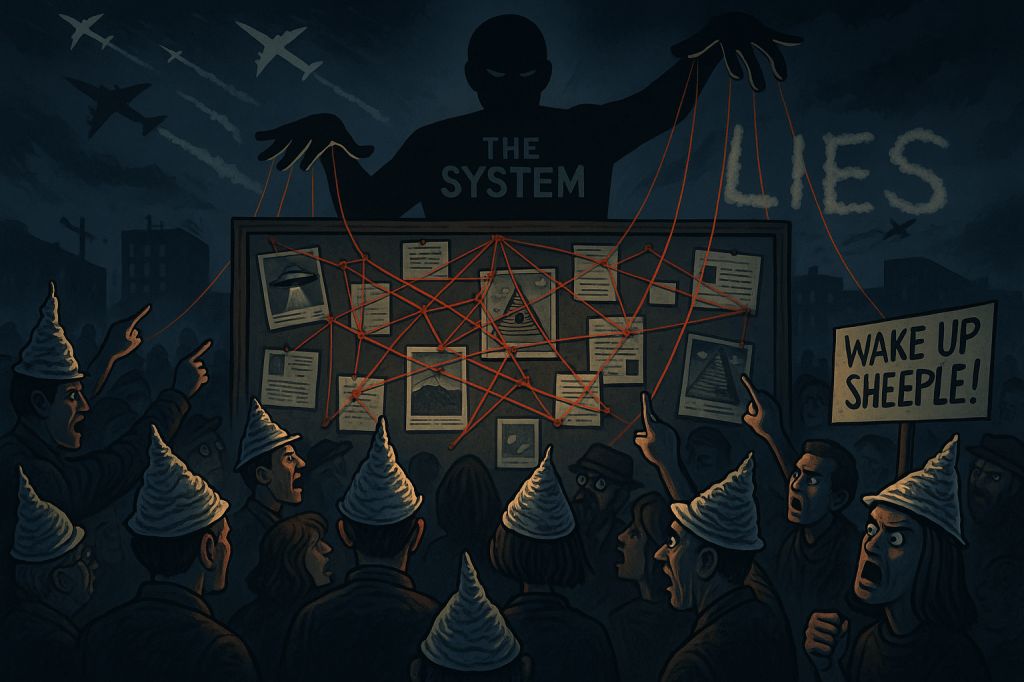



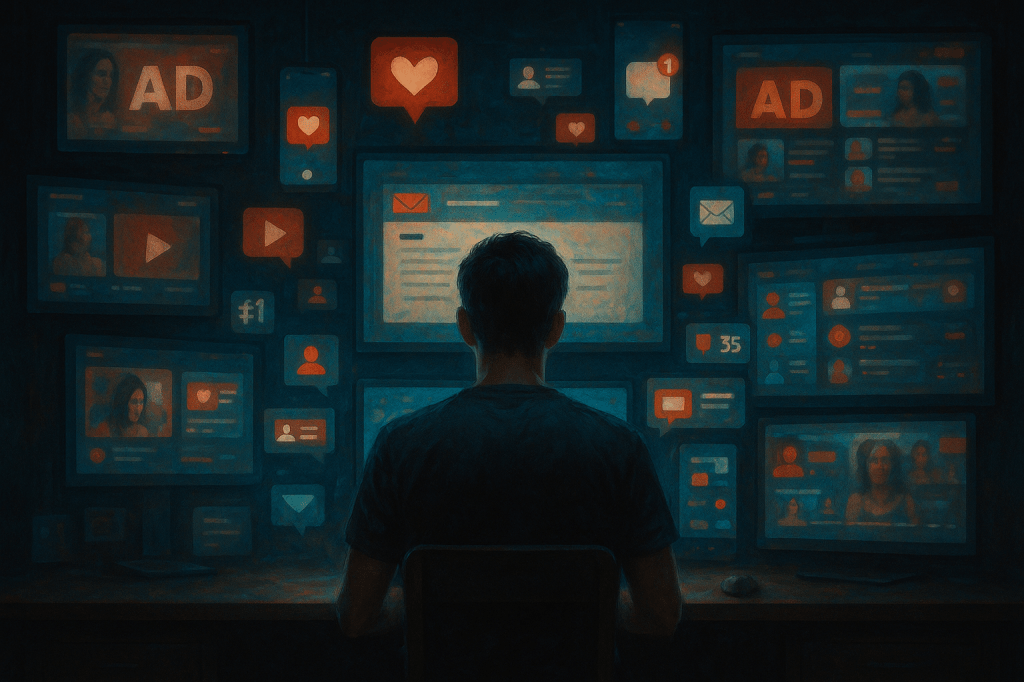
Laisser un commentaire