On peut parler la même langue, se comprendre grammaticalement… et pourtant ne pas se comprendre du tout. Ce texte raconte ce que j’ai mis des années à comprendre : que les mots ne pèsent pas pareil selon les cultures. À travers mon expérience avec le Japon — et avec moi-même — j’explore cette ligne invisible qui sépare les cultures dites « à haut contexte« , fondées sur le non-dit, dures à décrypter pour qui vient d’un monde où tout se dit. Et parfois trop.
Parfois, allez savoir pourquoi, on se sent attiré par ce qui nous est le plus étranger. Moi, ce fut le Japon. Une obsession nourrie pendant près de quinze ans. J’ai appris la langue en autodidacte, j’ai suivi une licence de culture japonaise à l’université, j’ai eu plusieurs compagnes japonaises, j’ai voyagé à Tôkyô à deux reprises… Autant dire que je croyais connaître ce pays. Mais il y avait toujours un décalage. Une sensation vague mais tenace que quelque chose m’échappait, au-delà des mots, au-delà même des coutumes. Comme une musique de fond que je n’entendais pas. Ce n’est que bien plus tard que j’ai compris : je n’écoutais pas le silence culturel. Celui qui sépare les cultures à bas contexte (low-context) — comme la mienne — des cultures à haut contexte (high-context), comme celle du Japon. En découvrant ce concept par hasard, tout s’est éclairé : il expliquait une part essentielle de ce choc culturel diffus que l’on ressent parfois, sans pouvoir le nommer, quand on sort de ses repères familiers.
I. Qu’est-ce qu’une culture à haut ou bas contexte ?
Quand on communique, on croit souvent que tout passe par les mots. Mais ce n’est vrai que dans certaines cultures. Dans d’autres, ce qu’on ne dit pas compte tout autant — parfois plus — que ce qu’on dit. C’est ce que le chercheur américain Edward T. Hall a théorisé à travers une distinction devenue centrale dans les études interculturelles : celle entre cultures à bas contexte (low-context cultures) et cultures à haut contexte (high-context cultures).
🎭 Une métaphore pour comprendre
- Une culture à bas contexte, c’est comme une pièce de théâtre avec un script écrit : tout est dit, ligne par ligne, pour que le sens soit clair pour tous.
- Une culture à haut contexte, c’est comme une danse traditionnelle transmise de génération en génération : tout est dans le geste, le rythme, l’espace, le non-dit — mais pas dans les mots.
💡 Quelques exemples concrets
- Dans une culture « low context« , on dit « Je ne suis pas d’accord » pour exprimer une divergence. Dans une culture « high context« , on ne dira rien — ou on détournera le regard, changera de sujet, rira doucement.
- En France, on signe des contrats détaillés ; au Japon, un simple accord verbal entre personnes de confiance peut suffire… parce que l’engagement est implicite, et inscrit dans la relation.
- En Occident, parler spontanément est vu comme une preuve de sincérité ; au Japon, cela peut être perçu comme un manque de contrôle ou d’élégance.
🧭 Et moi, là-dedans ?
En tant que Francophone (belgo-français), je suis naturellement du côté « low context« . J’ai appris à valoriser la parole, à dire ce que je pense, à chercher la clarté dans l’échange. Et c’est encore plus vrai ces dernières années où je cherche à comprendre et à partager mes réflexions. Mais en m’immergeant dans la culture japonaise, j’ai découvert que cette façon de faire pouvait être perçue comme trop frontale ou trop étrangère à l’harmonie recherchée. Et c’est précisément ce décalage — entre ce que je disais et ce qu’on attendait que je comprenne sans qu’on me le dise — que je vais illustrer à travers trois souvenirs personnels.
II. Vivre le « high context » sans le savoir
Ainsi, j’ai vécu à la japonaise par intermittence : d’abord comme simple touriste, puis au fil de plusieurs relations — plus ou moins longues — avec des Japonaises, entre 2004 et 2010. Il est évident que la relation était plus fluide avec celles qui avaient déjà intégré une partie des codes occidentaux. Mais le formatage culturel d’origine restait toujours perceptible, comme une couche de fond qui ne s’efface pas. Plusieurs souvenirs me reviennent aujourd’hui comme autant d’illustrations concrètes de ce qui distingue une culture à haut contexte (high context) — comme celle du Japon — d’une culture à bas contexte (low context) — comme la mienne.
1. La photo « autorisée pour les étrangers«
La scène remonte à mon tout premier séjour à Tôkyô, en 2005. J’étais avec une ancienne relation qui avait souhaité me revoir à l’occasion de mon passage. Dans un magasin dont j’ai oublié les produits, j’ai voulu photographier un objet que je trouvais remarquable. Simple réflexe de touriste moderne. Par politesse, j’ai demandé l’autorisation. On m’a alors répondu, avec un petit sourire : « comme tu es un gaijin (étranger), tu peux. » J’ai été un peu vexé. J’ai rétorqué que si les photos étaient interdites, cela devait s’appliquer à tout le monde — étranger ou non. Mais avec le recul, je comprends mieux ce que cette phrase sous-entendait.
Elle reflétait une certaine tolérance implicite vis-à-vis de l’ignorance des codes. Dans une culture high context, les règles ne sont pas écrites partout : elles sont intériorisées, partagées tacitement. En tant qu’étranger, j’étais « hors jeu » — donc exempté des attentes implicites. On ne m’en voulait pas de ne pas lire l’air (空気を読む ou « kuuki o yomu »)… on savait que je ne pouvais pas. Et moi, fidèle à ma culture low context, j’attendais des règles explicites, les mêmes pour tous. J’avais besoin qu’on me dise, plutôt que de deviner.
🌬️ Focus : Kuuki o yomu – Lire l’air
En japonais, l’expression 空気を読む (*kuuki o yomu*) signifie littéralement « lire l’air ». Elle désigne la capacité à capter les non-dits, les ambiances, les signaux faibles d’une situation sociale — bref, à adapter son comportement en fonction du contexte implicite, sans avoir besoin de mots.
Dans une culture à haut contexte comme celle du Japon, cette compétence est considérée comme essentielle : parler au mauvais moment, poser une question gênante, ou simplement « ne pas sentir l’atmosphère » peut être perçu comme une forme de maladresse ou d’égoïsme.
| 🇯🇵 Japon : *kuuki o yomu* | 🇫🇷 France : communication explicite |
|---|---|
|
Anticiper les attentes sans qu’elles soient dites. Ajuster son discours au moment, à la hiérarchie, au groupe. |
Dire ce que l’on pense. Valorisation de l’expressivité individuelle, du débat. |
|
Le silence peut être plus parlant que les mots. L’harmonie prime sur la clarté. |
Le silence est souvent perçu comme un malaise ou un vide à combler. |
| Les maladresses sociales sont rarement verbalisées : on attend une prise de conscience subtile. | Les malentendus se règlent souvent frontalement, par explication. |
Exemple concret : Lorsqu’un Japonais s’interroge sur une remarque un peu brutale, il exprime en réalité un malaise face à une parole perçue comme hors contexte. Il ne s’agit pas d’une critique du contenu, mais de son timing implicite.
À l’inverse, un Français habitué à la parole directe peut ne pas percevoir qu’il a perturbé l’équilibre du groupe ou mis mal à l’aise sans qu’on le lui dise jamais.
Lire l’air, ce n’est pas juste faire preuve d’intuition sociale : c’est maîtriser un langage invisible qui structure toute la communication japonaise.
Naturellement, je ne saurais dire s’il est réellement possible, même pour un étranger vivant au Japon depuis des années, de maîtriser pleinement l’art de « kuuki o yomu » — cette capacité à « lire l’air« , à sentir les attentes implicites, à ajuster ses paroles ou ses silences sans qu’on ait besoin de le lui dire. On me souffle dans mon oreillette que c’est possible jusqu’à une certaine limite mais qu’il est impossible de maîtriser un niveau de lecture contextuelle « intuitif« , acquis dès l’enfance au Japon ou de gérer la gestion ultra-fine de la face (tatemae/honne, uchi/soto… concepts que je vais vous expliquer un peu après) dans des situations ambiguës.
Et c’est sans doute, en y repensant, la principale difficulté quand on cherche à s’intégrer dans une culture comme celle du Japon. Les Japonais ont d’ailleurs un terme — un peu moqueur — pour désigner ceux qui ne possèdent pas cette compétence sociale pourtant attendue : KY (ケー・ワイ, prononcé « kay waye »). Cela vient de « kuuki yomenai« , littéralement : « qui ne sait pas lire l’air ». Peut-être m’a-t-on perçu ainsi, sans que je le sache. Être qualifié de KY, c’est porter l’étiquette du socialement inadapté. Trop direct, trop bavard, trop « frontal » dans un univers où la communication repose sur le non-dit. Un Français typique, même bienveillant, peut facilement tomber dans ce travers sans s’en rendre compte. Pour un Japonais, en revanche, c’est beaucoup plus grave : ne pas savoir lire l’air quand on est né dans ce système culturel, c’est comme avoir oublié un code social fondamental — une sorte de dyslexie implicite de la vie en société.
2. Une remarque sur une parole spontanée
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis plutôt bavard. J’aime parler, discuter, creuser les idées à voix haute, improviser des réflexions sans plan ni prudence. Autrement dit : je suis foncièrement « low context« — je verbalise et c’est peu de le dire. Je n’attends pas qu’on me devine. Et en France, ça passe plutôt bien : on valorise la parole, la spontanéité, l’échange. Mais à l’époque, encore dans ma « phase japonaise », cette habitude m’a parfois joué des tours. Un jour, alors que je discutais avec ma partenaire japonaise, j’ai dû dire quelque chose de trop direct, trop mal ajusté, trop… français. Sa réaction, d’apparence anodine, m’est restée gravée : « pourquoi tu dis ça, maintenant, comme ça ? »
Sur le moment, je n’ai pas compris. Mon propos d’alors n’était ni blessant, ni déplacé. Mais il n’était pas accordé au moment. Il ne lisait pas l’air (kuuki o yomu). Il tranchait dans un silence qui avait sa propre logique implicite. Dans une culture « high context« , ce n’est pas tant le contenu qui compte que, comme je le disais plus haut, le timing, le ton, l’harmonie du moment. Parler, c’est s’accorder à l’atmosphère. Ce n’est pas seulement ce qu’on dit, c’est quand on le dit, à qui, comment, et dans quelle ambiance collective. Et moi, à ce moment-là, je parlais comme on parle dans ma culture : pour exprimer quelque chose. Elle, elle attendait que je parle en résonance avec le contexte. C’est dans ce genre de détail — à peine perceptible — que se jouent les grands malentendus culturels. Pas dans les mots… mais dans l’invisible qui les entoure.
🗣️ Focus : Parler pour quoi faire ?
Dans une culture à bas contexte (*low context*), comme la France ou les États-Unis, la parole sert à exprimer une idée, un ressenti, une opinion. Elle est conçue comme un outil de communication directe, individuelle et explicite.
Dans une culture à haut contexte (*high context*), comme le Japon, la parole est un instrument d’ajustement relationnel. Elle est moins destinée à transmettre une information qu’à maintenir l’harmonie, signaler subtilement une position, ou respecter l’implicite.
| 🗺️ Bas contexte | 🌸 Haut contexte |
|---|---|
|
La parole est un droit. On parle pour clarifier, débattre, exprimer un point de vue personnel. |
La parole est une responsabilité. On parle pour préserver l’équilibre, éviter la dissonance. |
| Dire ce qu’on pense est valorisé, même si cela dérange. | Ce qu’on ne dit pas peut avoir plus de poids que ce qu’on dit. |
| Le silence est souvent perçu comme vide ou gênant. | Le silence est une forme de communication subtile, souvent chargée. |
Dans une culture low context, on parle pour être entendu. Dans une culture high context, on parle quand le moment est juste.
3. Notion du « Uchi » et « Soto » : la mise à l’écart
Pour terminer ce retour personnel, je repense à une autre période de ma vie. Je fréquentais alors une personne travaillant à l’ambassade du Japon à Bruxelles. Notre relation était agréable, fluide, mais une chose me troublait régulièrement, sans que je sache à l’époque mettre un mot dessus : lorsqu’on croisait ses collègues japonais, elle semblait me mettre à l’écart. Le ton changeait, son attitude se modifiait, comme si je n’étais plus tout à fait présent — ou pas censé l’être. À l’époque, je l’ai mal vécu. J’y voyais une forme de gêne, voire de honte. Avec mes réflexes culturels européens, cette séparation soudaine me semblait injustifiée. Mais plus tard, j’ai compris : je passais d’un cercle intime (uchi, l’intérieur) — celui du duo que nous formions en privé — à un espace extérieur (soto, l’extérieur), celui de ses relations professionnelles. Et dans la culture japonaise, ces deux sphères sont clairement séparées.
Le concept de « uchi/soto » (内 / 外) structure profondément les relations sociales au Japon. Il distingue ce qui est « à l’intérieur » (famille, proches, entreprise, groupe d’appartenance) de ce qui est « à l’extérieur » (les autres). Et selon la position dans laquelle on se trouve, le langage, le comportement, la posture changent. Ce n’est pas un rejet personnel, bien que ce fut mon ressenti. C’est un ajustement culturel à des rôles relationnels codifiés — souvent invisibles pour qui ne les a pas appris. Moi, je ne les avais pas appris. Et donc, au moment de basculer de l’un à l’autre, je me retrouvais dans une sorte de zone grise : ni pleinement dedans, ni tout à fait dehors… mais jamais exactement au bon endroit.
🔄 Focus : Uchi / Soto – Dedans et dehors
Le Japon distingue très nettement ce qui relève du uchi (内) — l’intérieur, le groupe d’appartenance — et du soto (外) — l’extérieur, les autres. Ce n’est pas une simple opposition géographique, mais un repérage culturel qui structure le langage, les comportements, les responsabilités.
| 🏠 Uchi (intérieur) | 🌐 Soto (extérieur) |
|---|---|
|
Famille, amis proches, collègues de même équipe. Langage familier, honnêteté possible. |
Inconnus, clients, hiérarchie, étrangers. Langage honorifique, prudence relationnelle. |
| On protège, on excuse, on inclut. | On se conforme, on respecte, on garde ses distances. |
| Permet une parole plus libre (avec des limites implicites). | Nécessite une adaptation constante, souvent silencieuse. |
Pour un Japonais, cette distinction est acquise dès l’enfance. Pour un étranger, elle reste souvent invisible mais structurante — et peut provoquer un sentiment de mise à l’écart sans explication.
Comprendre uchi/soto, c’est comprendre que l’appartenance ne va jamais de soi au Japon. Elle se construit lentement, elle se protège, et elle se signale… souvent sans mots.
Enfin, il serait difficile d’aborder la communication japonaise sans évoquer une autre paire de notions fondamentales : tatemae (建前) et honne (本音). Le premier désigne la façade sociale, ce que l’on exprime publiquement pour rester dans le cadre attendu. Le second, c’est le fond du cœur, ce que l’on pense ou ressent vraiment — souvent gardé pour soi, ou exprimé seulement en cercle restreint. Là encore, on retrouve cette culture du non-dit, où l’harmonie collective prime sur la transparence individuelle. Ce n’est pas de l’hypocrisie : c’est une autre conception de la sincérité, plus contextuelle, plus codée. Et pour un esprit occidental habitué à dire ce qu’il pense, le tatemae peut sembler artificiel, voire frustrant. Mais pour un Japonais, dire sa pensée sans filtre peut être perçu comme inapproprié, voire égoïste. Comme beaucoup d’Occidentaux, je suis assez éloigné de cela, ma voix et mon visage disent beaucoup… beaucoup trop pour un Japonais.
III. Ce qu’est vraiment une culture à bas contexte : regard vers l’Ouest
On pourrait croire, vu d’Europe, que la France est déjà très « low context« . Et c’est vrai, en partie : ici, on parle facilement, on s’exprime, on débat, on verbalise nos émotions sans trop de gêne. Mais il faut aller plus à l’ouest — aux États-Unis, notamment — pour découvrir ce que signifie une culture vraiment « low context« , dans toute sa logique explicite. Et là, je me dis que vous vous posez la même question que moi : et pourquoi les USA, Occidentaux comme nous, pourraient-ils être davantage « low context » que nous ?
Les États-Unis, bien qu’occidentaux comme la France, sont encore plus « low context » en raison de leur histoire fondée sur l’immigration, l’individualisme et la diversité culturelle. Dans un pays sans contexte partagé de départ, il a fallu expliciter les règles, formaliser les contrats et valoriser la parole claire et directe. L’héritage protestant renforce cette tendance à la transparence verbale et à la responsabilité individuelle. À l’inverse, la France, plus homogène historiquement, a conservé une part de non-dit culturel, de hiérarchies implicites et d’art du sous-entendu, qui la place dans un entre-deux : assez explicite pour dérouter un Japonais, mais parfois trop subtil pour un Américain. Concrètement, là-bas, on préfère tout dire, quitte à paraître lourd. Le non-dit est suspect, souvent interprété comme une volonté de cacher quelque chose. Les contrats, les consignes, les règles sont écrits, détaillés, signés. Le désaccord est normalisé, parfois même valorisé. Et le « small talk« (parler pour meubler) est un art social en soi. Et je me plains de cette pratique par ici… mais là-bas, c’est un sport national !
☕ Focus : Le small talk, ou l’art de parler pour ne rien dire (et c’est important)
Dans une culture à très bas contexte comme les États-Unis, on ne peut pas compter sur les silences, les regards ou les codes implicites pour installer une relation. Il faut tout verbaliser, même ce qui ne dit rien. Et c’est là que le small talk entre en scène.
Vous entrez dans un ascenseur ? Quelqu’un vous dira : “How’s it going?”. Vous achetez un muffin ? On vous parlera du temps qu’il fait. Vous croisez votre collègue dans le couloir ? Attendez-vous à discuter des prévisions météo ou du match d’hier.
Rien de tout cela n’a de contenu réel. Mais ce n’est pas le but. Le small talk est une forme de lubrifiant social : il montre que vous êtes sociable, inoffensif, prêt à coopérer. Ne pas en faire, c’est risquer d’être perçu comme froid, distant, voire hostile.
En France, ces échanges existent, mais sont plus brefs, plus contextuels. Parler pour ne rien dire peut vite être perçu comme du remplissage creux (oh que oui…). Chez nous, le silence n’est pas encore suspect par défaut.
Mais aux États-Unis, le silence est un vide à remplir. Et si vous n’avez rien à dire, dites-le quand même — avec le sourire.
Je suis, moi aussi, un communicant spontané… mais à côté d’un Américain, je suis presque elliptique. Et face à un Japonais, je suis un fleuve en crue. La position française est donc un entre-deux intéressant : assez directe pour choquer un Japonais, mais parfois assez subtile pour déconcerter un Américain. Je terminerai ce point en faisant un panorama de plusieurs pays pour se faire une idée plus globale :
IV. Le malentendu culturel : ce qu’on ne dit pas est ce qui compte
Dans une culture à haut contexte, parler trop, c’est ignorer le lien. La parole vient après la relation, jamais avant. Quand je dis ça, je veux dire que l’on ne parle vraiment que quand la relation est établie. Le langage est au service d’un lien préexistant : il le conforte, le nuance, le maintient. La parole ne crée pas le lien, elle le reflète. Cette parole est donc là pour préserver l’équilibre, pas pour l’imposer. Dans le cadre du Japon, parler trop tôt, trop franchement, c’est ignorer les repères et c’est socialement intrusif.
Dans une culture à bas contexte, parler trop peu, c’est risquer de rompre le lien car c’est justement la parole qui le crée. On apprend à connaître les gens en parlant avec eux, en formant une relation en verbalisant. Se taire, c’est s’effacer. C’est laisser l’autre seul face à un vide. La parole ici vient donc avant la relation. Elle n’est pas un point de départ, mais une conséquence du lien.
Et entre ces deux logiques, le malentendu s’installe. L’un attend un mot. L’autre attend qu’on comprenne sans le dire. Je l’ai vécu clairement avec des Japonais, mais aussi — plus rarement — avec des personnes de ma propre culture. Ce moment étrange où tout semble dit, et pourtant rien ne se rejoint. Comme si deux systèmes d’ondes tentaient de se synchroniser, mais glissaient l’un sur l’autre. Même avec les bons mots, parfois, il n’y a pas de connexion. Dans une relation amoureuse, c’est encore plus net. Je veux dire plus. Elle préfère suggérer. Je tends des phrases comme des ponts. Elle les trouve trop longues. Et parfois, on se retrouve à mi-chemin, dans ce no man’s land de l’incompréhension douce.
J’ai peut-être eu mes phases de “je parle mais je n’écoute pas”. Mais je crois que l’expérience japonaise m’a appris autre chose : que parler ne suffit pas, que comprendre demande autre chose qu’un lexique partagé, que le silence peut aussi contenir une intention — ou une fermeture. Depuis, je n’ai plus jamais été confronté à un tel écart de contexte. Mais je le garde en moi comme un seuil de vigilance. Une conscience. Une forme d’humilité, peut-être. Et aujourd’hui encore, il m’arrive de repenser à ces situations. À ces mots que j’ai dits — peut-être trop, peut-être mal. Et à ceux que je n’ai jamais su entendre.
📖 Sources et lectures pour prolonger
- Edward T. Hall – Le Langage silencieux (1971, trad. française)
→ Le livre fondateur qui introduit les concepts de high context et low context. Écrit accessible, parfois daté dans ses exemples, mais fondamental. - Geert Hofstede – Cultures and Organizations: Software of the Mind
→ Moins narratif, plus académique. Très utile pour situer les cultures selon plusieurs dimensions (dont le contexte, la distance hiérarchique, etc.). - Erin Meyer – The Culture Map (2014)
→ Ouvrage clair et pratique sur les différences interculturelles (communication, hiérarchie, rapport au temps…), très utilisé dans les milieux internationaux.
📎 Bonus – Apprendre le japonais autrement ?
Si ce texte vous a intéressé et que vous étudiez (ou avez étudié) le japonais, j’ai lancé un second blog qui pourrait vous plaire : My Nihongo.
J’y publie des textes en japonais pour niveaux intermédiaires et plus, accompagnés de leur traduction, d’un vocabulaire détaillé, d’explications grammaticales, et surtout — c’est ce qui m’anime le plus — d’un éclairage culturel en profondeur. Chaque texte est pensé comme une passerelle entre langue et société japonaise.
Ce que je n’ai pas su comprendre à l’époque, j’essaie aujourd’hui de l’expliquer, humblement, à travers les mots. ✍️

Charte de transparence IA
🧠 Idée : 100 % humaine
📁 Structure : brainstorming suite à l’exposition de mon ressenti personnel permettant de dégager les thématiques de ce texte, demande à l’IA de croiser les sujets aux biais cognitifs en jeu.
✍️ Rédaction : humaine, avec ajustements éventuels IA + intégration des citations par l’IA.
🎨 Illustrations : générées à 100 % par IA
Intervention globale de l’IA estimée : 40 %
Cette série de formats courts part d’un mot ou d’un concept croisé au fil de mes lectures, de mes errances ou de mes curiosités. Rien de prétentieux ici : juste l’envie de creuser un peu, de tirer sur un fil.
Parfois un terme rare, parfois une notion connue redécouverte autrement. L’idée n’est pas d’en faire le tour, mais d’ouvrir une porte. Ou une fenêtre.
Autrement dit : des éclats de sens attrapés au vol.

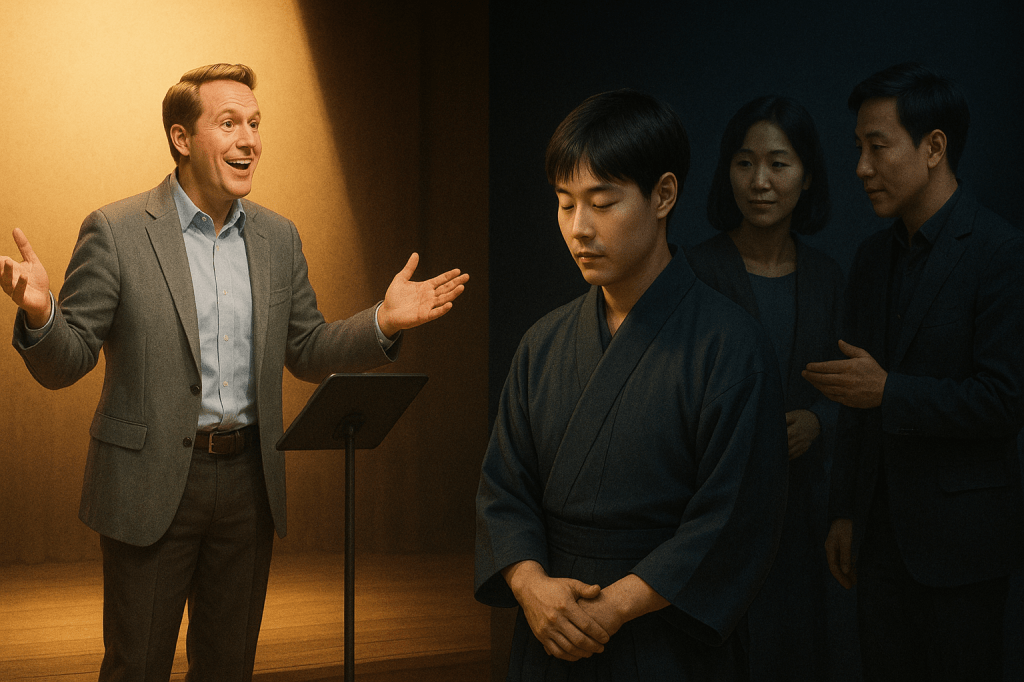


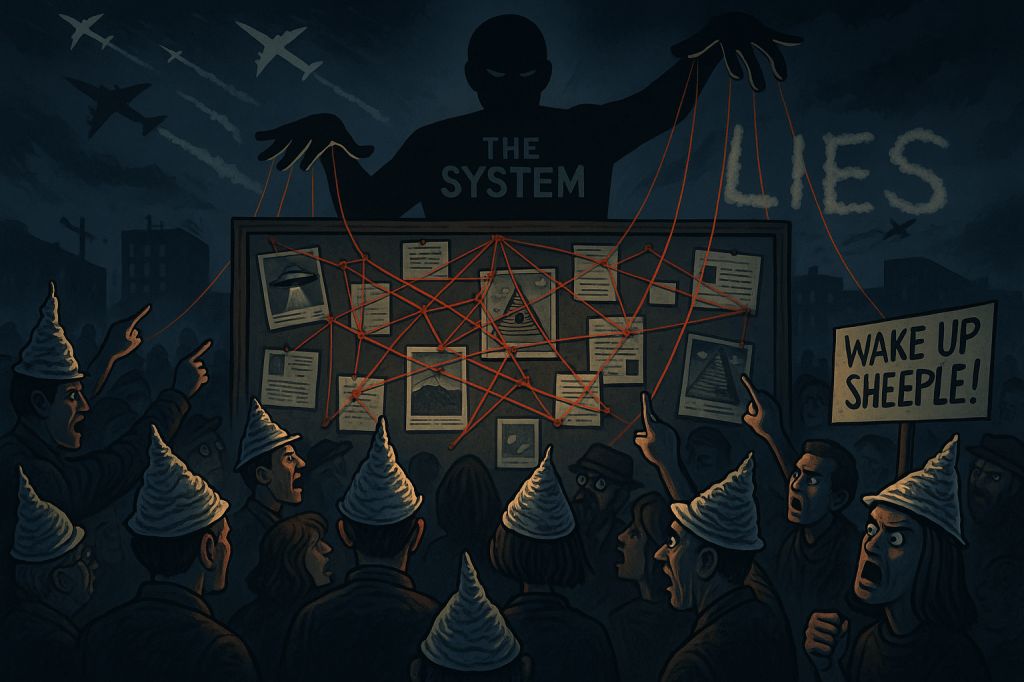



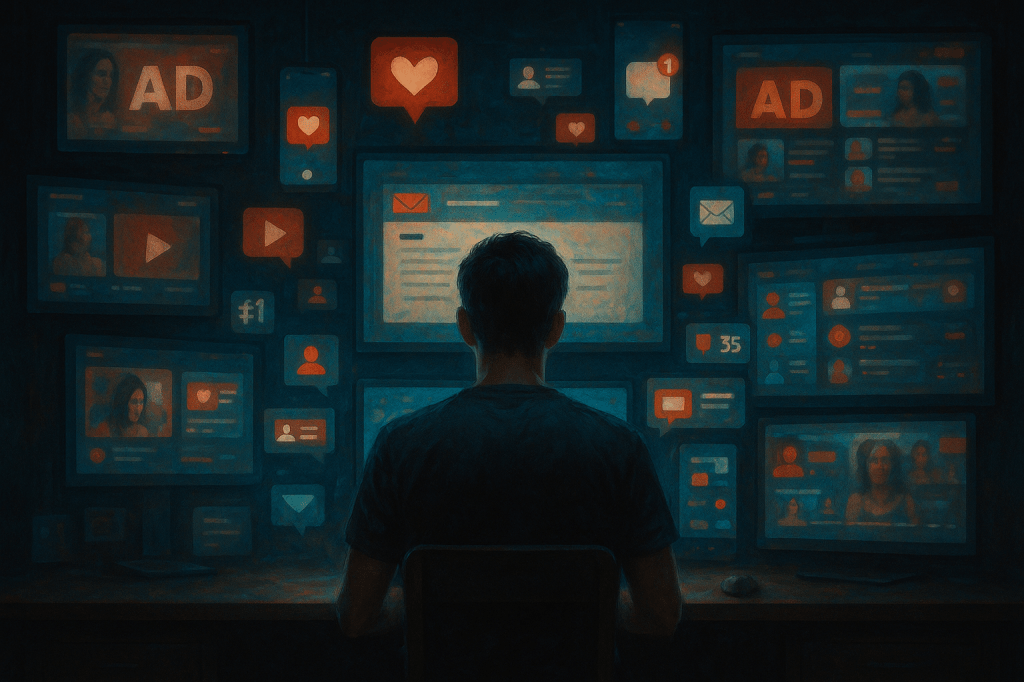
Laisser un commentaire