Et si notre vie entière n’était qu’un décor monté pour nous — chaque visage, chaque rue, chaque geste ? Ce vertige, longtemps cantonné à la fiction, a un impact bien réel… et porte un nom : le syndrome de Truman. Je pars ici de l’hypnotisant film The Truman Show (1998), en y mêlant observations personnelles, apports philosophiques, jeux vidéo et fiction, pour explorer cette question troublante : suis-je le héros de ma propre vie… ou un esprit enfermé dans une mise en scène dont j’ignore tout ?
Après avoir exploré la perceptive d’un monde évalué en permanence — qui prend en Chine la forme glaçante du “crédit social” — à travers l’épisode Nosedive de la série Black Mirror, je poursuis ma série « Réflexions par l’œuvre« avec un autre jalon marquant : The Truman Show (1998). Ce film n’a rien perdu de sa puissance. Il anticipe, sans le savoir, l’essor des réseaux sociaux, l’enfermement algorithmique des bulles de filtre, la téléréalité devenue norme, et surtout : cette idée vertigineuse que le monde entier pourrait être un théâtre monté pour soi seul…
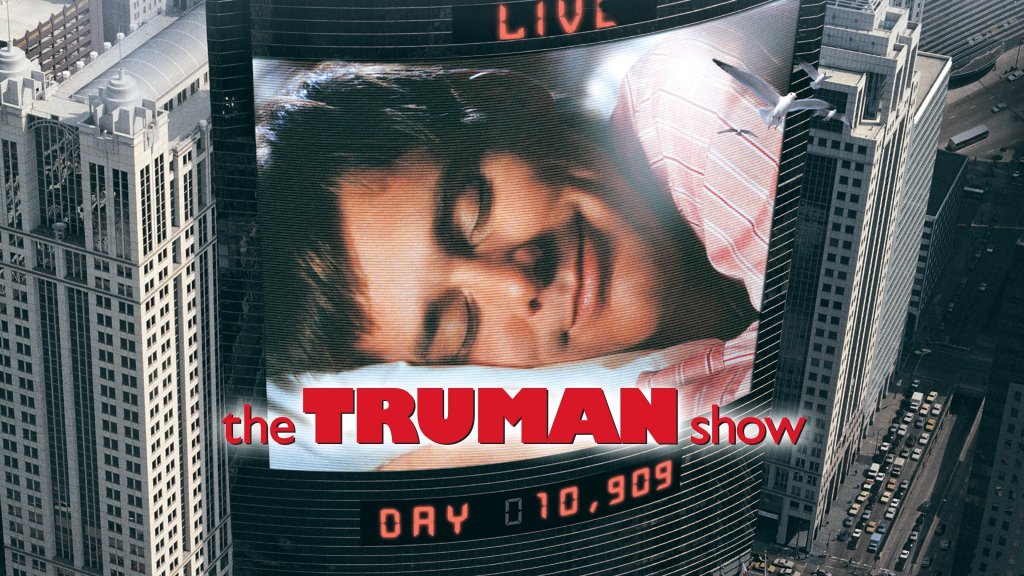
Autour de lui gravitent des notions philosophiques et cliniques fascinantes : le syndrome de Truman (théorisé quelques années après le film), mais aussi le solipsisme, la théorie de la simulation, la réalité subjective, le narcissisme métaphysique… Autant de concepts qui interrogent en profondeur notre rapport au réel, à nous-mêmes, et aux autres. Chez moi, cette projection se manifeste autant dans la fiction que dans ma pratique du jeu vidéo, où tout gravite autour du protagoniste (avec l’animation et la présence de personnages dit non-jouables, les fameux « PNJ« ). Suis-je, moi aussi, affecté par cette structure ? Peut-être.
Mais bien avant The Truman Show, un autre récit avait déjà formulé cette angoisse. Dans La République, Platon décrit une caverne où des hommes, enchaînés, ne perçoivent du monde que les ombres projetées sur un mur. Jusqu’à ce que l’un d’eux se libère, sorte… et découvre que tout ce qu’il croyait réel n’était qu’une illusion. The Truman Show reprend cette structure : un homme enfermé dans un décor total, qu’il croit authentique, jusqu’à ce qu’une anomalie fissure la bulle. Truman, comme le prisonnier de Platon, remonte lentement vers la lumière — celle d’un monde plus vrai… mais aussi plus cruel. Et moi ? Ai-je connu une sortie de caverne ? Si je devais en désigner une, ce serait le jour où j’ai remis en question la norme alimentaire. Devenir végane a été un basculement. Tout ce qui m’avait semblé naturel, universel… ne l’était plus. J’ai vu les chaînes, les ombres. Mais suis-je vraiment dehors ? Rien n’est moins sûr.
Mais depuis, une idée me hante : et s’il existait plusieurs cavernes entremêlées ? Comme des poupées russes. On pense avoir vu clair… mais ce ne serait qu’un mur mieux éclairé. On vit alors avec cette sensation étrange d’avoir progressé — sans savoir s’il reste encore des murs à franchir. Comme dans un rêve dont on croit s’éveiller… avant de découvrir une nouvelle scène, toujours scénarisée. Peut-être que la lucidité, ce n’est pas de croire qu’on a atteint la vérité — mais de rester ouvert à l’idée qu’on est encore dans une grotte, juste un peu moins obscure que la précédente.
I. Le mythe du protagoniste central

Aussi appelé « Truman Show Delusion« , le syndrome de Truman est un trouble psychiatrique rare mais fascinant, directement inspiré du film de 1998 avec Jim Carrey — un film qui, fait notable, ne s’appuie sur aucun roman mais sur une idée originale, chose assez rare pour être saluée. Ce syndrome désigne un délire paranoïde dans lequel une personne est convaincue que sa vie entière est une mise en scène, diffusée comme une émission de téléréalité. Tout — lieux, personnes, événements — semble orchestré autour d’elle, à son insu. Ce concept a été formalisé en 2008 par le psychiatre Joel Gold et son frère, le philosophe Ian Gold, mais les premiers patients convaincus de vivre dans un monde entièrement scénarisé ont commencé à affluer dès 2002. Pour les deux frères, il ne s’agissait pas d’une simple bizarrerie clinique, mais bien du miroir déformant d’une société en mutation. Et de fait, The Truman Show a été, sans le savoir, sacrément anticipateur. Il a mis en scène une angoisse qui ne portait pas encore de nom, mais qui allait bientôt devenir bien réelle. Car ce syndrome n’aurait sans doute pas émergé comme pathologie identifiable sans la montée en puissance d’un monde structuré autour de la visibilité, de la performance identitaire et du regard permanent des autres. Un monde où l’on ne sait plus toujours si l’on est observé ou exposé. Un monde où chacun, parfois, peut en venir à se demander : suis-je vu… ou mis en scène ? C’est une question que notre quotidien numérique rend presque banale — chacun se construit une centralité narrative, visible, scénarisée.
Pour revenir sur le concept même, je pense que l’une des raisons pour lesquelles nous avons tendance à nous percevoir comme le centre d’un récit tient à un biais narratif profondément ancré. Il est nourri par la plupart des fictions dites passives — comme la littérature ou le cinéma — dans lesquelles un personnage central cristallise l’action, les regards, les enjeux. Mais ce phénomène est, me semble-t-il, amplifié dans le jeu vidéo, où la fiction devient active, le joueur devient acteur. Le joueur y est littéralement le protagoniste, autour duquel gravite tout l’univers. Les personnages non jouables (PNJ), les quêtes, les dialogues, les décors eux-mêmes : tout semble exister pour lui, par lui. Cette structure ludique renforce, parfois inconsciemment, une vision égocentrée du monde — où l’idée d’être observé, attendu, ou même « destiné à quelque chose« , devient étrangement plausible. Et je ne parle pas ici de manière purement théorique. Je suis, moi aussi, traversé par cette logique. Je lis beaucoup, je joue énormément — et dans ces récits, je suis toujours au centre. Non pas par mégalomanie, mais par structure narrative. Tout est fait pour que je me sente concerné, visé, indispensable. Cette centralité répétée finit par s’infuser dans mon rapport au monde. Elle biaise mes attentes, elle rend plus floues les frontières entre ce qui m’arrive parce que je suis là… et ce qui m’arrive tout court. C’est un conditionnement doux, agréable même. Mais je sens qu’il altère parfois ma lucidité.
Mais cette sensation déborde aussi dans notre vie réelle car nous sommes conditionnés pour croire que notre vie est une intrigue principale. Plusieurs raisons expliquent cela. D’abord, notre cerveau raconte en permanence une histoire pour donner du sens au chaos de la réalité. Ce « narrateur intérieur » structure les événement en causes, conséquences et intentions. Il nous place au centre pour la simple raison que c’est notre point de vue unique. Et là un biais cognitif super intéressant entre en jeu : le biais d’auto-référentialité.
🧠 Focus : Le biais d’auto-référentialité
Définition : Il s’agit de notre tendance cognitive à interpréter les événements du monde en fonction de nous-mêmes, même lorsque ces événements ne nous concernent pas directement.
Conséquences possibles :
- Perception exagérée de sa centralité dans le monde.
- Interprétation personnelle de situations neutres.
- Construction d’un récit de vie où l’on est le héros principal.
Ce biais est amplifié par nos cultures narratives (films, romans, jeux vidéo), les réseaux sociaux (où l’on se met en scène), et les algorithmes (qui adaptent tout à nos préférences).
À noter : Ce biais n’est pas pathologique en soi, mais il peut dériver en une vision du monde trop centrée sur soi, jusqu’à alimenter des formes de délire comme le syndrome de Truman.
La culture fictionnelle, dont je m’alimente énormément, alimente cette structure. Par effet de miroir, nous nous habituons à vivre comme si nous étions le protagoniste d’un récit, avec des épreuves, des révélations, des adversaires, des arcs narratifs… C’est la vie dramatisée. Et le numérique et les algorithmes accentuent l’effet en nous proposant essentiellement ce qui nous ressemblent via un filtre émotionnel générant le sentiment d’être spécial. La société individualiste en met également une couche en disant « tu es unique » ou « tout dépend de toi« . Cela nourrit un autre biais : le biais (ou sentiment) du protagonisme.
🎭 Focus : Le biais du protagonisme
Définition : Tendance à se percevoir comme le personnage principal d’un récit en cours, où tout ce qui se passe semble avoir un sens pour nous ou se dérouler en fonction de nous.
Manifestations typiques :
- Impression d’être constamment observé, jugé ou ciblé.
- Sensation que les autres agissent en fonction de nous.
- Lecture de la réalité comme si elle formait une intrigue centrée sur soi.
Ce biais est renforcé par la culture de la narration (cinéma, littérature, jeux vidéo), mais aussi par les réseaux sociaux qui favorisent la mise en scène de soi comme protagoniste d’une vie “suivie”.
À noter : Ce biais peut nourrir des formes de narcissisme narratif, mais aussi accentuer l’isolement si l’on commence à percevoir les autres comme des figurants ou des menaces.
Si les deux biais semblent proches, voici de quoi les différencier :
Malheureusement (ou non), nous n’avons rien d’exceptionnel par rapport aux autres. Nous ne sommes pas un « héro » d’un monde mais uniquement un point parmi d’autres. Ce sentiment d’intrigue principale est une illusion fonctionnelle. Elle nous aide à vivre et à créer du lien narratif entre les choses. Et si l’on pousse cette logique encore plus loin, deux vertiges philosophiques surgissent : celui du solipsisme (il faut s’entraîner à le prononcer…), cette idée radicale selon laquelle « seul mon esprit est certain d’exister », et celui du problème de l’autre esprit, qui nous interroge sur la réalité de la conscience des autres. Peut-on prouver qu’ils pensent, ressentent, existent comme nous ? Peut-on jamais sortir de notre propre perspective ?
Le concept du solipsisme ou le doute radical sur l’existence des autres esprits ou du monde extérieur
Le solipsisme, du latin solus (seul) et ipse (soi-même), désigne une position philosophique selon laquelle une seule chose peut être tenue pour certaine : sa propre conscience. Tout le reste — les objets, les autres, même son propre corps — pourrait n’être qu’illusion ou construction mentale. On ne peut accéder qu’à ses propres pensées : rien ne permet de prouver que les autres ont une conscience semblable à la nôtre. Cette idée n’est généralement pas défendue comme une doctrine, mais explorée comme une limite ou une expérience de pensée par des philosophes comme Descartes, Berkeley ou Schopenhauer. Dans The Truman Show, on retrouve une forme de solipsisme inversé : Truman ne doute pas du monde, c’est le monde qui est agencé autour de lui, à son insu. Là où le solipsiste classique commence par douter des autres, Truman débute avec une confiance totale dans son environnement, avant de glisser peu à peu vers un doute radical. On pourrait dire qu’il suit une trajectoire cartésienne… mais inversée. Descartes part du doute vers la vérité quand Truman part de la confiance vers la désillusion.
Le concept du problème de l’autre esprit ou « qui dit que l’autre possède, lui aussi, une conscience (…) ? »
La question au cœur de ce concept est la suivante : comment puis-je être certain que les autres possèdent une conscience, des pensées, des émotions — autrement dit, une vie mentale — semblable à la mienne ? Je sais, de l’intérieur, que je pense, que je ressens, que j’existe. Mais je n’ai jamais accès directement à la conscience d’autrui. Je peux observer ses gestes, entendre ses paroles, décrypter ses mimiques… mais ce que je perçois n’est qu’un comportement. Ce n’est pas la pensée elle-même. J’en déduis un état mental, mais ce n’est qu’une inférence, une probabilité — pas une certitude.
On retrouve ici Descartes, avec son célèbre doute radical : je peux douter de tout, sauf du fait que je doute — donc que je pense — donc que j’existe. Mais les autres, eux, restent pour moi une hypothèse. Bertrand Russell, dans son ouvrage Problèmes de philosophie (1912), va plus loin : il s’interroge sur la validité de ces inférences. Il souligne que je projette sur autrui ce que je connais de moi-même. Par exemple, si je vois quelqu’un froncer les sourcils, je pense immédiatement : “Il est en colère.” Mais objectivement, je ne fais que voir un visage crispé. L’émotion, l’intention, je les projette parce que, chez moi, ce visage accompagne la colère. Mais je ne peux jamais être certain que l’autre ressent exactement ce que moi je ressentirais dans la même situation. Et puis il y a Thomas Nagel, qui met le doigt sur un autre point de tension, dans son essai célèbre « What is it like to be a bat?« . Il pose la question suivante : à quoi cela ressemble-t-il, d’être une chauve-souris ? Réponse : je ne peux pas le savoir. Même en connaissant ses capteurs, son écolocation, son vol nocturne… je ne peux que spéculer. Car vivre l’expérience subjective d’un autre être, même s’il est non humain, m’est inaccessible. Mon imagination est piégée par ma propre subjectivité. C’est d’ailleurs pourquoi nous anthropomorphisons autant : on prête facilement à un chien de la “honte” après une bêtise, à un chat du “mépris”, à un alien une silhouette humaine, deux yeux, une bouche. C’est plus fort que nous : notre esprit cherche des ponts de ressemblance, faute de pouvoir comprendre la véritable altérité. Penser une conscience radicalement autre nécessite un effort cognitif immense, presque contre-nature. Et cette perspective de penser autrement que comme un être humain est absolument passionnant et vertigineux, je trouve. Pour faire un parallèle avec The Truman Show, dans la vraie vie, ce doute reste philosophique, hypothétique. Mais pour Truman, il devient réalité : il découvre que ses proches n’ont jamais été “authentiques” avec lui. Ils jouaient à être humains. Et cette révélation le dévaste. Car elle détruit l’idée d’altérité sincère. Il réalise qu’il a été seul entouré de consciences absentes.
II. Les PNJ ne sont peut-être que des reflets de nous-mêmes

Cette notion de « PNJ » (personnage non-joueur) est essentielle dans l’univers vidéoludique : elle structure le décor humain, donne vie aux interactions, et crée, paradoxalement, une forme de réalisme social à la crédibilité relative — bien que tout gravite autour du joueur. Dans la vie réelle, ce sentiment de « figuration généralisée« , je le ressens parfois aussi. Je crois qu’il naît avant tout d’un état de « désattention » chronique, provoqué par un trop-plein sensoriel, émotionnel… ou simplement existentiel. Quand l’environnement déborde, le cerveau filtre — et les autres deviennent flous, périphériques.
Mais il faut dire aussi que je suis dans un état particulier. Une posture ambivalente. Je me décrirais volontiers comme un misanthrope social : l’humanité me consterne, et pourtant j’en ai besoin. Ces rares éclats de lucidité, de complicité, d’intelligence sensible sont encore possibles — mais souvent, j’ai l’impression que les gens autour de moi agissent selon des scripts préécrits.
Phénoménologie de la conscience ou l’art d’habituer le monde
Selon des penseurs comme Edmund Husserl (fondateur de la phénoménologie, qui s’attache à étudier l’expérience vécue, telle qu’elle se donne à la conscience) et Maurice Merleau-Ponty (qui prolonge cette tradition en insistant sur l’ancrage corporel de la perception), être conscient, ce n’est pas simplement penser — c’est être-au-monde, avec un corps, dans un monde peuplé d’autres corps. Mais dans certains environnements — les transports en commun, les files de supermarché, les open spaces ou même les foules en centre-ville — notre expérience se transforme. On ne regarde plus vraiment les visages. On évite les yeux. Les gestes deviennent mécaniques, les corps anonymes. Les autres ne sont pas moins conscients. Simplement, je ne les perçois plus comme conscients. Ils deviennent silhouettes, profils, obstacles à contourner ou à ignorer. Et cela, paradoxalement, me rassure. Il y a un confort étrange à se fondre dans l’automatisme collectif. Plus besoin de décrypter la richesse intérieure de chacun. Moins de charge cognitive.
Dans The Truman Show, cette déshumanisation du décor est littéralement mise en scène : chaque passant, chaque commerçant, chaque voisin est un acteur qui joue un rôle, mais sans épaisseur véritable. Au début du film, Truman ne perçoit rien d’anormal, car tout semble couler de source — comme dans la vraie vie, lorsqu’on cesse de prêter attention. Ce n’est que lorsqu’il remarque une répétition suspecte (le joggeur, le cycliste et la voiture passent à la même seconde chaque matin) que son regard change. Il ne voit plus les autres comme de simples figurants. Il remet en doute leur intériorité supposée. C’est exactement ce basculement que souligne la phénoménologie : on peut oublier l’existence consciente d’autrui… jusqu’au moment où quelque chose cloche dans le décor.
L’automatisme cognitif : pensée économique, perception réduite
Ce glissement perceptif, où les autres deviennent flous, accessoires ou mécaniques, n’est pas toujours le signe d’un délire — parfois, c’est juste une conséquence du fonctionnement normal de notre cerveau en situation de surcharge. C’est ce qu’on appelle l’automatisme cognitif : un mode dans lequel le cerveau, pour économiser ses ressources, désactive l’attention profonde, recycle des gestes et des scripts, et nous fait traverser le monde en pilote automatique.
Je le constate au quotidien. En tant que facteur, 80 % (estimation personnelle) de mes actions sont automatisées. Et heureusement, sinon je ne tiendrais pas la cadence. La conduite, les gestes, les mots : tout se répète. Dans cet état, les autres deviennent souvent des obstacles. Pas des ennemis — juste des ralentisseurs. Je ne suis pas le facteur du cliché social. Je suis efficace. Je souris, mais tout est scripté. Ce n’est pas du mépris. C’est un mode de protection. Mais ce mode automatique, s’il devient permanent, déshumanise les autres. Ils ne sont plus des consciences — mais des silhouettes. Et moi, je me sens parfois moi-même… personnage secondaire dans ma propre boucle.
Modèle du PNJ : figure contemporaine de l’agent sans volonté propre
Cette figure du PNJ, si elle est née de l’univers vidéoludique, dépasse aujourd’hui largement les écrans. Ce modèle n’est pas un concept scientifique à proprement parler — mais c’est une métaphore contemporaine puissante, qui traduit un ressenti d’effacement, une perte d’épaisseur, une dilution de la présence consciente dans le décor du monde. Elle symbolise la métaphore de l’état passif, scripté, où l’on agit sans intention réelle, sans autonomie véritable. Dans certains contextes (bureau, transports, vie sociale mécanisée), nous sommes perçus comme des PNJ… ou nous nous sentons nous-mêmes PNJ.
Et là, pour clore ce passage, surgit une idée dérangeante : un contre-modèle du biais du protagonisme. Si le biais du protagonisme est cette illusion douce qui nous fait croire que tout gravite autour de nous, que notre vie suit un arc narratif, avec obstacles, climax et révélations… alors son revers serait peut-être cela : se sentir PNJ de sa propre vie. Je me regarde agir sans désir clair. Répéter sans y croire. Répondre sans penser. Pas de quête. Pas de narration. Juste une boucle. Ce modèle serait celui où l’on ne se vit plus comme un héros, mais comme le second rôle dans les histoires des autres. L’agent de liaison. L’ombre utile. Et cette sensation, quand elle s’installe, peut devenir étrange : on ne doute pas d’être observé, comme dans le syndrome de Truman — on doute d’être perçu. Peut-être est-ce là une autre forme de vertige. Moins spectaculaire. Plus discret. Mais tout aussi troublant. Personnellement, je trouve cette perspective plutôt confortable… n’étant plus la cible du projecteur, on cesse d’être attendu : plus de pression à réussir ou à briller. On devient une existence basse intensité. C’est une forme de retrait existentiel sans crise. Une abdication douce du rôle principal. Et dans un monde saturé d’ego narratifs, ce retrait peut presque ressembler à une paix.
III. La simulation comme hypothèse (ni angoissante, ni salvatrice)

Je n’ai jamais “vu le bug dans la matrice”. Rien, en apparence, ne cloche dans mon décor. Parfois un sentiment de déjà-vu. Un agencement trop fluide d’événements. Mais rien qui ne résiste à un peu de bon sens ou à l’idée que je m’organise juste bien, je pense. Pourtant, comme beaucoup, j’ai eu cette pensée : « et si tout était faux ? » Pas parce que je le crois. Mais parce que j’aime les hypothèses. J’aime questionner les évidences. Imaginer les alternatives. Me dire : « et si ? » Je n’éprouve aucune angoisse à l’idée que le réel soit une illusion. Pas plus que devant l’immensité de l’univers ou la vacuité de l’existence. Je chemine sans y croire, mais sans jamais me fermer non plus. C’est une hypothèse. Une parmi d’autres. Une projection parallèle, sans nécessité d’y croire pour y penser. Mais ce goût du « et si ? » n’est pas le fruit d’un délire personnel : il s’inscrit dans une longue tradition fictionnelle.
🎬 Le cinéma de la faille
Le cinéma a souvent mis en scène ce doute fondamental. Matrix, Inception, Dark City, The Thirteenth Floor, Black Mirror, eXistenZ… Tous ces récits partagent un motif : celui d’un protagoniste confronté à une réalité qui craque. Quelque chose cloche. Un décalage, une boucle, un souvenir étrange… Et soudain, tout devient suspect. Le monde n’est peut-être pas ce qu’il paraît. Mais là où ces œuvres sont puissantes, c’est qu’elles ne cherchent pas à répondre simplement à la question « est-ce réel ? », mais à en explorer les conséquences : qu’est-ce que ça change, si ce n’est pas réel ? Et s’il n’y avait rien derrière le rideau ?
📚 La littérature et le vertige Dickien
La littérature s’est emparée de ces idées bien avant Hollywood. L’un de ses maîtres absolus : Philip K. Dick, écrivain californien paranoïaque et prophétique. Chez lui, le réel n’est jamais stable. Il fuit, il se tord, il s’effondre. Il développe notamment une vision très singulière de ce qu’il appelle la « réalité fuyante » (j’y reviens dans l’encart ci-dessous). Dans « Ubik » (1969), les personnages évoluent dans un monde instable, où le temps se désagrège, où les objets régressent, et où une entité invisible semble manipuler la trame du réel. Dans « Simulacres » (1964), c’est l’ensemble du système politique et social qui repose sur des identités fabriquées, des décors illusoires, des simulacres entretenus avec soin — au point que la distinction entre vrai et faux devient elle-même suspecte.
🔮 Focus : Réalité fuyante et simulacres
La réalité fuyante désigne cette sensation que le réel se dérobe, se modifie, devient incertain. Ce n’est pas une illusion totale — mais une instabilité des repères. Ce que l’on croyait fiable (lieux, souvenirs, objets, identités…) vacille peu à peu.
Chez Philip K. Dick, cette fêlure du monde est constante. Les perceptions divergent, les certitudes se désagrègent, et les vérités s’effondrent. On ne sait plus ce qui est vrai, ni ce qui est faux. Juste que quelque chose ne va pas.
Les simulacres, eux, désignent ces copies sans original : images politiques, figures publiques, récits collectifs… qui ne reposent sur rien de tangible. Tout semble réel, mais rien ne l’est. On nage dans une illusion bien tenue.
La réalité fuyante, ce n’est pas vivre dans un rêve. C’est vivre dans un monde où le réel devient instable — et cette intuition, en 2025, est plus que jamais d’actualité.
📺 Philosophie : de Platon à Baudrillard
La philosophie n’est pas en reste. Depuis l’allégorie de « La caverne de Platon« , évoquée plus haut, elle explore l’idée que le monde sensible pourrait n’être qu’un décor : des ombres projetées, une illusion prise pour la réalité. Plus récemment, Hilary Putnam et son expérience du « cerveau dans une cuve » relancent cette hypothèse radicale : et si nos perceptions étaient intégralement générées artificiellement ? Quant à Nick Bostrom, il propose une théorie probabiliste vertigineuse : si les civilisations avancées peuvent simuler des consciences, alors il est statistiquement probable que nous soyons nous-mêmes simulés… Et entre ces deux extrêmes, s’élève une autre voix — plus sociologique, mais non moins vertigineuse : Jean Baudrillard.
🌀 Focus : Jean Baudrillard et l’hyperréalité
Qui ? Philosophe et sociologue français (1929–2007), penseur incontournable de la postmodernité.
Concept central : l’hyperréalité. Dans notre société, les signes, les images, les représentations ont fini par remplacer le réel. Nous ne vivons plus dans la réalité, mais dans une version simulée — plus séduisante, plus fluide, plus contrôlable.
Il distingue quatre stades dans la relation entre signe et réalité :
- Le signe reflète une réalité (ex. : une photo fidèle).
- Il la masque ou la déforme (ex. : publicité).
- Il prétend refléter une réalité qui n’existe plus (ex. : la téléréalité).
- Il ne renvoie plus à rien : le simulacre pur.
À noter : Le réel n’a pas disparu, mais il est devenu indiscernable. Saturé de couches d’images, de messages, de fictions, il s’efface derrière les signes. Le simulacre n’est pas un mensonge — c’est un monde qui ne ment plus parce qu’il ne promet plus rien.
Pop culture : Matrix (1999) s’inspire directement de ses thèses. Dans le film, un exemplaire de Simulacres et Simulation dissimule une disquette contenant le début de la révolte.
On pourrait dire que ces œuvres de fiction et ces hypothèses philosophiques se répondent mutuellement. Les premières traduisent en récits ce que les secondes formulent en concepts. Et moi, là-dedans ? Je ne suis ni philosophe, ni auteur de science-fiction. Mais je me tiens à l’intersection des deux : je pense avec les fictions, et je rêve avec les idées. Non pas pour trancher — ni sur la vérité du monde, ni sur celle de la conscience — mais pour habiter ces questions, comme on habite un lieu encore inexploré. Un territoire incertain, mais fertile. Un espace de réflexion. Un théâtre intérieur, où le doute n’est pas un échec… mais une ouverture. Voici des concepts complémentaire sur cette idée de simulacre et de simulation…
🧠 Le « cerveau dans une cuve » (de Hilary Putnam)
Et si nos perceptions, pensées et expériences étaient entièrement générées artificiellement, pendant que notre cerveau baigne dans une cuve, relié à une machine ? En 1981, le philosophe américain Hilary Putnam publie un essai philosophique, « Reason, Truth and History« , dans lequel il propose une expérience de pensée devenue célèbre : celle du « cerveau dans une cuve » (« brain in a vat« ). Le cerveau est retiré du corps, placé dans un liquide et relié à un super-ordinateur. Ce dernier envoie au cerveau des impulsions électriques similaires à celles reçues dans la « vraie » vie. Pour l’expérimenté, rien ne change : il a l’impression d’avoir un corps, de voir des couleurs, d’entendre des sons, de goûter et, surtout, de penser librement. Mais en réalité, tout est simulation et il n’a aucun moyen de s’en rendre compte. Là où Putnam veut nous faire réfléchir avec sa projection, c’est de formuler une critique du scepticisme radical. Mais là où le bât blesse c’est que ce scénario est jugé incohérent. Pourquoi ? Parce que le langage dépend du contexte dans lequel il est appris… car il doit renvoyer à quelque chose de réel. On ne peux donc pas signifier ou penser correctement à la possibilité que l’on est “un cerveau dans une cuve”, puisque même cette expression fait partie du système illusoire. Le langage tourne à vide. L’hypothèse est imaginable, mais improuvable — et même indémontrable de l’intérieur. Ce doute ultime, que l’on croyait abyssal, se dissout dans une impossibilité conceptuelle. À force de douter de tout, on finit par ne plus pouvoir rien dire — ni même formuler le doute.

Le point commun avec le film de 1998 est que Truman vit aussi dans un décor total, artificiel cependant, où chaque interaction et chaque parole a été mise en scène. Il ne doute pas jusqu’à ce qu’un élément dissonant vienne fissurer la bulle. Ce qui les distingue est que Truman peut sortir. Son monde est clos, mais matériel. Il suffit d’une brèche — une lumière tombée du ciel, un regard mal joué — pour réveiller le doute et déclencher sa fuite. Et pourtant… les deux figures incarnent la même question vertigineuse : et si ma réalité n’était qu’un décor ? Mais surtout : est-ce que je peux le savoir ? Et est-ce que ça changerait quelque chose ?
🌐 La théorie de la simulation (de Nick Bostrom) :
Formulée en 2003 par le philosophe suédois Nick Bostrom, cette « Théorie de la simulation » repose sur un raisonnement probabiliste plutôt que sur une affirmation directe. Il ne dit pas « nous vivons dans une simulation » mais plutôt qu’au moins une des propositions suivantes est vraie :
- Nous sommes presque certainement en train de vivre dans une simulation. ;
- L’humanité s’éteindra avant d’avoir la capacité technologique de créer des simulations de conscience à grande échelle. ;
- Les civilisations avancées ne sont pas intéressées à créer de telles simulations.
Que peut-on en retirer ? Que des civilisations très avancées pourraient simuler des millions, voire des milliards, de consciences, ce qui suppose que les consciences simulées seraient plus nombreuses que les consciences réelles. Statistiquement, il y aurait donc plus de probabilité d’être une conscience simulée que réelle… Naturellement, cette hypothèse ne repose pas sur des preuves empiriques mais sur la logique des grandes puissances de calcul et sur l’évolution des capacités informatiques. La différence avec l’univers scénique de Truman est que ce dernier peut physiquement sortir de son décor, alors que dans l’hypothèse de Bostrom, la simulation est l’environnement de base — nous n’avons aucun dehors. Dans l’idée de Bostrom, les questions réflexives seraient davantage orientées vers le but d’un éventuel programmeur, le poids réel de nos choix et si la souffrance humaine est une des nombreuses variables de la programmation.
👁 Réalité subjective : il n’y a de réel que ce que notre conscience peut saisir
Principe souvent évoqué en neurosciences, en phénoménologie (Husserl, déjà cité plus haut), ou même en spiritualité : le réel n’est jamais perçu “brut”. Il passe par nos sens, notre attention, nos souvenirs, nos émotions… Autant de filtres qui transforment, reconstruisent, interprètent. Ce que nous appelons “réalité” n’est donc pas une vérité objective, mais une expérience subjective, une projection mentale du monde sur l’écran de notre conscience. Cette idée, déjà formulée au XVIIIe siècle par Emmanuel Kant, établissait que nous ne connaissons jamais les choses “en soi”, mais seulement les phénomènes tels qu’ils apparaissent à travers nos catégories mentales (espace, temps, causalité…). Depuis, les sciences cognitives ont prolongé cette intuition en montrant que notre cerveau ne reflète pas le monde : il le reconstruit. Ce n’est pas une illusion, au sens d’un faux complet. Mais ce n’est pas non plus une vérité pure. C’est un réel vécu, à la première personne, toujours partiel, toujours situé. Et c’est en cela que me revient cette expression populaire : “les goûts et les couleurs ne se discutent pas”. Elle semble anodine, mais elle touche à quelque chose de fondamental. Ce que nous aimons, percevons, jugeons, repose en partie sur notre réalité subjective.
🎨 Focus : Les goûts et les couleurs — une affaire de réalité subjective
Définition : La réalité subjective désigne le fait que notre perception du monde (sons, saveurs, couleurs, émotions…) n’est pas une copie fidèle de celui-ci, mais une interprétation personnelle, façonnée par nos sens, notre culture et notre histoire individuelle.
Exemple courant : l’expression “les goûts et les couleurs ne se discutent pas” illustre parfaitement ce principe : ce que je trouve beau ou bon peut être désagréable à un autre — et il n’existe pas de critère objectif universel pour trancher.
En pratique :
- Nous ne voyons pas tous les couleurs de la même façon (daltonisme, sensibilité chromatique, filtres culturels).
- Le goût d’un aliment dépend de l’éducation, des souvenirs, de l’état émotionnel du moment.
- Un même son ou parfum peut évoquer des émotions opposées d’un individu à l’autre.
À noter : Cela ne signifie pas que “tout se vaut” — mais que nos réalités sont toujours situées. La diversité des goûts et des perceptions est moins un obstacle qu’un rappel fondamental : nous ne vivons pas dans un monde commun, mais dans des mondes partagés.
Dans The Truman Show, cette subjectivité est portée à son paroxysme : Truman vit dans un décor factice, mais n’en a pas conscience — donc pour lui, c’est la réalité. Sa réalité subjective est la réalité. Ce n’est que lorsque des anomalies (un projecteur tombé du ciel, un comportement incohérent…) perturbent cette cohérence que le doute surgit. La bulle craque. Mais cette subjectivité, faut-il le rappeler, n’est pas une erreur. C’est simplement notre façon d’habiter le monde. Elle devient problématique uniquement quand on oublie qu’elle est située, construite, contextuelle. Truman ne “se trompe” pas : il vit dans un monde fait pour qu’il y croie. Et si nous faisions de même ? Notre monde n’est-il pas, lui aussi, construit — par l’éducation, les récits, les algorithmes, les biais, les sens — pour que nous y croyions ? Alors peut-être que la vraie question n’est pas de savoir si la réalité est vraie ou fausse… Mais de ne jamais oublier qu’elle est subjective. Et je rajouterais enfin que, de mon point de vue, cette perception est subjective mais n’est pas pour autant isolée. Ce que je veux dire c’est que nous partageons un socle commun d’expériences perceptives : nous voyons à peu près les mêmes couleurs, nous reconnaissons les mêmes expressions émotionnelles, nous réagissons à certains sons ou odeurs avec des mécanismes semblables. Ce n’est pas un univers commun, mais un chevauchement de réalités subjectives, assez vaste pour qu’un dialogue, une société, une culture soient possibles.
IV. L’hypothèse du seul réel : fantasme ou piège ?

Ce vertige de l’unicité consciente, je ne l’ai pas ressenti de manière brutale — mais je perçois une bascule, discrète mais réelle, qui s’est opérée au fil du temps. Elle ne vient pas d’un événement spectaculaire, mais d’un long cheminement intellectuel. Plus jeune, je ne posais pas tant de questions. Et puis, à force de lectures, de réflexions, de reprises d’études tardives, quelque chose s’est déplacé : j’ai commencé à regarder le monde autrement — à soupçonner qu’il ne se donne pas tel qu’il est, et à douter de sa transparence. Ce n’est pas que je crois être le seul “réel” ou “lucide”, loin de là. Mais il m’arrive de ressentir une forme de décalage. Une impression fugace que les autres appartiennent à un monde différent. Que ce qui me semble essentiel — le doute, la curiosité, la mise à distance — n’a pas toujours d’écho en face. Ce sentiment est amplifié quand je m’enferme trop en moi-même, dans mes routines ou mes pensées. Mais je le relativise : il suffit d’un échange sincère, d’un esprit éveillé, pour que ce sentiment d’isolement se dissolve. Je vis avec quelqu’un qui partage une grande part de mes questionnements, et ça fait toute la différence.
Ce fantasme d’être le seul “vrai”, je le perçois moins comme une envie de toute-puissance que comme une réponse désespérée à un monde devenu insaisissable. Un monde qui file, qui déborde, qui dérange. Mais en ce qui me concerne, je ne cherche pas à tout comprendre ou tout contrôler. J’aime l’idée que le monde m’échappe. Cela signifie qu’il peut encore me surprendre — et cette incertitude est, à mes yeux, une forme de promesse. Un monde totalement connu, balisé, prévisible, serait une prison douce… mais une prison tout de même. Il m’arrive parfois, sur le ton de l’humour ou du doute passager, de me demander si le monde continue de tourner sans moi. Quand je suis en vacances, je me surprends à penser : « est-ce que mes collègues travaillent vraiment ? » — comme si tout pouvait être suspendu jusqu’à mon retour. Bien sûr, je sais que c’est absurde. Le monde tourne sans nous. Mais ce genre de pensée, aussi légère soit-elle, révèle peut-être une angoisse plus diffuse : celle de ne pas être vu, pas entendu, pas vraiment présent dans l’histoire collective. C’est un écho discret à ce que j’appellerais un « narcissisme inversé » : non pas le sentiment d’être le centre, mais la crainte d’être périphérique au point de ne rien peser. Heureusement, il y a la curiosité. Le partage. Et ces moments précieux où une pensée se reconnaît dans celle d’un autre. Où, même brièvement, on cesse d’être seul dans sa conscience.
Et Truman, dans tout ça ? Lui aussi traverse ce vertige — mais à l’envers. Là où moi je m’interroge, il croit. Il vit dans un monde entièrement faux, mais n’en doute pas… jusqu’à ce qu’un détail déraille. Sa solitude n’est pas d’abord philosophique, elle est existentielle : il découvre qu’il est seul à ne pas savoir. Que tout autour de lui, depuis toujours, coopère à son illusion. Et cette prise de conscience ne le propulse pas vers une grandeur héroïque, mais vers une angoisse pure. Il ne doute pas de l’existence du monde — il doute de la sincérité du lien. Ce qui le détruit, ce n’est pas que tout soit faux : c’est que rien n’ait jamais été partagé. C’est peut-être là le pire vertige : non pas croire que tout est simulé, mais que personne n’est jamais vraiment entré en résonance avec soi. Une altérité jouée, une affection scénarisée, une empathie programmée. Plus que le doute métaphysique, c’est le doute relationnel qui fissure Truman. Et, à sa manière, ce doute-là nous habite tous, parfois. Il ne s’agit pas de savoir si le monde est vrai — mais s’il est vécu ensemble. Je termine ce point avec quelques autres concepts qui me paraissent pertinents.
🌀 Solipsisme inversé : un monde réel… mais sans lien
Le solipsisme classique part du principe que rien ne prouve que les autres existent. Le solipsisme inversé, lui, ne nierait pas l’existence du monde ou des autres — il douterait de la possibilité d’un lien authentique. C’est l’idée troublante selon laquelle chacun serait enfermé dans sa bulle perceptive, et que la rencontre véritable entre deux consciences serait peut-être illusoire. C’est ce que découvre Truman : le monde autour de lui existe matériellement, mais il n’a jamais été relationnellement vrai. Les échanges n’étaient que des scripts. Les regards, des illusions. Il n’a manqué de rien… sauf d’un lien sincère. Ce vertige-là est bien plus courant qu’on ne le pense : vivre à côté des autres, les croiser sans jamais les rencontrer vraiment, parler sans être entendu — et se demander, un jour, si quelque chose a déjà été partagé au fond. Ce concept n’est pas canonique dans la philosophique académique mais se rapproche de certaines pensées. Celle de Sartre, par exemple, avec son existentialisme — nous ne sommes pas définis à l’avance, par Dieu, la nature ou la société, nous existons d’abord puis nous nous construisons librement par nos choix — et sa formule célèbre « l’enfer, c’est les autres« . Ou celle de la phénoménologie de Levinas (qui continue sur la lancée de Husserl) qui souligne au contraire l’irréductibilité du visage de l’autre, mais cela suppose justement qu’on puisse douter de sa réalité jusqu’à l’épiphanie — cette prise de conscience brutale ou subtile, souvent inattendue, qui éclaire un aspect caché de soi, du monde ou du réel — du lien.
🎭 Narcissisme métaphysique : croire que tout converge vers soi
Ce terme n’est pas un diagnostic, mais une tendance cognitive et culturelle : celle qui nous pousse à croire que le monde, d’une manière ou d’une autre, nous est destiné. Que les événements ont un sens personnel. Que les obstacles sont des épreuves. Que les autres jouent un rôle dans notre histoire. C’est l’effet miroir de la narration omniprésente dans les médias, les récits et les réseaux sociaux. Dans The Truman Show, cette illusion est littérale : tout est mis en scène pour lui. Ce n’est pas Truman qui est égocentrique : c’est le monde qui l’est à sa place. Ce narcissisme-là n’est pas un excès de soi : c’est un piège structurel qui naît d’un environnement centré, balisé, réactif — qui finit par nous convaincre que notre présence est au cœur du réel. Et nous, dans nos vies plus ordinaires, comment ne pas ressentir un frisson similaire quand tout semble s’aligner ou converger autour de notre trajectoire ? Ce vertige, s’il n’est pas pathologique, reste un piège doux : celui de croire que tout a un sens pour nous.
🧩 Déconstruction du sujet moderne : le “je” fissuré
La philosophie postmoderne (Foucault, Derrida, Deleuze…) a mis à mal le “je” stable et souverain de la modernité. Pour ces penseurs, l’idée d’un sujet central, cohérent, maître de lui et de ses choix est une construction. En réalité, nos identités sont traversées de forces, de récits, d’influences sociales, de langages préexistants. Le “moi” n’est plus un socle, mais un nœud de flux. Autrement dit : je ne suis pas au centre. Je suis un point dans un réseau. Et penser autrement le sujet, ce n’est pas s’effacer — c’est cesser de croire que tout commence avec soi. Cette déconstruction rejoint profondément le vertige du syndrome de Truman : et si mon “moi” n’était pas un noyau dur, mais un personnage parmi d’autres, assigné à un rôle, enfermé dans une narration… dont je ne suis pas l’auteur ?
V. Conclusion : penser sans dominer
Au fond, nous endossons tous plusieurs rôles. Au centre de notre vie, parfois dans celle des autres, souvent en arrière-plan. Les histoires s’entrelacent, changent de focale. Le protagoniste d’un jour devient figurant le lendemain. C’est le jeu du temps, des liens, des contextes. Je ne suis pas le centre, mais un être parmi d’autres opacités conscientes. Opacités — car je ne pourrai jamais habiter leur intériorité comme la mienne. C’est ce qu’on appelle une altérité radicale : une présence réelle, mais inaccessible. Et pourtant, elle me rassure. Imaginer être seul à sentir, à penser, à douter… serait une bien triste fable.


Je peux difficilement me projeter dans la souffrance d’une personne atteinte du syndrome de Truman. Mais je comprends le vertige. Pas comme trouble, mais comme question. Suis-je seul dans ce théâtre ? Cette pensée n’est pas forcément toxique. Elle peut être, au contraire, une échappée. Une manière de desserrer les frontières de son ego, de s’ouvrir à d’autres vécus, d’autres possibles. Et si je me sens parfois Truman, c’est moins parce que je soupçonne un décor… que parce que je guette une fissure. Pas pour fuir le monde, mais pour mieux voir ce qu’il dissimule. Le réel n’est pas un piège — c’est une énigme. Et peut-être que, comme Truman, nous touchons parfois le mur du ciel. Hésitants. Inquiets. Curieux. Ce qui compte, alors, ce n’est pas de sortir. C’est de savoir qu’une sortie est possible.
📖 Sources et ouvrages pour prolonger
Philosophie et conscience :
- Hilary Putnam – Reason, Truth and History (1981)
- René Descartes – Méditations métaphysiques (1641)
- Emmanuel Kant – Critique de la raison pure (1781)
- Thomas Nagel – What is it like to be a bat? (1974)
- Jean-Paul Sartre – L’Être et le Néant (1943)
- Emmanuel Levinas – Totalité et infini (1961)
Simulation, altérité, subjectivité :
- Nick Bostrom – Are You Living in a Computer Simulation? (2003)
- Jean Baudrillard – Simulacres et simulation (1981)
- Maurice Merleau-Ponty – Phénoménologie de la perception (1945)
- Bertrand Russell – Problèmes de philosophie (1912)
Littérature et vertiges fictionnels :
- Philip K. Dick – Ubik (1969)
- Philip K. Dick – Simulacres (1964)
- Stanislas Lem – Solaris (1961)
Culture pop et réflexions contemporaines :
- The Truman Show – film de Peter Weir (1998)
- Matrix – film des Wachowski (1999)
- Black Mirror – série de Charlie Brooker (notamment « Nosedive », « White Bear »)
- Inception – film de Christopher Nolan (2010)
- Dark City – film d’Alex Proyas (1998)
Psychologie et biais cognitifs :
- Daniel Kahneman – Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée (2011)
- Joel & Ian Gold – The Truman Show Delusion: Psychosis in the Global Village. Published in Cognitive Neuropsychiatry (2008)
- Joel & Ian Gold – Suspicious Minds: How Culture Shapes Madness (2014)
- Christophe André – Imparfaits, libres et heureux (2006)

Charte de transparence IA
🧠 Idée : 100 % humaine
📁 Structure : brainstorming suite à l’exposition de mon ressenti personnel permettant de dégager les thématiques de ce texte, demande à l’IA de croiser les sujets aux biais cognitifs en jeu.
✍️ Rédaction : plan proposé par l’IA, listing de questions philosophiques à la pelle pour me positionner. Suggestion des concepts par l’IA.
🎨 Illustrations : générées à 80 % par IA
Intervention globale de l’IA estimée : 65 %
Cette sous-catégorie part d’une œuvre culturelle – série, film, roman ou jeu – pour explorer un sujet de fond. Il ne s’agit pas de critique classique, mais d’une analyse transversale, nourrie par ce que l’œuvre révèle, questionne ou symbolise.
Chaque article utilise une œuvre comme point de départ pour interroger nos pratiques, nos sociétés et nos croyances contemporaines. Une façon de penser autrement, en partant du sensible et de la fiction pour éclairer le réel.
Autrement dit : penser par ricochet, à partir d’un miroir fictionnel.

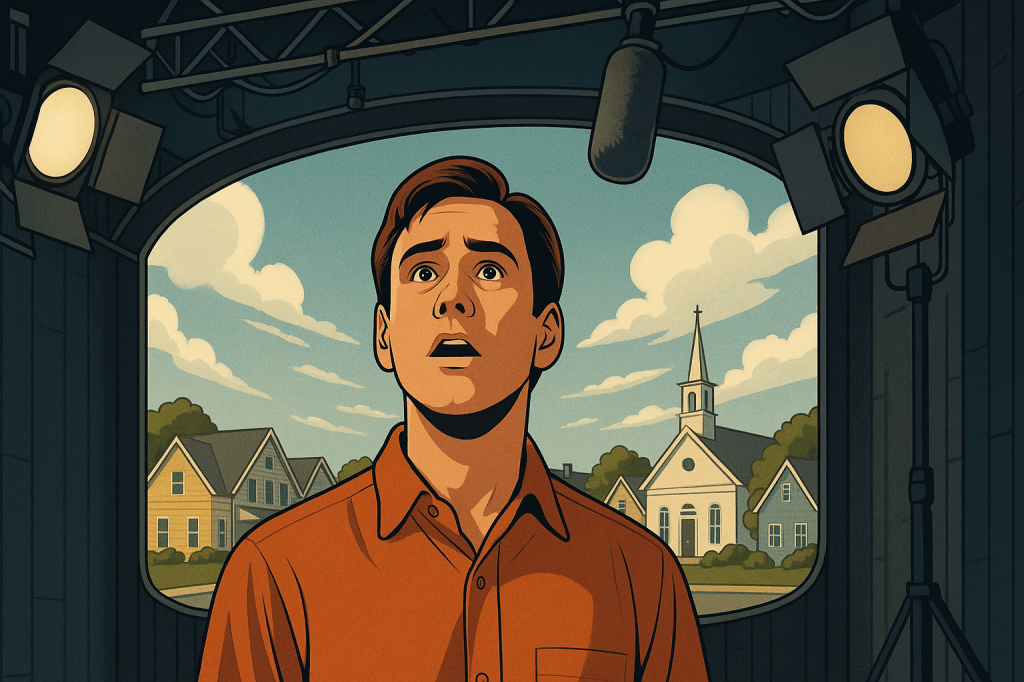


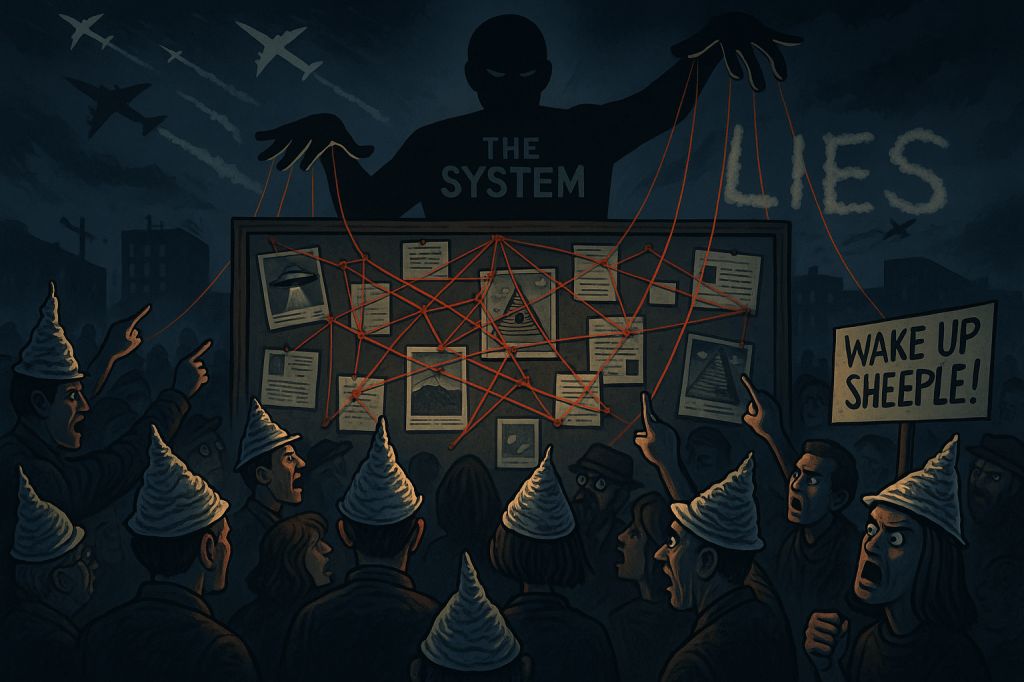



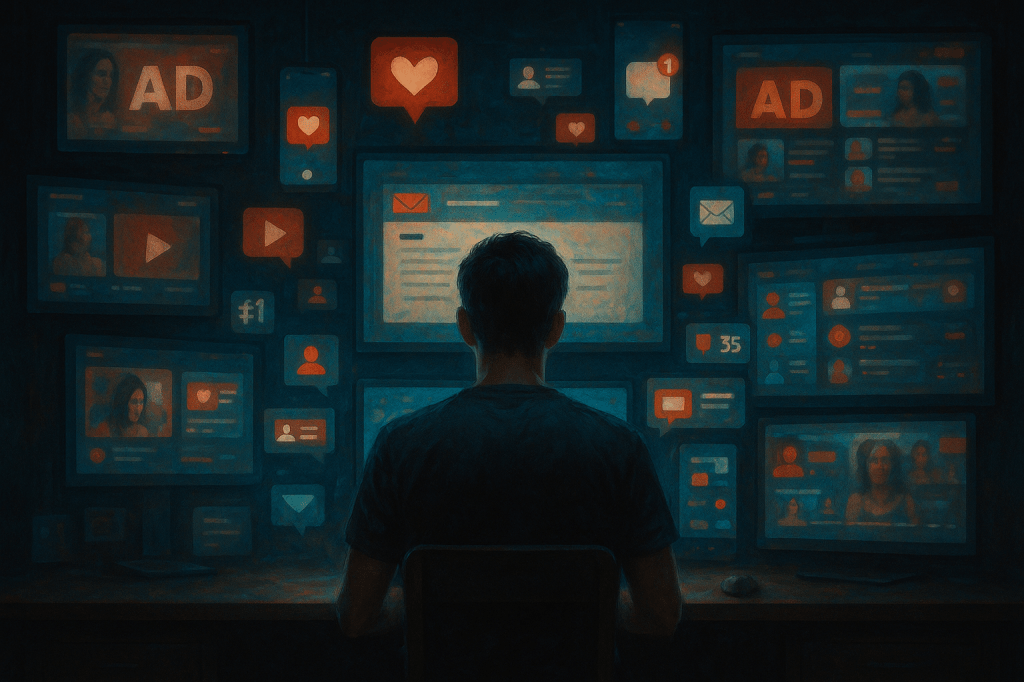
Laisser un commentaire