Et si le monde dans lequel nous vivons n’était pas tant le fruit de faits que celui des fictions que nous avons choisies de croire ? À l’ère des récits viraux, des slogans politiques creux et des promesses technologiques messianiques, il devient urgent de comprendre ce qui nous façonne en silence : l’hyperstition. Ces idées spéculatives qui deviennent vraies parce qu’elles circulent, séduisent, captivent. Ce texte n’est pas une simple exploration théorique — c’est une alerte lucide. Car si nous ne choisissons pas les récits que nous nourrissons, d’autres le feront à notre place.
I. Et si les histoires devenaient vraies ?
Il existe des idées étranges. Des idées qui ne se contentent pas de circuler, mais qui transforment le monde simplement parce qu’on y croit. Une rumeur, un mythe, une promesse technologique… Certaines histoires deviennent vraies non pas parce qu’elles le sont à l’origine, mais parce qu’elles finissent par façonner la réalité elle-même. C’est ce que désigne le terme hyperstition : la capacité d’un récit — aussi fictif ou spéculatif soit-il — à produire des effets tangibles dès lors qu’il est partagé, répété, cru.
L’humanité se caractérise, entre autres, par sa faculté à raconter des histoires. À se raconter des histoires, devrait-on dire. L’hyperstition, à ce titre, n’est pas un concept ésotérique, mais un miroir troublant tendu à notre époque : celle des prédictions autoréalisatrices, du marketing prophétique, des utopies économiques, des fictions devenues forces structurantes. Et pourtant, paradoxe étrange : en creusant ce sujet, je me suis rendu compte à quel point il restait marginal, surtout dans l’espace francophone. Au mieux, on trouve un film du même nom. Mais très peu de documentation, d’analyses, de débats. Une idée qui parle de la viralité des idées… et qui, elle-même, n’a pas encore contaminé les esprits.
Alors, question simple, presque banale : vivons-nous dans un monde saturé d’hyperstitions performatives* ? Sommes-nous immergés dans des croyances, des récits, des affirmations qui, à force d’être répétées, partagées, crues… finissent par modeler la réalité ? C’est ce que j’aimerais explorer ici.
*La performativité est un concept inventé dans les années 50 par John L. Austin (philosophe du langage) et approfondi par Judith Butler dans le champ des études de genre désignant la capacité d’un énoncé (ou d’un acte de langage) à produire un effet réel simplement par le fait d’être prononcé.
II. Une idée née dans les marges
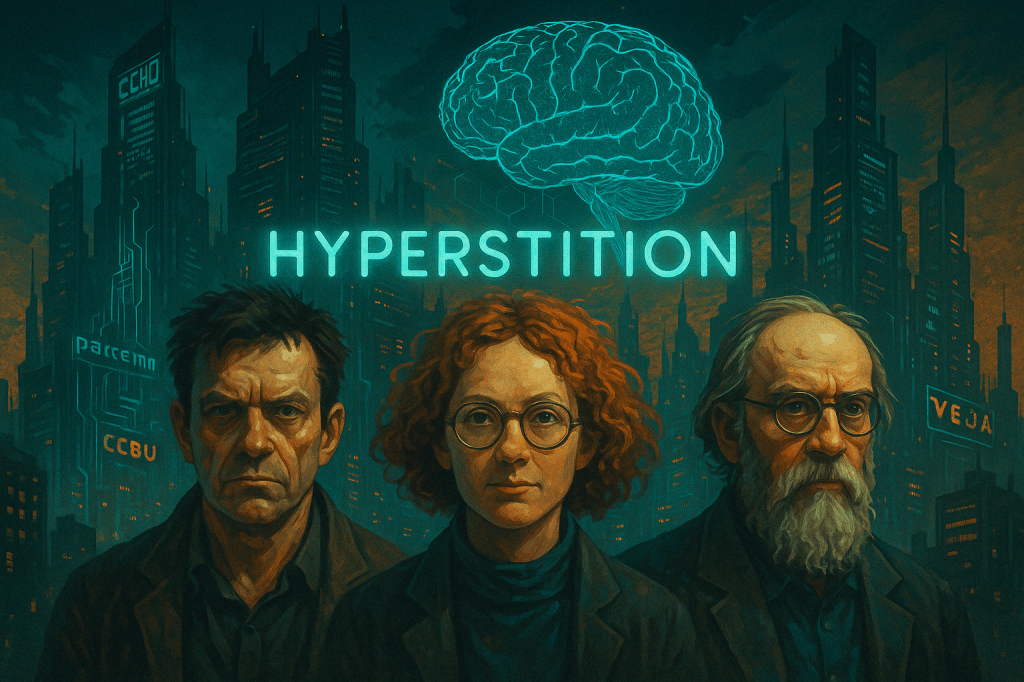
L’hyperstition est un mot-valise (« hyper » et le « stition » de « superstition« ) qui émerge au Royaume-Uni dans les années 90 par un collectif, jugé radical, le CCRU (pour « Cybernetic Culture Research Unit) à la croisée de la philosophie et de la cybernétique. A sa tête : plusieurs penseurs marginaux comme Nick Land, Sadie Plant et Mark Fisher. Leur travail se distingue par une approche expérimentale où l’on retrouve concepts philosophiques, textes fictionnels, le tout sur fond d’univers cyberpunk. C’est dans ce cadre que naît le concept d’hyperstition, défini en quelques mots à l’époque : “les idées qui, en circulant, s’engendrent elles-mêmes.” Autrement dit : des fictions qui produisent des effets concrets dans le monde réel, par leur seule diffusion. L’hyperstition, à l’inverse de la superstition, ne se contente pas de croire à un mythe : elle le met en œuvre, le propage, et le rend opératoire, parfois inconsciemment.
Nick Land, philosophe controversé et provocateur, s’en servait pour penser l’influence performative des récits technologiques, des mutations capitalistes, ou encore du transhumanisme. Dans sa vision, le futur peut rétroactivement contaminer le présent, par le biais des fictions qu’on se raconte aujourd’hui.
III. Typologie des forces narratives

Si l’hyperstition vous fait penser à d’autres concepts qui lui sont parents, ce n’est pas anodin. Histoire de mettre les choses à plat, je vous propose ci-dessous une comparaison entre la superstition, la prophétie autoréalisatrice, le mythe, la fiction… et l’hyperstition.
La superstition :
La superstition repose sur une croyance irrationnelle selon laquelle un évènement, souvent anodin, entraînerait des conséquences sans lieu de causalité réel. C’est une notion dite passive car on croit que certains signes portent chance ou malheur mais ce n’induit pas de transformation concrète du monde, sauf indirectement.
Exemple : Croire qu’un chat noir porte malheur ou qu’un trèfle à quatre feuilles porte bonheur.
La prophétie autoréalisatrice :
Croyance initialement fausse ou non fondée qui devient vraie parce qu’elle influence les comportements de ceux qui y croient. La prophétie autoréalisatrice a un fort pouvoir performatif mais repose souvent sur un mécanisme psychologique ou social identifiable.
Exemple : Dire d’un élève qu’il est doué, et constater qu’il finit par exceller — parce qu’on a modifié son regard sur lui-même et ses efforts.
Le mythe :
Le mythe est un récit fondateur qui structure une culture ou une civilisation. Il n’a pas vocation à être vrai ou faux, mais à produire du sens, des valeurs, une cohérence symbolique. Il agit sur la perception du monde, pas nécessairement sur sa transformation directe.
Exemple : Le mythe de Prométhée pour expliquer la relation entre l’humanité et le progrès.
La fiction :
La fiction, elle, est une construction narrative assumée comme telle. Elle n’a pas pour but de devenir réelle, mais peut avoir des effets indirects sur la société (inspiration, sensibilisation, transformation culturelle). Toutes les hyperstitions sont des fictions, mais toutes les fictions ne deviennent pas des hyperstitions.
Exemple : 1984 de George Orwell n’est pas une prophétie, mais certains y voient une hyperstition en raison de son influence sur notre regard politique.
L’hypersition :
Nous revoilà donc au terme qui nous intéresse ici. L’hyperstition est plus large. C’est une fiction, un récit spéculatif, une idée “virale” qui agit comme un virus culturel et finit par se matérialiser dans le réel. Elle ne dépend pas d’un individu mais d’un collectif qui s’approprie l’idée, la relaie, la transforme — et la rend vraie par ses effets systémiques.
Exemple : Le récit futuriste d’une IA tout-puissante qui pousse les entreprises à investir massivement… ce qui rend l’idée plus réelle, par contagion anticipée.
IV. Le mécanisme hyperstitionnel
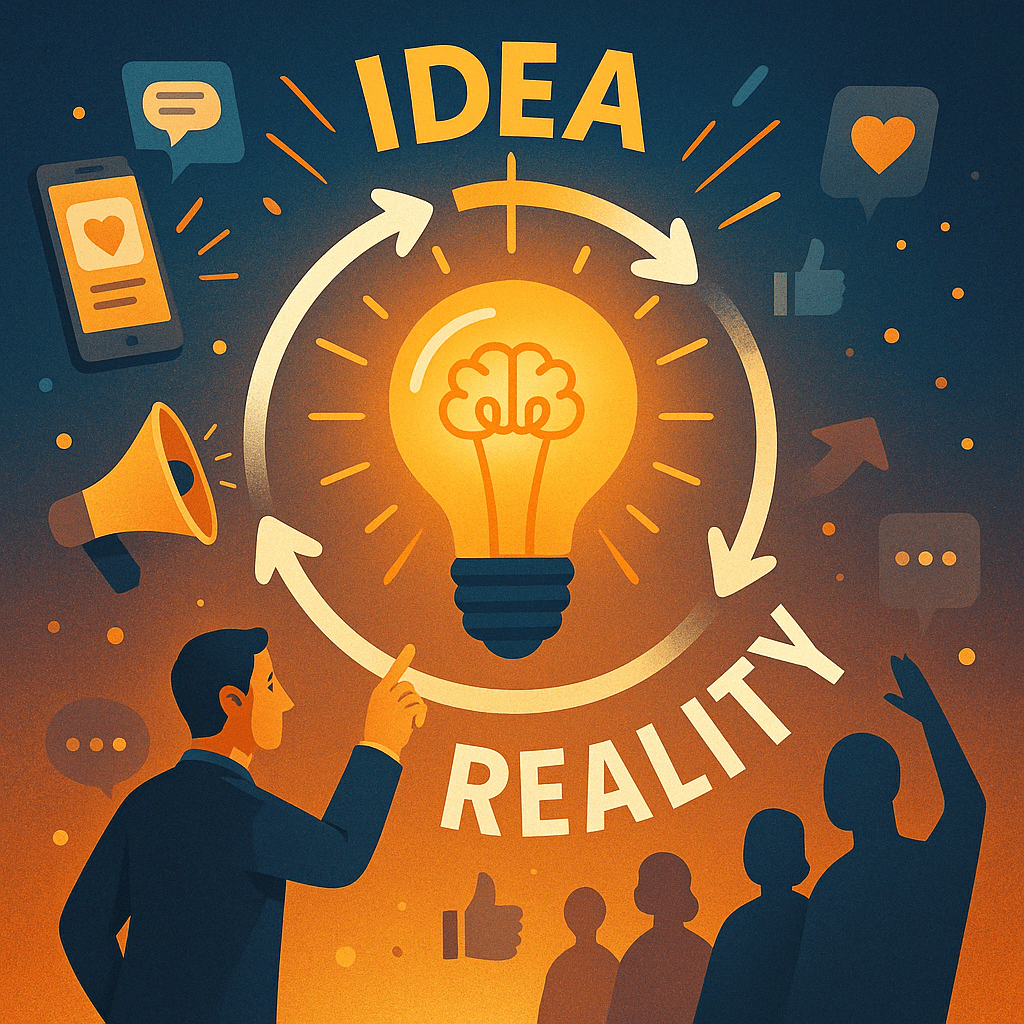
La question que l’on doit se poser est la suivante : comment une idée au départ si marginale devient-elle une réalité partagée par tous ? L’hyperstition fonctionne comme un boucle de rétroaction. Une fiction, au départ anodine, parfois marginale ou même risible, commence à circuler. Elle intrigue, dérange, séduit. Et plus elle est relayée, commentée, crue, plus elle infiltre le réel, jusqu’à produire des effets tangibles. C’est le cœur du mécanisme hyperstitionnel : une idée qui agit sur le monde, non parce qu’elle est vraie, mais parce qu’elle est crue comme telle. Ce processus repose donc sur cette dynamique bien connue des théories sociales : la performativité.
Comme je vous le disais plus haut : ce n’est pas une description du monde, mais une action qui transforme le monde. L’exemple type est le fait d’entendre dire « Je vous déclare mari et femme » ; cela ne décrit pas une situation mais crée une réalité sociale nouvelle à l’instant même où la phrase est prononcée par une personne légitime dans un contexte légitime. Ainsi dire « cette monnaie a de la valeur » ou « cet avenir est inévitable » ne décrit pas un état de fait, cela crée une croyance collective qui pousse à l’action. Et plus les gens agissent en fonction de cette croyance, plus la prophétie se réalise.
Et notre époque est sans commune mesure avec le passé, puisque Internet a été un accélérateur fulgurant des hyperstitions. Si les mythes antiques et les prophéties religieuses mettaient des siècles à structurer les sociétés, aujourd’hui, en quelques heures, une idée peut passer de l’obscurité absolue à la viralité mondiale. Les forums, les réseaux sociaux, les algorithmes de recommandation fonctionnent comme des chambres d’écho où chaque récit est amplifié, remixé, détourné. Et l’hyperstition adore cela : plus elle circule, plus elle existe.
Mais dans cette profusion infinie d’idées, toutes ne survivent pas. Pour émerger, une hyperstition doit être simple, mémorable, émotionnelle, modulable : elle doit pouvoir s’adapter aux sensibilités, se résumer en un slogan, toucher une corde intime. Elle doit aussi parfois servir des intérêts convergents — économiques, idéologiques, identitaires. Ce n’est pas toujours la vérité qui triomphe, mais l’utilité narrative. Certaines idées végètent, puis explosent à la faveur d’un événement catalyseur. D’autres percent parce qu’elles répondent à un manque collectif : besoin de sens, peur du chaos, fascination pour l’avenir. Dans tous les cas, une fois qu’elles atteignent une masse critique, elles commencent à agir — non plus comme des hypothèses, mais comme des forces du réel. On n’y croit plus parce qu’elles sont vraies : elles deviennent vraies parce qu’on y croit.
À mesure que les récits gagnent en visibilité, les comportements s’adaptent. Les entreprises investissent, les États régulent, les individus modifient leurs usages. Le récit initial, souvent spéculatif, se matérialise. Le cycle est enclenché : croire pousse à investir qui permet à l’idée d’exister et cela renforce la croyance. Chaque étape renforce la précédente, jusqu’à produire une nouvelle norme. On n’adhère plus seulement à l’idée : on vit dans l’idée. Il ne faut pas croire que tout se joue dans le cynisme ou la manipulation consciente. La puissance de l’hyperstition réside justement dans sa discrétion. La majorité des gens qui participent à sa diffusion ne la perçoivent pas comme une fiction fondatrice, mais comme un discours parmi d’autres. Ils en reprennent les codes, les hashtags, les valeurs, sans se rendre compte qu’ils participent à rendre réel ce qui ne l’était pas. L’hyperstition opère souvent par envoûtement culturel, dans un régime de désir plus que de rationalité. Ce n’est pas tant la vérité d’un récit qui importe, mais sa capacité à mobiliser l’attention, l’affect, l’investissement. Elle infiltre les imaginaires comme un virus infiltre une cellule, et détourne son fonctionnement à son profit.
À l’ère de la post-vérité, des bulles cognitives et des récits médiatiques omniprésents, les hyperstitions sont partout — et rarement identifiées comme telles. Elles colonisent l’espace public, dictent des stratégies politiques, économiques, culturelles. Elles deviennent la matière même dont est fait notre monde : un monde construit non sur ce qui est, mais sur ce qu’on a décidé de croire… ensemble.
Domaines d’application
A. 🧠 Religion & spiritualité

Pour moi, la religion est le best-seller des hyperstitions. C’est peut-être même la première d’entre elles : un récit millénaire, déployé à l’échelle mondiale, construit pour combler le vertige existentiel. Malgré des déclinaisons culturelles très différentes, toutes les grandes religions partagent un même fil rouge narratif : justifier l’inconnu, adoucir la peur de la mort, répondre à la souffrance, donner un cap moral. En cela, la religion fonctionne comme un récit palliatif, c’est-à-dire une histoire que l’on se raconte collectivement pour apaiser ce qui dépasse l’entendement — un pansement métaphysique posé sur les plaies de la condition humaine. Et ça fonctionne. Car à force d’être crues, répétées, vécues, ces fictions deviennent des réalités structurantes. Elles s’incarnent dans des calendriers, des rituels, des lois, des identités. Dieu n’a pas besoin d’exister pour que sa croyance produise des effets très concrets : guerres saintes, entraide communautaire, contrôle social, sentiment de transcendance. C’est là toute la force de la religion en tant qu’hyperstition : elle agit, et ce depuis des siècles.
Il serait toutefois trop simple de la réduire à une illusion collective. Car une partie de son efficacité tient à sa fonction morale (et si je suis très critique envers cette hyperstition, j’y vois là quelque chose de passablement positif). La religion a servi — et sert encore — de vecteur de valeurs, de régulation des comportements, d’architecture symbolique pour le vivre ensemble. Toutes ne sont pas progressistes, loin de là, mais beaucoup ont tenté d’organiser le chaos moral, de poser des limites aux instincts destructeurs, de ritualiser le lien. Mais ce qui frappe surtout, c’est que tout cela repose sur des récits jamais démontrés, et parfois invérifiables — ce qui ne les empêche pas d’être opérants. Le paradis, le karma, le péché ou la réincarnation sont des fictions à usage collectif, devenues des leviers sociaux, psychologiques et politiques. On n’y croit pas parce qu’ils sont vrais. Ils deviennent vrais parce qu’on y croit, et qu’on s’organise autour d’eux.
Si la religion repose sur des dogmes établis, des institutions solides et des récits gravés dans la pierre, la spiritualité contemporaine, elle, est plus diffuse, plus liquide, plus personnalisée. Mais elle n’en est pas moins hyperstitionnelle. Au contraire : elle prospère sur l’idée même qu’un récit devient vrai dès lors qu’il « résonne », qu’il fait « vibrer » l’individu. Peu importe sa cohérence, son origine ou sa vérifiabilité. Ce qui compte, c’est son pouvoir de projection intérieure. A force de répétitions, encore une fois, des partages, des témoignages, des mantras ou des récits personnels prennent corps jusqu’à devenir des réalités vécues, orientant les choix de vie, les interprétations du monde, voire les trajectoires professionnelles. Certains en font un moteur intime ; d’autres un business. Dans tous les cas, le mécanisme est le même : une idée, crue avec suffisamment de conviction, finit par produire du réel.
B. 🌐 Technologie & futurisme
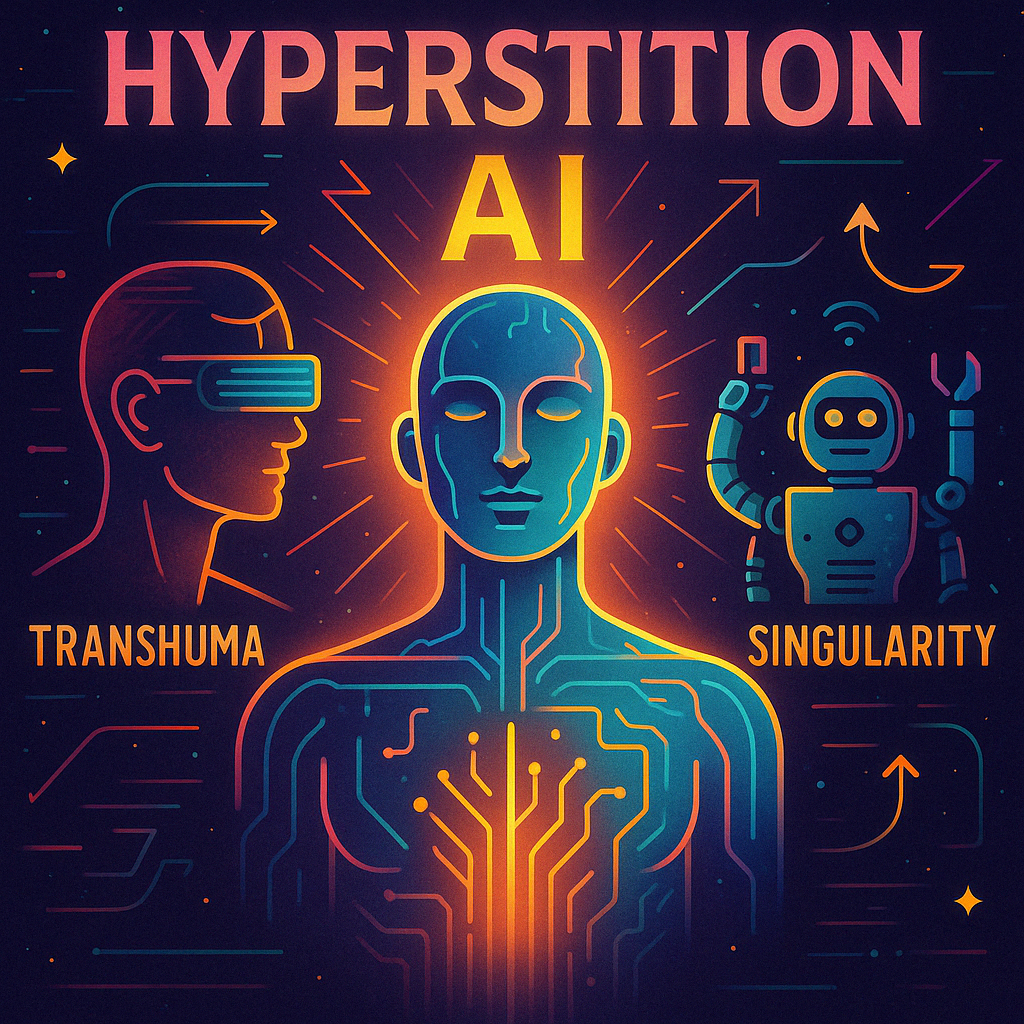
La technologie avance à une vitesse folle. Les plus grands fantasmes de la science-fiction deviennent de moins en moins improbables. Mais ce qui est fascinant, c’est que cette accélération n’est pas uniquement le fruit de progrès techniques : elle est aussi portée — parfois même provoquée — par des récits. Autrement dit : c’est la promesse du futur qui alimente sa venue.
Prenons l’exemple de l’intelligence artificielle. Il y a encore dix ans, évoquer une IA forte suscitait des sourires sceptiques ou des références à 2001, l’Odyssée de l’espace. Aujourd’hui, c’est un sujet géopolitique majeur, une ruée économique, un terrain de spéculation idéologique. La croyance dans un avenir peuplé de machines pensantes a précédé leur existence concrète, et c’est précisément cette croyance — partagée, nourrie, relayée — qui a déclenché les investissements, la recherche, la panique morale et la régulation. L’idée a agi comme une hyperstition parfaitement performative.
Même chose pour la « singularité » que j’ai découvert avec ce sujet. Pour faire simple, la singularité technologique, concept que l’on doit à Ray Kurzweil, ingénieur, écrivain et futurologue, qui prévoit cette « rupture » autour de 2045, est une hypothèse selon laquelle un jour, l’intelligence artificielle dépassera l’intelligence humaine, non seulement dans des tâches précises, mais dans toutes les formes de raisonnement, d’adaptation et de créativité. Ce moment déclencherait, selon ses partisans, une accélération incontrôlable du progrès technologique, car des IA ultra-intelligentes concevraient à leur tour d’autres IA encore plus intelligentes, dans une boucle exponentielle. Rien ne prouve que cela arrivera. Mais le seul fait que des figures comme Ray Kurzweil ou Elon Musk y croient, l’annoncent, la décrivent avec force détails… suffit à orienter les budgets, les carrières, les trajectoires scientifiques. On se prépare à un avenir non pas parce qu’il est certain, mais parce qu’il est raconté avec suffisamment de conviction.
Et, enfin, on a le courant transhumaniste, qui repose sur le mécanisme de l’amélioration humaine, avec des fantasmes comme : repousser la mort, fusionner avec la machine, transférer sa conscience dans le cloud… autant de promesses à la fois déroutantes et séduisantes, qui préexistent à leur faisabilité, mais dont la répétition finit par créer les conditions de leur réalisation. On les appelle souvent des « utopies technologiques » — mais peut-être faudrait-il plutôt parler d’hyperstitions actives, contaminant le réel bien avant d’avoir un fondement scientifique solide. Et sur ce point, un léger pas de côté : avons-nous vraiment attendu le XXIᵉ siècle pour commencer à modifier l’humain ? Porter des lunettes, rouler en voiture, se faire poser un pacemaker ou consulter un GPS… c’est déjà prolonger nos capacités naturelles. Le transhumanisme, en ce sens, n’est pas une rupture, mais une radicalisation de ce mouvement millénaire : celui qui pousse l’humain à se doter d’outils pour dépasser ses limites. Ce qui change, c’est la conscience explicite de ce projet, et la volonté affichée d’en faire une feuille de route pour l’avenir. Et quand cette feuille de route est répétée, financée, relayée par des figures influentes, elle cesse d’être un simple récit spéculatif : elle devient une trajectoire collective, un futur projeté qui commence déjà à modeler le présent.
Ainsi, dans le domaine technologique, les récits ne sont plus de simples fictions : ce sont des forces de propulsion, des attracteurs de capitaux et de croyances. Ce n’est pas la réalité qui fonde la croyance, mais la croyance qui génère la réalité. Et dans ce renversement silencieux, la science-fiction devient business plan.
C. 🪙 Économie & cryptomonnaies
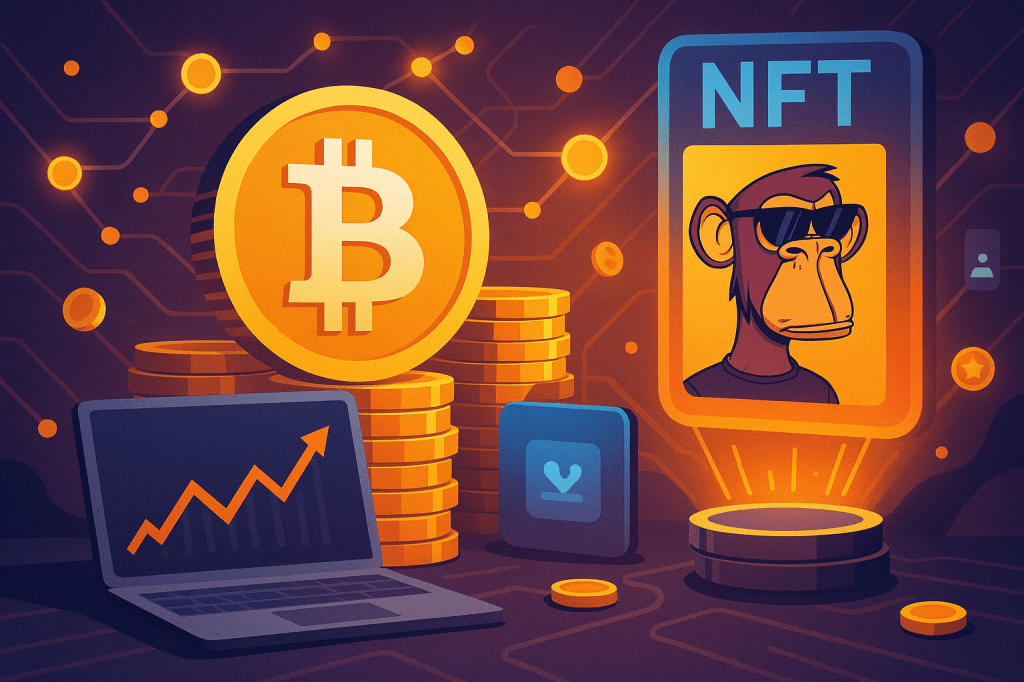
S’il existe un domaine où l’hyperstition opère à plein régime, c’est bien celui de l’économie spéculative. Prenons le Bitcoin : à l’origine, une blague de geek libertaire, une expérimentation de monnaie décentralisée sans banque centrale. Mais très vite, un récit se construit : celui d’un futur monétaire alternatif, d’une révolution financière inévitable. Ce récit circule, se renforce, attire des croyants, puis des investisseurs, puis des institutions. Résultat : le Bitcoin devient une réalité économique majeure, non pas en dépit de sa nature spéculative, mais grâce à elle.
Même mécanique du côté des NFT, autre incarnation spectaculaire de l’hyperstition contemporaine. Un NFT, ou Non-Fungible Token, est un jeton numérique unique inscrit dans la blockchain — c’est-à-dire dans un registre public décentralisé, infalsifiable, partagé entre des milliers d’ordinateurs — qui sert de preuve de propriété sur un fichier : image, vidéo, musique, objet de jeu… Contrairement à un bitcoin (fongible), le NFT n’est pas interchangeable : il est supposé représenter quelque chose d’unique. Ce n’est pas un “copyright” au sens juridique, mais plutôt un certificat d’authenticité numérique. On ne possède pas l’œuvre elle-même, mais la preuve qu’on en détient une version “officielle”, traçable et théoriquement revendable — un peu comme un compte certifié sur les réseaux sociaux : tout le monde peut accéder au contenu, mais un seul détenteur possède le badge qui atteste de l’authenticité. Ce n’est donc pas la valeur d’usage qui prime, mais la rareté artificielle, l’idée d’appartenance symbolique, et — une fois encore — la croyance partagée dans le récit qu’on attache à l’objet. Pendant une courte période, ces objets numériques se sont vendus pour des centaines de milliers d’euros. Des images de singes, de pixels, ou de courts extraits sonores sont devenus des investissements financiers à part entière, simplement parce que l’on croyait que leur valeur allait exploser. Le récit était plus fort que l’objet. L’idée a précédé la valeur — et l’a fabriquée. Et même si le marché des NFT s’est depuis effondré, cette mécanique hyperstitionnelle, elle, n’a pas disparu. Elle s’est déplacée vers d’autres promesses, d’autres récits viraux prêts à être crus… et investis.
D.🏛️ Politique & récits performatifs
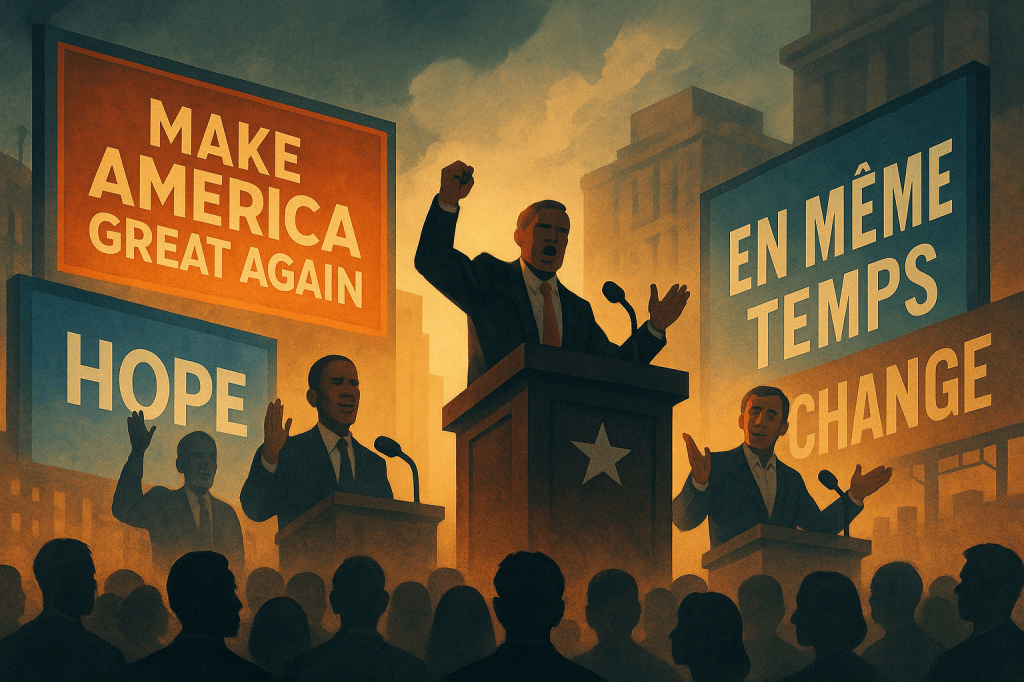
La politique n’échappe pas à la logique hyperstitionnelle. Elle s’y adonne même avec un zèle tout particulier : créer un récit pour capter l’imaginaire collectif, puis le faire advenir par l’action politique, la peur ou l’espoir. Ce n’est pas seulement une question de programme, mais de mise en récit du réel. On ne propose plus seulement des idées, on incarne des visions. On ne gouverne plus seulement avec des lois, mais avec des narrations émotionnelles, des figures archétypales (le sauveur, le peuple trahi, l’élite corrompue, l’ennemi intérieur…), des promesses floues mais mobilisatrices. Le “Make America Great Again”, par exemple, n’est pas un plan : c’est une hyperstition rétro-futuriste, un passé idéalisé projeté comme horizon à restaurer. En France, les récits de “décadence”, de “grand remplacement” ou de “réarmement moral” suivent la même mécanique : ils injectent des fictions émotionnelles dans le débat, qui finissent par structurer les discours, influencer les lois, polariser l’opinion. Mais ce phénomène n’est pas neuf :
- John F. Kennedy, dans les années 60, portait le récit d’une nouvelle frontière — un avenir conquérant, scientifique, libérateur, qui a nourri la course à l’espace et la technolâtrie américaine. ;
- Barack Obama, en 2008, a incarné le storytelling du renouveau et de l’unité post-raciale avec un simple mot : hope. ;
- Emmanuel Macron, lui, s’est forgé en “start-up politique” sur le récit de la disruption : ni droite ni gauche, jeune et moderne, “et en même temps”… une hyperstition technocratique calibrée pour rassurer les marchés et séduire les déçus des anciens récits.
Même les leaders sont devenus des récits en soi : storytelling personnel, roman de la réussite, dialectique du “je suis comme vous” ou du “je vais vous sauver”. Les parcours sont romancés, les erreurs rebrandées, les coups d’éclat scénarisés. Dans le théâtre politique, l’hyperstition devient outil d’influence, d’adhésion, parfois d’intimidation narrative. Et dans un monde ultra-connecté, chaque mot, chaque image, chaque posture participe à cette fabrique de la croyance. Les réseaux sociaux jouent ici un rôle de chambre d’écho permanente : les récits s’y amplifient, se radicalisent, se simplifient.
Ce ne sont plus les projets les plus solides qui triomphent, mais ceux qui captent le mieux l’imaginaire collectif. Autrement dit : ceux qui performent le récit, avant de performer le réel.
E. 🎯 Marketing & storytelling

Vendre des récits plus que des produits
Cette proposition sur les hyperstitions ne serait pas complète sans évoquer les récits marketing. Aujourd’hui, la discipline ne vend plus un produit mais un récit émotionnel. Ce n’est pas le soda qu’on achète, mais la promesse d’une insouciance rafraîchissante. Ce n’est pas le smartphone, mais l’idée d’être libre, créatif, connecté, en avance sur les autres. Les marques construisent des hyperstitions à la chaîne : elles associent un objet banal à une valeur symbolique forte, qu’elles diffusent jusqu’à ce qu’elle devienne une norme, un automatisme, une habitude culturelle. Exemples :
- Boire Coca-Cola, c’est faire partie de la fête.
- Porter des Nike, c’est devenir acteur de sa propre victoire.
- S’acheter un iPhone, c’est prouver qu’on appartient à une avant-garde.
Ces récits sont tellement intégrés qu’ils deviennent invisibles. On ne voit plus la stratégie, on ressent seulement l’élan de consommation comme une évidence. Le branding ne vend plus un objet : il fabrique de l’adhésion symbolique. Les marques deviennent des mythologies modernes, avec leurs slogans comme mantras, leurs fondateurs comme figures messianiques, leurs publicités comme liturgies visuelles. Mais l’hyperstition publicitaire ne se limite plus à l’image de soi ou à la réussite individuelle. Elle investit aussi les récits collectifs : écologie, justice sociale, féminisme, diversité. Des valeurs importantes, mais souvent transformées en éléments de langage corporate, à grand renfort de greenwashing, de rainbow capitalism (récupération commerciale des luttes LGBTQ+ par les marques ou les entreprises, sans engagement réel, juste pour améliorer leur image ou booster leurs ventes) ou de storytelling inclusif sur commande. On repeint une bouteille en vert, on appose un drapeau LGBTQ+ sur un logo, on insère une femme forte dans une publicité… et soudain, on vend du sens. Le récit devient performatif avant d’être cohérent. On ne change pas vraiment les pratiques : on raconte qu’on agit. C’est la logique du “virtue signalling” : il suffit de signaler qu’on a compris la tendance, sans obligation de cohérence structurelle. Et si le récit est suffisamment lisse, viral ou flatteur, il génère un effet de réalité. L’hyperstition opère : la marque est perçue comme engagée, bien avant de l’être réellement — voire sans jamais l’être.
Marques-mouvements : quand le business devient cause
Certaines marques vont plus loin et se positionnent comme des acteurs de changement sociétal à part entière (ce sont ce que l’on appelle des « marques-mouvements« ). Elles ne vendent plus seulement un produit : elles racontent qu’elles défendent un combat. C’est le cas de Patagonia, Ben & Jerry’s, The Body Shop, Veja… Ces entreprises adoptent une posture militante, s’expriment publiquement sur des enjeux politiques ou écologiques, et affirment vouloir changer le système de l’intérieur.
- Patagonia a fait de sa lutte contre le dérèglement climatique un pilier de son identité. “Don’t buy this jacket” est devenu un slogan contre la surconsommation… utilisé dans une campagne de notoriété planétaire.
- Ben & Jerry’s prend position sur la justice sociale, le racisme, les droits LGBTQ+, avec des campagnes choc. Mais derrière le vernis engagé, la marque reste une filiale du géant Unilever, acteur majeur du capitalisme mondialisé. Elle vend des glaces industrielles dans des pots en plastique, en jouant habilement sur l’idée que “manger une glace peut être un acte militant”.
Ce type d’hyperstition est particulièrement subtil : on floute la frontière entre engagement sincère et stratégie de marque. La dissonance entre le récit et la structure économique peut être énorme — mais si le récit fonctionne, il suffit à convaincre. On ne vend plus un produit engagé. On vend l’idée que consommer ce produit fait partie d’un combat.
Le marketing incarné : influenceurs & récit de soi
À l’ère des réseaux sociaux, l’hyperstition marketing s’est incarnée dans les individus eux-mêmes. Les influenceurs ne sont pas que des vitrines : ce sont des récits ambulants. Ils ne vendent pas un produit, mais une vie désirable, une esthétique de l’existence, une narration calibrée de l’accomplissement personnel. Et plus cette narration est cohérente, plus la marque qui s’y associe hérite de sa charge émotionnelle.
Ce n’est plus “je consomme, donc je suis”, mais “je me raconte en consommant ce que je suis censé être.”
Les identités deviennent des leviers publicitaires. Les produits deviennent des fragments de récit. Et le marché devient le théâtre d’une performance permanente, où l’émotion, la projection, l’appartenance valent bien plus que la qualité intrinsèque de ce qu’on vend.
F. 🎮 Culture pop
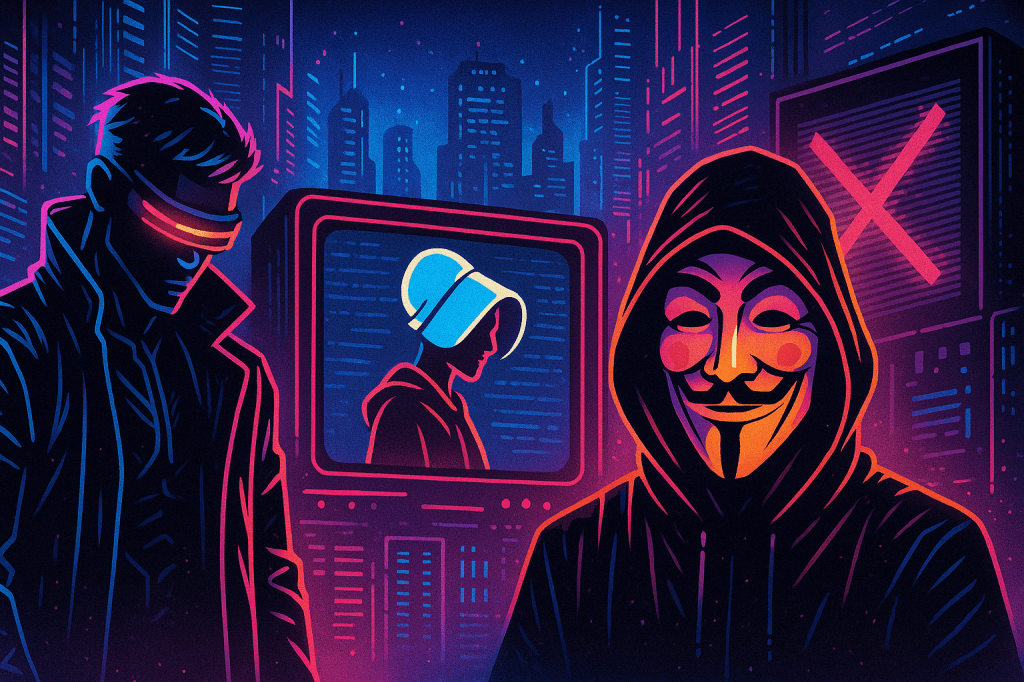
L’hyperstition adore la culture pop… car elle est déjà fictionnelle, émotionnelle et virale. Mais ce qui change aujourd’hui, c’est que certaines œuvres ne restent pas des fictions : elles façonnent nos attentes, nos comportements, nos visions du monde — jusqu’à parfois devenir des références opérantes dans le réel.
- Prenons Black Mirror. Ce n’est pas une série dystopique comme les autres : c’est devenu une grille de lecture du présent. On ne dit plus “tiens, ce serait fou si ça arrivait”, mais : “on dirait un épisode de Black Mirror.” Autrement dit : la fiction a anticipé le réel… ou l’a préparé.
- Idem pour Matrix, qui a donné naissance à des récits entiers d’“éveil” La pilule rouge est devenue un symbole métapolitique, d’abord repris par des mouvements technocritiques puis dévoyé par certains groupes masculinistes ou complotistes. Une image esthétique — celle de sortir de l’illusion — s’est muée en hyperstition idéologique.
- Même logique avec The Handmaid’s Tale, adapté du roman de Margaret Atwood. À l’origine, une dystopie glaçante sur une société théocratique patriarcale. Mais depuis la montée des mouvements réactionnaires et les attaques contre les droits des femmes (aux États-Unis, notamment sur l’avortement), les costumes des servantes sont devenus des symboles de manifestation. Le récit s’est incarné dans la rue. La fiction a donné un langage visuel, un archétype, un “costume de résistance”.
- Ou encore Fight Club, film culte de la fin des années 90, devenu hyperstition malgré lui. À la base, une satire de la masculinité toxique, du capitalisme déshumanisant et de la quête d’identité dans une société saturée. Mais une partie du public a pris le récit au premier degré : Tyler Durden est devenu un modèle, la destruction comme émancipation. Le rejet du confort bourgeois comme retour à la virilité brute. Résultat : l’esthétique et l’attitude ont été récupérés par des communautés qui, paradoxalement, incarnent ce que le film critiquait.
- Même chose pour Cyberpunk 2077, jeu vidéo futuriste du polonais CD Project Red porteur d’un imaginaire fort : implants, corps modifiés, IA tentaculaires, mégacorporations, saturation urbaine et nihilisme technologique… L’univers est censé dénoncer une société déshumanisée… mais il devient surtout une esthétique désirable, entre néons, augmentations stylisées et hackers glam. On ne veut pas vivre dans ce monde. Mais on veut ressembler à ceux qui y survivent avec classe.
Et juste pour le plaisir, on pourrait aussi évoquer quelques autres œuvres fortes qui ont marqué l’hyperstition de la pop culture comme le 1984 d’Orwell, dystopie politique devenue un lexique courant du réel. « Big Brother”, “novlangue”, “police de la pensée” — autant de concepts fictionnels désormais utilisés pour analyser notre monde. Là aussi, le récit performe le réel : il offre les mots pour le nommer, le critiquer, parfois l’amplifier. V for Vendetta, écrit par Alan Moore et dessiné par David Lloyd, et ses masques de Guy Fawkes, repris par Anonymous et dans les mouvements Occupy, illustrent la même mécanique. Une fiction devient un symbole d’insurrection mondialisé, réutilisé bien au-delà de son contexte d’origine. Ou encore Don’t Look Up, cette incroyable satire du déni climatique à l’ère des réseaux sociaux, ce film étant devenu un cri de ralliement lucide sur l’inertie collective. Il n’a rien changé seul, mais il a mis des mots — et des émotions — sur ce que beaucoup ressentaient. C’est le pouvoir d’une hyperstition critique : faire résonner ce qui restait dispersé.
VI. Critique de notre époque hyperstitionnelle
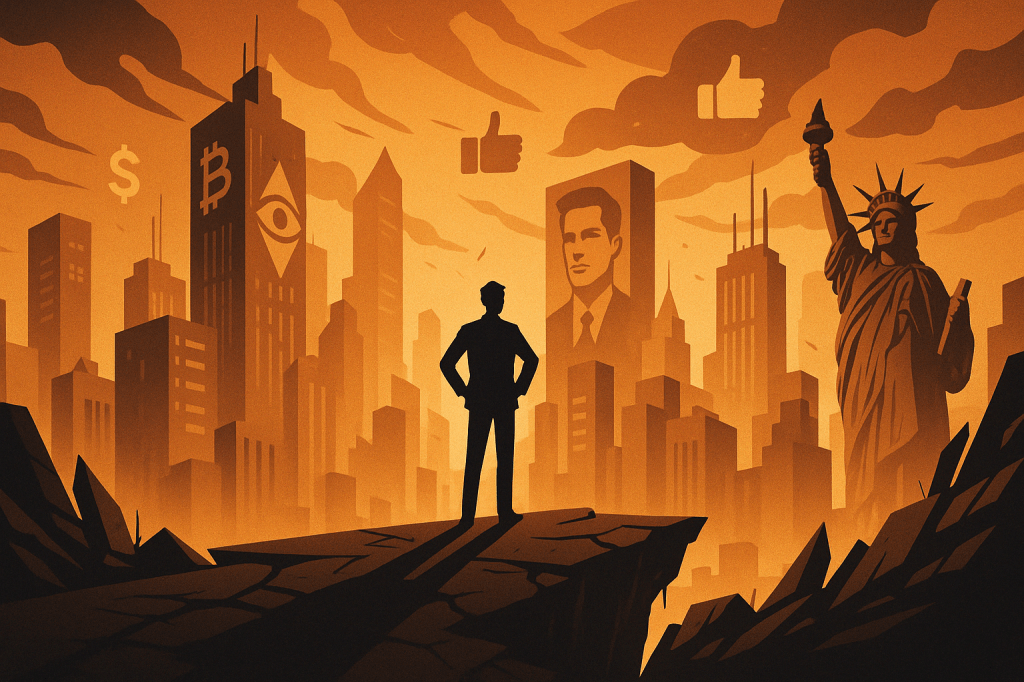
Ce qui rend notre époque si troublante, c’est cette cohabitation paradoxale entre deux mouvements contraires :
- D’un côté, des fictions qui se réalisent à force d’être racontées ;
- Mais aussi, de l’autre, une réalité tellement médiatisée, interprétée, scénarisée qu’elle finit par ressembler à une fiction. Par exemples : des guerres qui deviennent des séries de clips viraux, des catastrophes climatiques des épisodes à suspense, des campagnes politiques des shows scénarisés. Le réel ne se donne plus à voir tel qu’il est : il est mis en scène, découpé en séquences partageables, réduit à ce qui produit du récit.
Que ce soit dans un sens comme dans l’autre, tout cela met en lumière notre addiction aux récits. Et c’est justement cela qui permet aux hyperstitions d’exister et de perdurer. Elles n’émergent pas du vide : elles s’épanouissent dans un terrain fertile, façonné par notre besoin constant d’histoires pour comprendre, ressentir, exister. Nous sommes devenus accros aux récits parce qu’ils touchent l’émotion avant la raison, parce qu’ils simplifient ce qui est complexe, parce que nos outils numériques en amplifient la forme, et surtout parce qu’ils nous aident à supporter l’absurde. Ils engagent, polarisent, soulagent. Nous avons besoin d’y croire — même quand ils sont faux, même quand ils nous desservent. Ce ne sont pas les récits les plus vrais qui survivent, mais ceux qui captent le mieux notre attention, notre affect, notre soif de sens.
Ce pouvoir du récit n’est pas qu’un phénomène culturel ou psychologique : il peut aussi devenir un levier stratégique, consciemment activé. Car si une hyperstition peut émerger spontanément, elle peut aussi être injectée dans l’espace public pour orienter les croyances, les comportements, voire les marchés. Il suffit d’un récit suffisamment simple, crédible, émotionnel — et un écosystème de diffusion réactif pour qu’il se propage. C’est ainsi qu’on assiste parfois à de véritables manipulations de masse, où des récits sont construits, calibrés et relayés non pas pour éclairer, mais pour produire un effet ciblé : un vote, un achat, une peur, un ennemi commun. Dans ces cas-là, l’hyperstition devient outil d’influence — voire arme narrative.
Pourtant, il serait trop simple de réduire l’hyperstition à une force trompeuse. Car certaines idées, aussi fictives soient-elles à l’origine, peuvent aussi mobiliser des élans vertueux : stimuler la coopération, encourager l’innovation, créer un imaginaire porteur. La croyance que “les êtres humains sont fondamentalement bons” (que je ne partage pas du tout), bien qu’impossible à prouver, a inspiré des politiques éducatives plus bienveillantes, des mouvements pacifistes ou des formes de solidarité. Le récit d’un futur écologique désirable, même encore lointain ou utopique, peut donner naissance à des projets durables, à des engagements sincères. La conviction que la science finira par “trouver une solution” a parfois généré des avancées majeures : vaccins, énergies renouvelables, exploration spatiale… Et certaines fictions — de Star Trek à Black Panther — ont contribué à façonner des vocations, des imaginaires d’émancipation, des représentations réparatrices.
Mais ces récits “positifs” doivent aussi être interrogés. Car parfois, l’hyperstition ne mobilise pas, elle apaise — voire anesthésie. La croyance aveugle dans le progrès scientifique peut devenir un récit d’exonération : une manière de justifier l’inaction présente en projetant la responsabilité sur l’avenir. De la même façon, dire qu’on continue à faire des enfants parce qu’“on va leur transmettre de bonnes valeurs” revient à déléguer à l’enfant la mission de réparer un monde qu’on n’a pas su transformer nous-mêmes. En bien comme en mal, ce n’est pas la véracité du récit qui détermine son impact, mais sa capacité à se diffuser et à s’enraciner dans nos comportements. L’hyperstition, au fond, est un amplificateur : elle ne juge pas le contenu, elle en augmente l’effet. Tout dépend de ce qu’on y insuffle.
VII. Et maintenant ?
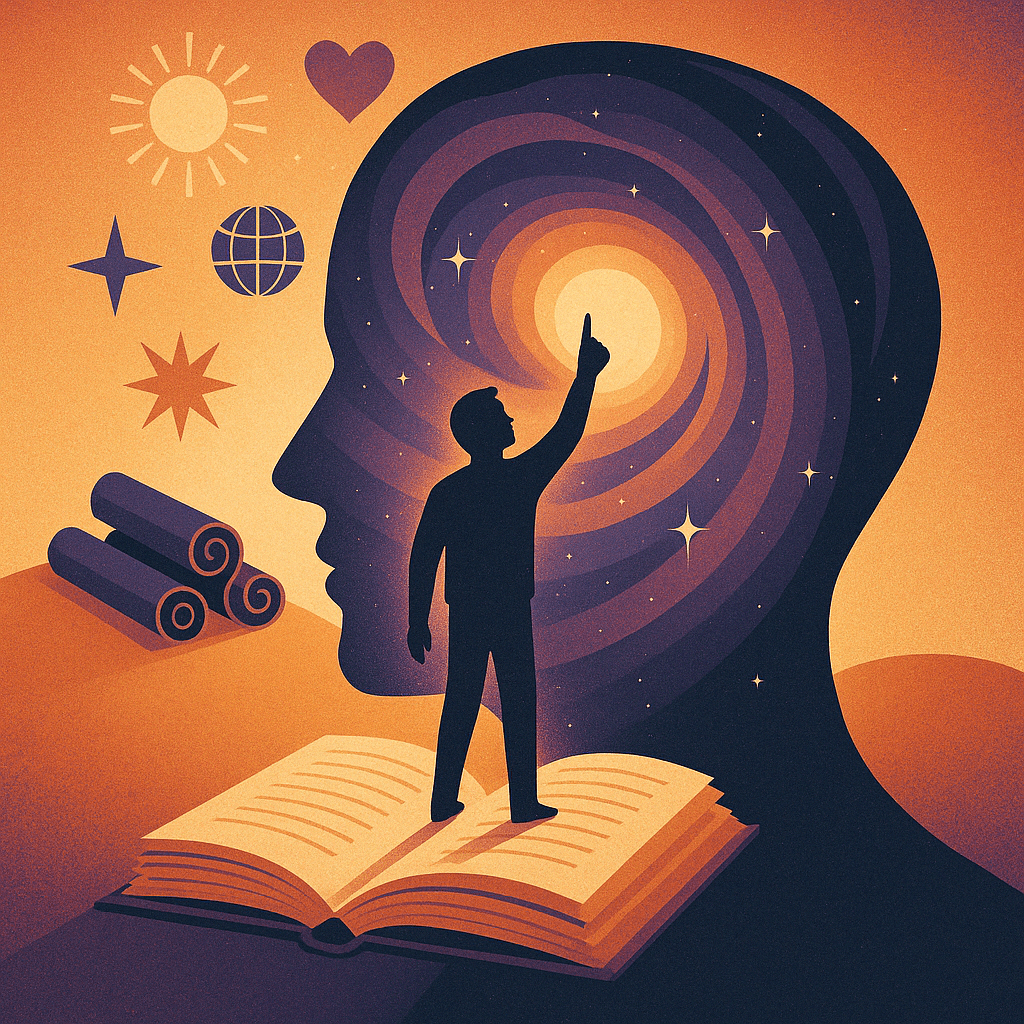
Et là, je pose la question : pourrions-nous nous passer des hyperstitions ? Avant d’aborder ce sujet, j’aurais eu tendance à répondre par l’affirmative. Mais ce serait oublier que nous sommes à la fois des êtres rationnels et narratifs. On ne se contente pas d’observer le monde : on lui cherche un sens. On imagine l’avenir avant qu’il n’existe. On invente des histoires pour tenir debout. On se projette dans des récits collectifs — progrès, nation, amour, apocalypse, karma, postérité… Et parfois, ces récits deviennent réels simplement parce qu’ils ont été assez crus, répétés, partagés.
Alors oui, je dois bien le reconnaître : vouloir vivre sans hyperstition, c’est un peu comme vouloir vivre sans langage, sans mémoire ou sans imagination. La vraie question devient donc : à quelles hyperstitions allons-nous prêter foi ? Quelles histoires méritent qu’on les active collectivement ? Et surtout : quelles hyperstitions faut-il désamorcer avant qu’elles ne façonnent le réel à nos dépens ? C’est là, encore une fois, qu’il devient absolument nécessaire de prendre conscience de leur existence — et de leur impact sur nous. Car seule la lucidité permet de ne pas être captif du récit, mais acteur de celui qu’on choisit de nourrir.
Ainsi, une autre question se pose : si l’on ne peut se passer des hyperstitions, pourrait-on au moins reprogrammer ou remplacer les plus toxiques d’entre elles ? Pourquoi ne pas passer du néfaste “la croissance est indispensable” à un récit plus fertile comme “ralentir n’est pas régresser” ? Ou encore : troquer “la technologie finira bien par nous sauver” contre “la responsabilité commence maintenant” ? Substituer au dogme “chacun pour soi” un imaginaire de coopération : “personne ne s’en sort seul” ? Remplacer “il faut être productif pour valoir quelque chose” par “exister n’a pas besoin d’être rentable » ? Même dans l’éducation, abandonner l’idée que “les enfants sont notre avenir” pour réaffirmer que “notre avenir commence par nos choix d’adultes”. Bref, vous avez compris l’idée. Il ne s’agit pas de récits parfaits, mais de récits choisis — plus conscients, plus vivables, moins aliénants. Reprogrammer une hyperstition, ce n’est pas nier notre besoin de récit, c’est retrouver un pouvoir d’agir sur les récits que l’on héberge, que l’on transmet, que l’on propage. Et peut-être, en cela, redevenir un peu plus auteurs que figurants dans le monde qu’on façonne. Faut-il “reprogrammer” nos récits ? Et avec quoi ?
Pour aller plus loin :
📚 Références théoriques et critiques
– Nick Land – Fanged Noumena : recueil dense et radical, texte fondateur du concept d’hyperstition dans sa version techno-futuriste.
– Mark Fisher – Ghosts of My Life (et Capitalist Realism) : critique brillante des effets culturels et psychiques du capitalisme tardif.
– Sadie Plant – Zeros + Ones : cyberféminisme et cybernétique, dans la même mouvance que le CCRU.
– Jean Baudrillard – Simulacres et simulation : pour comprendre comment le réel est remplacé par ses représentations (précurseur dans l’esprit).
– Judith Butler – Le Pouvoir des mots ou Trouble dans le genre : pour une approche claire de la performativité (notamment identitaire).
🌍 Sociologie, économie et croyances collectives
– Yuval Noah Harari – Sapiens (et Homo Deus) : passionnante analyse du pouvoir des récits collectifs dans l’évolution humaine.
– Laurent de Sutter – Post-vérité : déconstruction du mythe de la vérité objective dans l’espace médiatique contemporain.
– Bruno Latour – Nous n’avons jamais été modernes : critique des catégories de “nature” et de “société” à travers les récits qui les fondent.
🎥 Culture pop et récits fondateurs
– George Orwell – 1984 : dystopie devenue référent politique.
– Margaret Atwood – The Handmaid’s Tale : un récit qui s’est incarné dans la rue.
– Chuck Palahniuk – Fight Club : roman transformé en icône ambivalente.
– Ray Kurzweil – The Singularity is Near : futurologue influent à l’origine de nombreuses hyperstitions techno-messianiques.
🕸️ Ressources en ligne
– CCRU Writings (archive) – textes originaux du collectif.
– Accelerationism Wiki – pour contextualiser le rôle des récits dans le courant philosophique accélérationniste.

Charte de transparence IA
🧠 Idée : 100 % IA
📁 Structure : Plan concocté par l’IA, alimentation conjuguée
✍️ Rédaction : J’ai été plus participant/chef d’orchestre tant l’IA m’a proposé des idées et des développements super intéressants !
🎨 Illustrations : générées à 100 % par IA
Intervention globale de l’IA estimée : 75 %

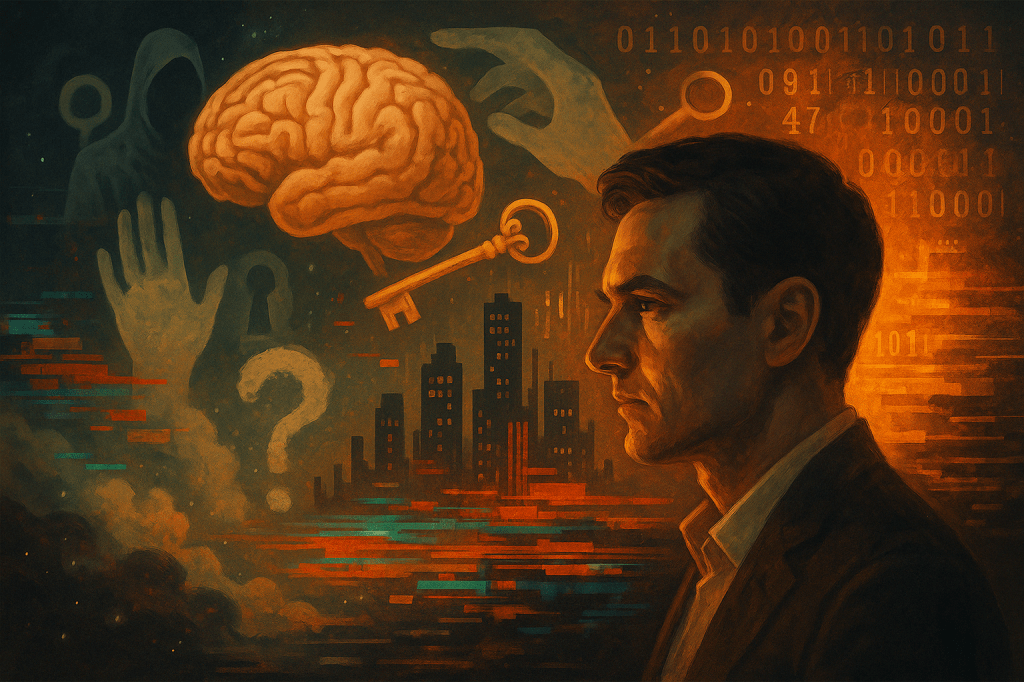


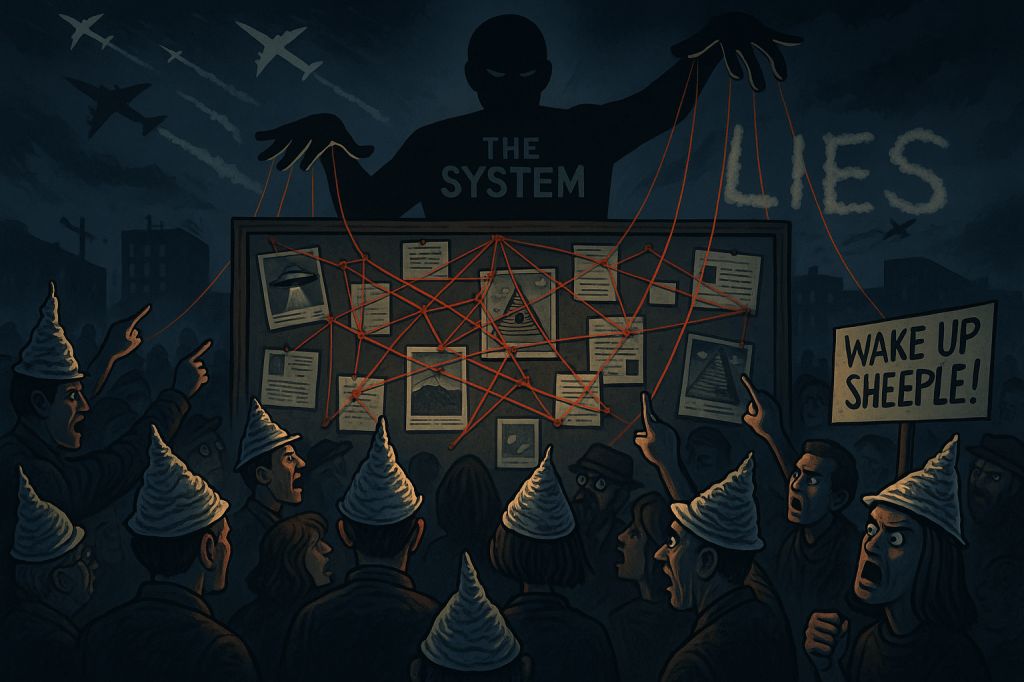



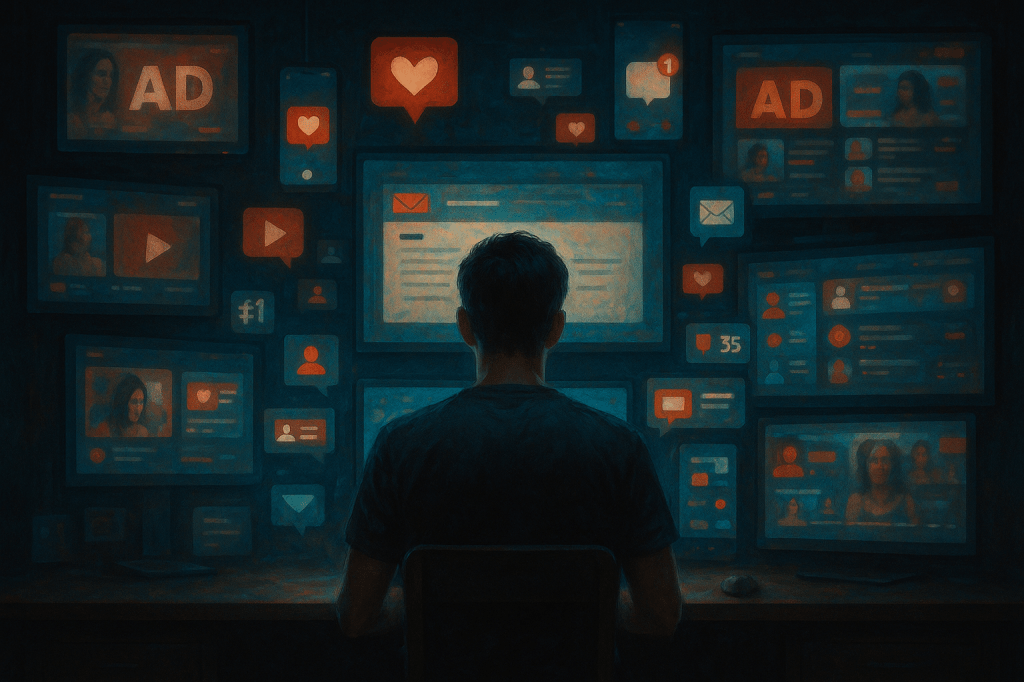
Laisser un commentaire